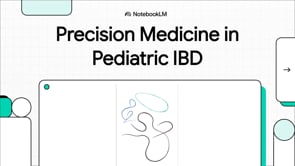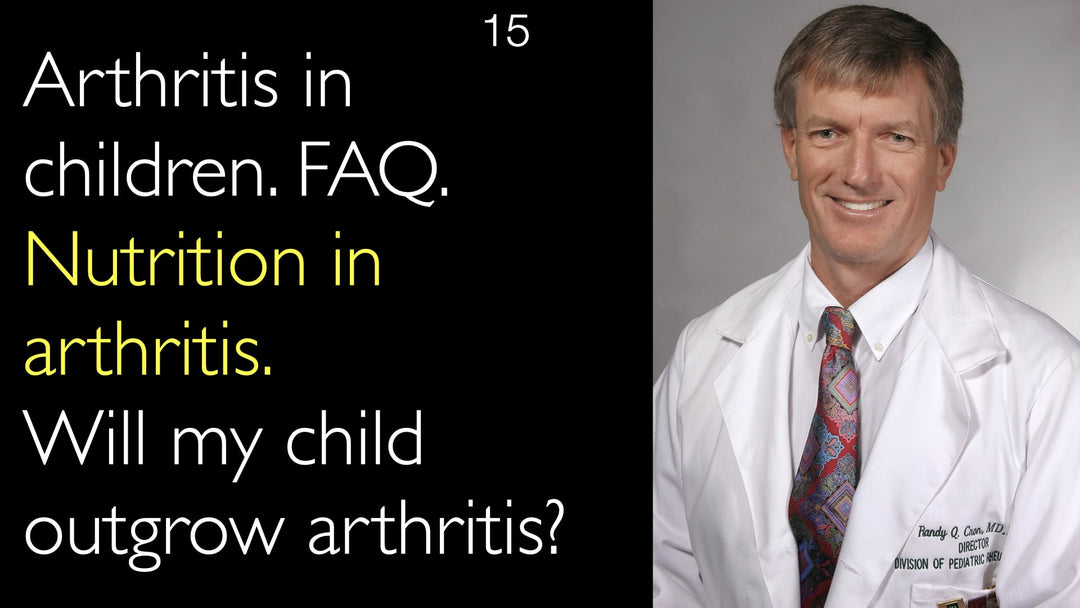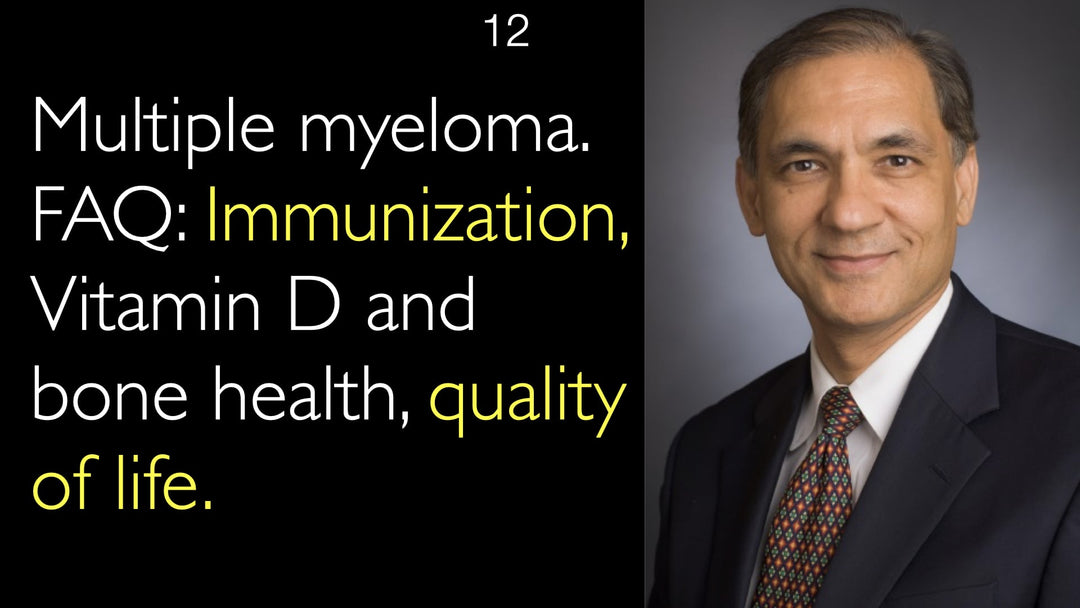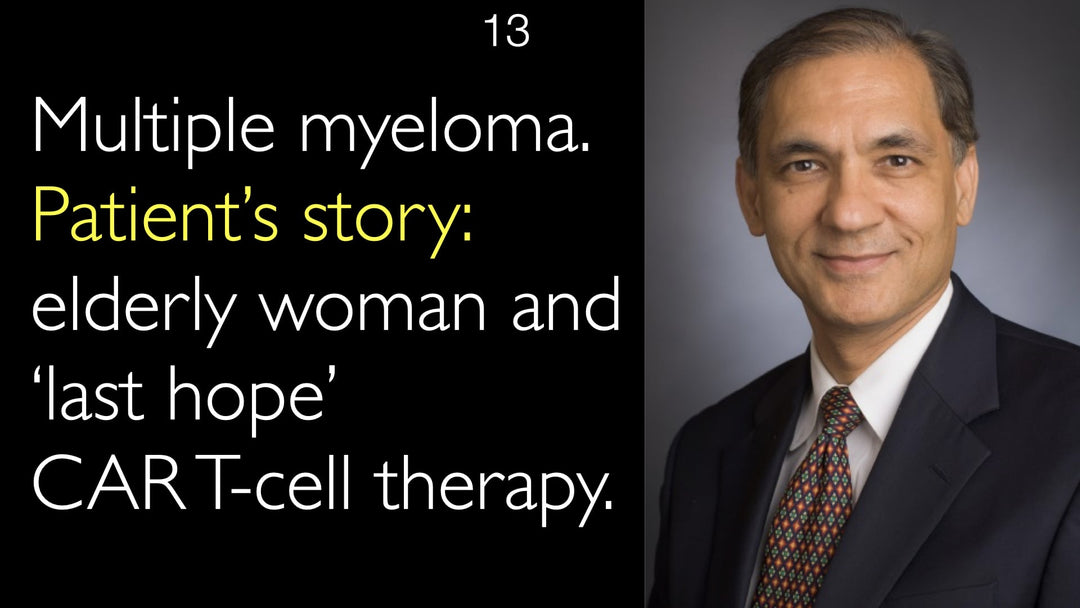Cette revue complète examine quand et comment choisir les traitements optimaux pour les enfants atteints de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (MICI). Les recherches indiquent qu’un démarrage précoce des thérapies biologiques dans la maladie de Crohn améliore significativement les résultats—certaines études rapportant des taux de rémission de 85 %, contre 60 % avec les traitements conventionnels—tandis que les bénéfices pour la rectocolite hémorragique demeurent moins nets. L’article explore également comment les médecins peuvent anticiper les patients nécessitant une prise en charge plus agressive, et comment l’ordre d’administration des médicaments influence leur efficacité à long terme.
Choisir le bon traitement au bon moment pour les enfants atteints de maladie inflammatoire chronique de l’intestin
Table des matières
- Introduction : Le défi thérapeutique dans la MICI pédiatrique
- Le bon moment : une thérapie efficace précoce
- Prise en charge d’une maladie évolutive
- Les limites de la thérapie séquentielle
- Avantages d’un traitement précoce dans la maladie de Crohn
- Avantages d’un traitement précoce dans la rectocolite hémorragique
- Définir le « précoce » : un débat en cours
- Le bon patient : prédire l’évolution de la maladie
- Facteurs cliniques influençant le pronostic
- Marqueurs protéiques disponibles en pratique clinique
- Biomarqueurs prédictifs futurs
- Le bon médicament : séquençage et choix thérapeutiques
- Choisir le traitement de première intention
- L’ordre des traitements est-il important ?
- Approches par thérapie combinée
- Conclusion et recommandations
- Sources d’information
Introduction : Le défi thérapeutique dans la MICI pédiatrique
Malgré un arsenal thérapeutique plus large que jamais, la maladie inflammatoire chronique de l’intestin (MICI) présente toujours un plafond d’efficacité significatif. Dans les essais cliniques, le taux de réponse dépasse rarement 30 %. Beaucoup de patients ne trouvent le traitement adapté qu’après l’échec de plusieurs médicaments, ce qui peut être invalidant, psychologiquement éprouvant et causer des lésions intestinales irréversibles.
La solution réside dans la médecine de précision : identifier le bon patient, le bon traitement, le bon moment, la bonne dose et la bonne stratégie de suivi. Cet article se concentre sur l’adéquation cruciale entre le bon patient et le bon traitement au bon moment, en accordant une attention particulière à la MICI pédiatrique, où les données spécifiques font souvent défaut par rapport aux études chez l’adulte.
Le bon moment : une thérapie efficace précoce
Le moment d’initiation du traitement joue un rôle déterminant dans la prise en charge de la MICI. L’approche a évolué de la thérapie séquentielle traditionnelle (débuter par des médicaments moins efficaces) vers une thérapie efficace précoce (recourir d’emblée à des traitements plus puissants chez les patients appropriés).
Prise en charge d’une maladie évolutive
La MICI, incluant la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique, est une pathologie chronique et évolutive qui provoque des lésions intestinales irréversibles. Les traitements actuels visent à réduire l’inflammation, mais ne peuvent réparer les dommages existants. Cette progression naturelle conduit souvent à des complications nécessitant une intervention chirurgicale.
Dans la maladie de Crohn, la fibrose (formation de tissu cicatriciel) est une complication connue, entraînant des sténoses (rétrécissements) chez un tiers des patients. La maladie de Crohn à début pédiatrique présente généralement un phénotype plus sévère que chez l’adulte, suggérant que les enfants pourraient bénéficier davantage d’un traitement agressif précoce pour prévenir les dommages liés à l’inflammation chronique sur une durée de maladie plus longue.
La rectocolite hémorragique n’a que récemment été reconnue comme évolutive. Plus de la moitié des patients développent une extension de la maladie, et une petite proportion présente des sténoses fibrotiques coliques. La durée, la sévérité et l’activité de la maladie sont associées à un risque accru de cancer colorectal.
Les limites de la thérapie séquentielle
Historiquement, la MICI était traitée par thérapie séquentielle, exigeant l’échec de médicaments moins efficaces comme la mésalazine et les thiopurines avant d’initier les biologiques, même chez les patients modérés à sévères. Les preuves actuelles montrent que cette approche fait passer à côté d’une « fenêtre d’opportunité » cruciale pour modifier durablement l’évolution de la maladie grâce à un contrôle rapide de l’inflammation.
Malgré cette avancée, la thérapie séquentielle reste courante. Une vaste étude américaine sur bases de données (28 119 patients RCH et 16 260 patients MC) entre 2008 et 2016 a montré que moins de 1 % des patients RCH et moins de 5 % des patients MC recevaient des biologiques en première intention. À la place, 61 % des patients RCH débutaient par une monothérapie par acide 5-aminosalicylique, et 42 % des patients MC par une monothérapie corticostéroïde.
Les assureurs imposent souvent une thérapie séquentielle contre l’avis des prescripteurs. Une enquête de 2016 de la Crohn’s and Colitis Foundation a révélé que 40 % des patients y étaient contraints par leur assureur malgré la recommandation contraire de leur médecin.
Avantages d’un traitement précoce dans la maladie de Crohn
De multiples études démontrent les bénéfices nets d’un traitement efficace précoce pour la maladie de Crohn :
- Étude PRECiSE 2 : Les patients traités dans l’année suivant le diagnostic avaient un taux de réponse de 90 %, contre 57 % pour ceux diagnostiqués depuis 5 ans ou plus
- Essai CHARM : Les patients avec une durée de maladie inférieure à 2 ans avaient un taux de rémission de 43 %, contre 30 % (2-5 ans) et 28 % (>5 ans)
- Essai CALM : Les patients diagnostiqués précocement et atteignant une rémission profonde présentaient une réduction de 81 % des événements indésirables à 3 ans
- Consortium VICTORY : Les patients MC avec une durée de maladie ≤2 ans avaient une meilleure réponse au vedolizumab
- Étude LOVE-CD : Les patients MC précoces (<2 ans) montraient une rémission endoscopique significativement meilleure (45 % vs 15 %) et une rémission clinique sans corticostéroïdes avec rémission endoscopique (47 % vs 16 %) sous vedolizumab
Les essais randomisés contrôlés prospectifs confirment également l’intérêt du traitement précoce. Un essai a randomisé des patients MC nouvellement diagnostiqués entre une thérapie combinée précoce (infliximab + thiopurine) ou thiopurine seule. Le traitement précoce par infliximab a conduit à 62 % de rémissions cliniques à 1 an, contre 42 % sous thiopurine seule.
L’essai en clusters randomisé REACT-1 (n=1 982) a montré qu’une thérapie séquentielle accélérée réduisait les complications graves et le besoin d’hospitalisation ou de chirurgie.
Les données pédiatriques spécifiques soutiennent fortement la thérapie biologique précoce :
- Cohorte RISK (n=1 813) : Le traitement précoce par anti-TNF était supérieur à l’immunomodulateur précoce pour atteindre la rémission à 1 an (85,3 % vs 60,3 % ; Risque Relatif : 1,41)
- Étude sud-coréenne (n=31) : Les taux de rechute s’amélioraient avec l’infliximab initié juste après le diagnostic versus après échec d’un traitement conventionnel (amélioration de 21 % des taux sans rechute à 3 ans)
- Essai européen multicentrique (n=100) : L’infliximab de première ligne améliorait la rémission endoscopique à court terme à 10 semaines (59 % vs 17 %), la rémission à long terme sans escalade à 52 semaines (41 % vs 15 %) et les paramètres de croissance
Avantages d’un traitement précoce dans la rectocolite hémorragique
Contrairement à la maladie de Crohn, les données ne soutiennent pas de façon convaincante un traitement efficace précoce pour la rectocolite hémorragique :
- Étude Murthy et al (n=213) : Une durée de maladie plus longue était associée à une rémission sans corticostéroïdes plus élevée à 1 an (OR ajusté=2,1 par augmentation de 10 ans) et à un risque de colectomie plus faible (HR ajusté=0,49 par augmentation de 10 ans)
- Étude Mandel et al (n=42) : Aucun bénéfice d’une exposition précoce aux anti-TNF (dans les 3 ans suivant le diagnostic)
- Consortium VICTORY : Aucune amélioration de la réponse au vedolizumab chez les patients RCH avec des durées de maladie plus courtes
- Étude LOVE-UC : Aucune différence dans les taux de rémission à la semaine 26 entre les patients RCH précoces (<4 ans) et tardifs (>4 ans) (49 % vs 43 %)
Les données pédiatriques sur ce sujet sont quasi inexistantes. Une étude portant sur 121 enfants avec RCH comparant l’initiation précoce versus tardive de l’azathioprine n’a trouvé aucune différence dans les taux de chirurgie, d’hospitalisation, d’escalade thérapeutique, d’extension de la maladie ou d’épisodes de colite aiguë sévère.
La littérature disponible est rétrospective et principalement adulte, mais montre systématiquement l’absence de bénéfice net d’un traitement précoce dans la RCH. Un essai prospectif européen en cours (SPRINT) vise à examiner les bénéfices d’un traitement précoce dans la RCH adulte, mais des essais pédiatriques restent nécessaires.
Définir le « précoce » : un débat en cours
Il persiste un désaccord sur ce qui constitue une MICI « précoce ». Certains experts suggèrent 2 ans après le diagnostic, mais cela diffère d’autres maladies comme la polyarthrite rhumatoïde où des intervalles beaucoup plus courts (3 mois) sont décrits. Les longs délais de diagnostic dans la MICI compliquent cette définition, car 2 ans après le diagnostic peuvent correspondre à 5 ans après le début de la maladie.
Le bon patient : prédire l’évolution de la maladie
Pour apparier rapidement le bon traitement au bon patient, définir le pronostic du patient est crucial. La pratique actuelle combine les facteurs cliniques avec les marqueurs biologiques traditionnels, tandis que la recherche élargit ces outils pronostiques.
Facteurs cliniques influençant le pronostic
En pédiatrie, un âge plus jeune au diagnostic est associé à un risque accru de rechutes et de récidives dans la RCH et la MC. La localisation/étendue de la maladie affecte également les pronostics :
- Maladie de Crohn : Les phénotypes périnéaux, iléocoliques et du tractus supérieur sont associés à des évolutions plus sévères
- Rectocolite hémorragique : La colite extensive comporte un risque de colectomie plus élevé
- La maladie évolutive (complications dans la MC, extension dans la RCH) prédit des issues défavorables
Les manifestations extra-intestinales (MEI) et les maladies inflammatoires immunomédiées concomitantes (MIIM) indiquent également un pronostic plus sévère. Une revue systématique de 93 études a trouvé que les patients avec MICI et une autre MIIM avaient un risque plus élevé de colite extensive/pancolite (RR 1,38) et de chirurgies liées à la MICI (RR 1,17). Une autre étude a montré qu’une MIIM préexistante était un facteur de mauvais pronostic (OR 3,71 pour le risque chirurgical).
Marqueurs protéiques disponibles en pratique clinique
Deux marqueurs classiques de la MICI sont la protéine C-réactive (CRP) et la calprotectine fécale (CF). Bien que principalement indicateurs d’activité maladie, ils ont aussi une valeur pronostique :
- Élévations de la CRP : Associées à un besoin accru de chirurgie dans la MC et la RCH, même durant la rémission clinique dans la MC
- Calprotectine fécale : Améliore les limitations de la CRP pour détecter l’inflammation intestinale
- Mesures sériées de CF : Peuvent prédire la progression/rechute de la maladie
Les réponses sérologiques aux pathogènes entériques et autoantigènes montrent également une valeur prédictive :
- Anticorps anti-Saccharomyces cerevisiae (ASCA)
- Anticorps anti-flagelline (CBir1)
- Autoanticorps anti-facteur de stimulation des colonies de granulocytes-macrophages (GMCSF)
- Anticorps anti-cytoplasme des neutrophiles de type périnucléaire (pANCA)
Dans une large étude pédiatrique prospective sur la MC, la positivité pour plus d’antigènes antimicrobiens était associée à une progression plus rapide vers une maladie compliquée. Une expression élevée d’autoanticorps anti-GMCSF est associée à une MC compliquée, et ces anticorps peuvent s’élever avant le diagnostic de la maladie.
Biomarqueurs prédictifs futurs
De nombreux marqueurs prédictifs sont en développement dans divers domaines ‘omiques :
- Cohorte RISK (maladie de Crohn pédiatrique) : Signature transcriptomique tissulaire de la matrice extracellulaire identifiée, prédictive de la survenue de sténoses dans les 3 ans
- Cohorte PROTECT (rectocolite hémorragique pédiatrique) : Deux signatures géniques prédictives de la sévérité et de la réponse thérapeutique identifiées
- Test sanguin validé : Panel de profil d’expression génique des lymphocytes T CD8+ classant les patients en groupes à faible et haut risque (note : l’utilisation de corticostéroïdes peut affecter les résultats)
Les études génomiques ont identifié quatre loci liés au pronostic, distincts des loci de susceptibilité. Les scores de risque polygénique et les polymorphismes de NOD2 ont été examinés, mais aucun n’était associé au comportement sténosant ou fistulisant dans la maladie de Crohn pédiatrique au sein de la cohorte RISK.
Des signatures microbiome, métabolomique et glycomique sont en cours de développement pour éclairer le pronostic. Les méthodes basées sur les réseaux peuvent intégrer des données multi-omiques pour identifier des sous-types personnalisés de la maladie et les traitements idéaux.
Le bon médicament : séquençage et choix thérapeutiques
Prendre des décisions fondées sur les données concernant le traitement de première intention a historiquement été difficile en raison du manque d’essais comparatifs directs, bien que cela soit en train de changer.
Choisir le traitement de première intention
Des essais récents en comparatif direct fournissent des données de comparaison précieuses :
- Essai VARSITY (n=769 patients atteints de RCH) : Le vedolizumab a montré une supériorité des résultats à 1 an par rapport à l’adalimumab (rémission clinique : 39 % vs 23 % ; amélioration endoscopique : 40 % vs 28 %)
- Essai SEAVUE (n=386 patients atteints de MC) : Aucune différence significative entre l’ustékinumab et l’adalimumab, bien qu’une tendance à une meilleure réponse endoscopique avec l’ustékinumab ait été observée
- Autres essais récents : Aucune différence significative entre l’étrolizumab et l’infliximab, ou entre l’adalimumab et les comparateurs
- Guselkumab vs ustékinumab : Le bloqueur de l’IL-23 comparé au bloqueur de l’IL-12/23 n’a montré aucune différence significative, possiblement en raison de problèmes de puissance statistique
L’ordre des traitements est-il important ?
Alors que de nouvelles thérapies entrent dans l’arsenal thérapeutique des MICI, comprendre l’impact de la séquence thérapeutique devient de plus en plus important. La réponse au traitement de première intention reste relativement faible—environ un tiers des patients restent sous leur premier traitement biologique lors du suivi, tandis que les deux tiers passent à un autre traitement.
La plupart des données sur les nouvelles thérapies examinent leur effet après un échec aux anti-TNF. Les traitements de deuxième ligne et au-delà montrent communément une efficacité diminuée, soulignant l’importance du choix du traitement de première intention.
Les études examinant le vedolizumab et l’ustékinumab après échec aux anti-TNF montrent des résultats mitigés :
- Deux études ont soutenu la supériorité de l’ustékinumab sur le vedolizumab après échec aux anti-TNF
- Une étude n’a rapporté aucune différence significative lorsqu’utilisés en troisième ligne après anti-TNF puis soit vedolizumab soit ustékinumab
Les médicaments anti-IL23 (risankizumab, mirikizumab, guselkumab) pourraient ne pas avoir une efficacité diminuée après un échec biologique antérieur. Les non-répondeurs aux anti-TNF montrent une régulation positive de l’IL23p19, de l’IL23R et de l’IL17A, suggérant une explication biologique à ces observations.
Les enfants avec une maladie de Crohn précoce montrent des niveaux significativement plus élevés d’ARN messager de l’IL12p40 et de l’IL12Rb2 et une production d’IFN-g par les lymphocytes T comparés à la maladie de Crohn tardive, suggérant que l’IL-12 pourrait être une voie importante dans la maladie précoce et la maladie réfractaire aux anti-TNF.
Les inhibiteurs de JAK (tofacitinib, upadacitinib) maintiennent leur efficacité après un échec biologique, possiblement en raison de mécanismes de clairance différents de ceux des thérapies biologiques. Cependant, d’autres petites molécules (modulateurs des récepteurs S1P) ne performent pas aussi bien après de multiples échecs biologiques.
Approches par thérapie combinée
L’utilisation rationnelle précoce de traitements combinés peut améliorer les taux de réponse et de rémission en ciblant des voies biologiques complémentaires. L’étude SONIC a célèbrement décrit la supériorité de la combinaison thiopurine + anti-TNF, bien que celle-ci soit tombée en défaveur car une monothérapie optimisée permet d’éviter les effets indésirables des thiopurines.
Il existe des données observationnelles sur d’autres approches combinées chez l’adulte et l’enfant. L’essai VEGA (n=214) a comparé la combinaison golimumab + guselkumab à la monothérapie pour la RCH modérée à sévère. L’amélioration endoscopique était plus probable avec la thérapie combinée, sans augmentation des événements indésirables. L’étude EXPLORER a examiné la combinaison vedolizumab + adalimumab + méthotrexate.
Conclusion et recommandations
Les preuves soutiennent fortement un traitement efficace précoce pour la maladie de Crohn pédiatrique, avec de multiples études montrant une amélioration significative des résultats incluant des taux de rémission plus élevés (85,3 % vs 60,3 % avec le traitement conventionnel), une meilleure croissance et une réduction des complications. Les bénéfices semblent moins clairs pour la rectocolite hémorragique, où les données ne soutiennent pas de manière convaincante un traitement agressif précoce.
Prédire quels patients nécessitent un traitement agressif précoce implique d’évaluer les facteurs cliniques (âge au diagnostic, localisation de la maladie, manifestations extra-intestinales) et les biomarqueurs disponibles (CRP, calprotectine fécale, marqueurs sérologiques). Les technologies omiques émergentes promettent d’améliorer les capacités de pronostic.
Le séquençage des traitements est important, le choix du traitement de première intention étant particulièrement crucial car les traitements ultérieurs montrent souvent une efficacité réduite. Les essais comparatifs directs fournissent de plus en plus de données pour éclairer ces décisions, bien que davantage de recherches spécifiques à la pédiatrie soient nécessaires.
Pour les familles naviguant les décisions de traitement des MICI pédiatriques, cette recherche souligne :
- L’évaluation précoce de la sévérité de la maladie et du pronostic est critique
- La maladie de Crohn bénéficie souvent d’une thérapie biologique plus précoce
- Les barrières d’assurance pour un traitement approprié restent un défi significatif
- Les décisions de séquençage thérapeutique devraient considérer les résultats à long terme
- La surveillance continue et l’ajustement du traitement sont essentiels
Information sur la source
Article original : "Choosing the Right Therapy at the Right Time for Pediatric Inflammatory Bowel Disease: Does Sequence Matter" par Elizabeth A. Spencer, MD, MSc
Publication : Gastroenterology Clinics of North America, Volume 52, 2023, Pages 517-534
Note : Cet article adapté aux patients est basé sur une recherche évaluée par les pairs et conserve l’intégralité du contenu et des données de la publication scientifique originale tout en le rendant accessible aux patients et aux familles affectés par les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin.