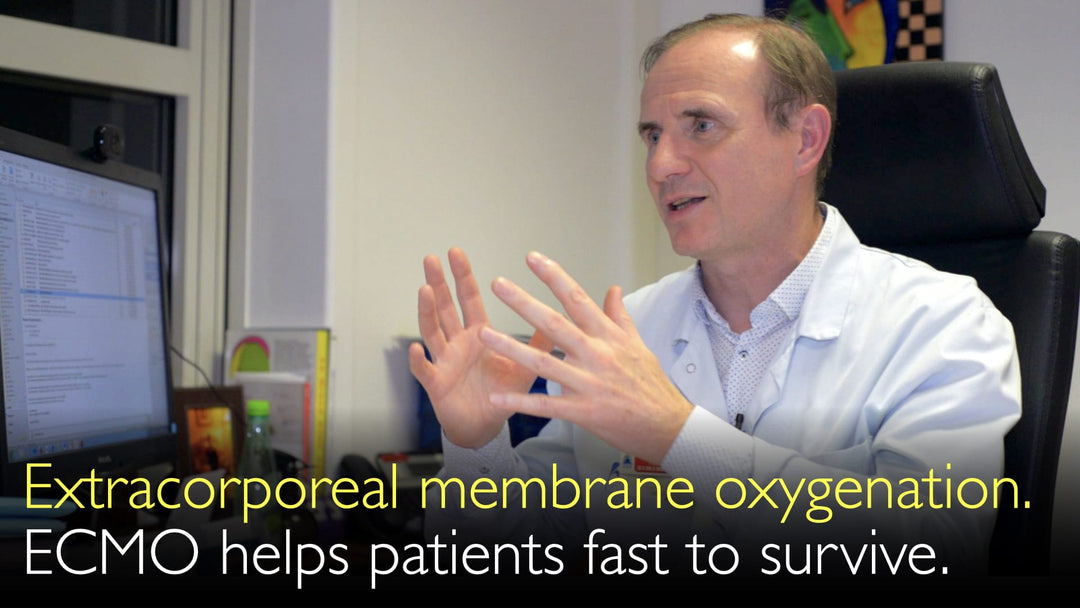Le Dr Pascal Leprince, MD, expert de renommée mondiale en oxygénation par membrane extracorporelle, explique comment l’ECMO offre un soutien circulatoire et respiratoire vital et immédiat aux patients en choc cardiogénique ou en arrêt cardiaque. Il décrit la procédure rapide d’implantation réalisée au chevet du patient, l’ampleur remarquable du programme de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière avec 500 implants par an, ainsi que les taux de survie critiques. Il souligne que l’ECMO représente une chance de survie décisive là où l’alternative serait presque inévitablement fatale.
Oxygénation par Membrane Extracorporelle (ECMO) : Une Intervention Salvatrice en Arrêt Cardiaque et État de Choc
Aller à la section
- Qu'est-ce que l'ECMO et comment fonctionne-t-elle ?
- Indications principales du traitement par ECMO
- L'avantage de l'implantation rapide de l'ECMO
- L'ampleur et le succès d'un programme majeur d'ECMO
- Taux de survie et devenir des patients sous ECMO
- L'approche en équipe pour une prise en charge efficace de l'ECMO
- Transcript intégral
Qu'est-ce que l'ECMO et comment fonctionne-t-elle ?
L'oxygénation par membrane extracorporelle (ECMO) est une assistance circulatoire et respiratoire temporaire qui supplée le cœur et les poumons. Le Docteur Pascal Leprince décrit le circuit d'ECMO comme un système relativement simple : une canule placée dans la veine fémorale du patient prélève le sang désoxygéné, qui est ensuite propulsé par une pompe centrifuge à travers un oxygénateur, puis réinjecté—désormais oxygéné—dans l'artère fémorale. Ce processus assure à la fois un soutien circulatoire complet et une fonction respiratoire, agissant comme un cœur-poumon artificiel externe pour les patients en état critique.
Indications principales du traitement par ECMO
L'indication principale de l'ECMO est le choc cardiogénique sévère, souvent consécutif à un infarctus du myocarde massif. Le Docteur Pascal Leprince précise que l'ECMO constitue alors un soutien circulatoire crucial. Elle peut également être configurée en mode veino-veineux (V-V), avec des canules placées entre deux veines, pour offrir un soutien purement respiratoire aux patients en insuffisance pulmonaire—notamment ceux souffrant d'un syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA) sévère ou d'autres affections compromettant l'oxygénation. Cette polyvalence en fait un outil vital face à diverses défaillances cardiaques et pulmonaires critiques.
L'avantage de l'implantation rapide de l'ECMO
L'un des atouts majeurs de l'ECMO réside dans la rapidité et la facilité de sa mise en place. Le Docteur Pascal Leprince souligne qu'elle peut être implantée rapidement au chevet du patient en réanimation, évitant ainsi de déplacer une personne instable vers un bloc opératoire ou une salle de cathétérisme. Dans les situations d'urgence extrême, la procédure peut même être réalisée pendant une réanimation cardiopulmonaire (RCP) en cours, ne prenant parfois que 10 à 15 minutes pour rétablir la circulation et sauver la vie du patient. Cette réactivité fait de l'ECMO une intervention extrêmement efficace pour les patients à quelques minutes de la mort.
L'ampleur et le succès d'un programme majeur d'ECMO
Le programme d'ECMO de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, initié par le Docteur Pascal Leprince et son équipe vers 2002-2003, a connu une croissance exponentielle. Le Docteur Leprince se souvient n'avoir implanté que cinq ou six dispositifs la première année. Mais la renommée de leur capacité à intervenir dans d'autres établissements a rapidement fait augmenter le nombre de transferts. Aujourd'hui, le programme réalise 500 implantations annuelles d'ECMO—environ 350 pour un soutien circulatoire et 150 pour un soutien respiratoire—témoignant de son ampleur et de son rôle essentiel dans le système de santé régional.
Taux de survie et devenir des patients sous ECMO
Les taux de survie sous ECMO varient selon la pathologie, mais la procédure offre un espoir là où il n’y en a souvent aucun. Le Docteur Pascal Leprince cite des chiffres précis : pour les patients après une RCP prolongée, le taux de survie avoisine les 10 %, tandis que pour ceux atteints de myocardite, il dépasse 70 %. Le taux de survie moyen dans leur centre est d’environ 50-55 %. Le Docteur Leprince souligne qu'il s'agit d'un succès considérable, car on estime que 95 % de ces patients en choc cardiogénique seraient décédés sans cette intervention. Sans ECMO, l’issue est presque toujours fatale.
L'approche en équipe pour une prise en charge efficace de l'ECMO
Le succès d'un programme à haut volume d'ECMO repose sur une équipe dédiée et bien organisée. Le Docteur Pascal Leprince exprime une grande fierté quant au fonctionnement de leur programme sans recrutement de personnel supplémentaire. L'équipe de garde de chirurgie cardiaque—composée d'un interne, d'un chef de clinique et d'un chirurgien senior—prend en charge toutes les urgences ECMO. Lorsqu'un appel arrive, le chef de clinique se déplace pour implanter l'ECMO, y compris dans d'autres hôpitaux, et rapatrie le patient. Ce système, efficace depuis plus de 15 ans, montre qu'un programme salvateur d'ECMO peut être rentable et durable grâce à l'engagement de l'équipe et une logistique rigoureuse.
Transcript intégral
Dr. Anton Titov, MD: L'un de vos domaines d'intérêt est l'assistance circulatoire et respiratoire extracorporelle, connue sous le nom d'ECMO, ou oxygénation par membrane extracorporelle. Quelles sont les indications du traitement par ECMO ? À quoi les patients peuvent-ils s'attendre s'ils en ont besoin ?
Dr. Pascal Leprince, MD: Oui. Pour ceux qui ne connaissent pas l'ECMO, il s'agit d'une circulation extracorporelle. Nous plaçons une canule dans la veine fémorale. Le sang du patient passe à travers la canule et une pompe centrifuge, puis traverse un oxygénateur. Comme le sang de la veine fémorale est peu oxygéné, il est enrichi en oxygène dans l'oxygénateur avant d'être réinjecté dans l'artère fémorale.
C'est un concept très simple—un circuit d'oxygénation du sang. Ce qui est intéressant, c'est que l'ECMO peut être mise en place très rapidement. Le patient peut être en choc cardiogénique, qui est l'indication principale. Il s'agit alors d'un soutien circulatoire.
L'ECMO peut aussi être utilisée pour un soutien respiratoire pur, en plaçant les canules entre deux veines. Ce n'est plus un soutien circulatoire, mais uniquement respiratoire.
Un autre avantage : l'ECMO peut être réalisée au chevet du patient. Pas besoin de le déplacer en réanimation, au bloc opératoire ou en salle de cathétérisme. On peut même, dans des cas extrêmes, l'implanter en extérieur—je ne le recommande pas, mais c'est possible—ou au domicile du patient, pendant une RCP. Parfois, en 10 ou 15 minutes, on implante l'ECMO et on sauve une vie. C'est très efficace.
On obtient un soutien circulatoire complet pour le patient en choc cardiogénique. Et quand l'ECMO est implantée entre veine et artère, elle assure à la fois la circulation et la fonction respiratoire. C’est un atout supplémentaire.
L'ECMO est aussi relativement peu coûteuse—en termes relatifs, bien sûr. Le dispositif coûte environ 5 000 euros. C'est une somme, mais les soins intensifs pour un patient critique sont très onéreux. Compte tenu de son efficacité, l'ECMO est plutôt rentable.
Nous avons lancé le programme d'ECMO ici à la Pitié-Salpêtrière en 2002 ou 2003. La première année, nous n'avons implanté que cinq ou six dispositifs—presque rien ! Je m'en souviens, car je les ai tous faits. Mais les résultats ont été encourageants.
Quand d'autres centres ont su que nous pouvions implanter l'ECMO hors de notre hôpital, les appels ont afflué. Des médecins nous contactaient pour un patient en RCP après un infarctus ou un choc sévère : "Pouvez-vous venir implanter une ECMO ?"
Ça s'est produit même ici, dans cet Institut de Cardiologie. Un collègue de la salle de cathétérisme nous appelait. Le nombre de patients sous ECMO a donc augmenté chaque année. Aujourd'hui, nous en implantons 500 par an—un chiffre énorme.
Sur ces 500, environ 350 le sont pour un soutien circulatoire, et 150 pour un soutien respiratoire. L'ECMO permet un tri efficace.
Face à un patient en choc cardiogénique après infarctus, qui va mourir dans les minutes ou heures qui suivent, on implante une ECMO pour lui donner une chance. Certains—environ 40 %—vont malheureusement décéder malgré tout. Si on affine la sélection, on réduit la mortalité, mais on veut offrir une option de survie au plus grand nombre. Le taux de mortalité reste donc assez élevé.
Par exemple, pour un patient sous RCP depuis plus d'une heure, les chances de survie sont très faibles. Mais certains survivent—c'est fascinant.
Même si, d'un point de vue de santé publique, cette utilisation de l'ECMO n'est pas très efficiente, pour le patient, cette procédure potentiellement salvatrice est très efficace. Il survit alors qu'il était condamné.
L'organisation de notre programme ECMO est quelque chose dont je suis très fier. C'est une histoire d'équipe. Nous gérons ce programme sans personnel supplémentaire—c'est remarquable.
Ça repose sur la bonne volonté des chirurgiens cardiaques. La nuit, nous avons trois personnes de garde : un interne, un chef de clinique et un chirurgien senior. En cas d'appel pour ECMO, le chef de clinique se rend dans l'autre hôpital pour l'implantation, puis ramène le patient à la Pitié avec l'équipe de transport. Ensuite, nous prenons le relais. Aucun coût supplémentaire pour l'hôpital—ça dure depuis 15 ans. C'est intéressant.
L'engagement de l'équipe est crucial. Beaucoup d'hôpitaux voudraient un médecin supplémentaire dédié—ce serait bien, mais pas toujours possible. Il faut prioriser : embaucher plus d'infirmiers, par exemple. Notre programme ECMO est un exercice d'équilibre, et il fonctionne bien.
La nuit, en cas d'urgence, le chef de clinique part pour une ECMO, et le chirurgien senior opère seul avec l'interne. C'est la règle, et ça marche.
Au final, nous sauvons beaucoup de patients très graves. Le taux de survie après RCP est d'environ 10 %, mais pour la myocardite, il dépasse 70 %. La survie moyenne tourne autour de 50-55 %—c'est très bon, car la plupart de ces patients seraient morts sans ECMO. On estime que 95 % des chocs cardiogéniques non traités par ECMO sont fatals.
C'est important de le souligner : sans ECMO, ces patients décèdent. C'est une procédure de sauvetage immédiat. Le pronostic à long terme reste incertain, mais l'alternative, elle, est presque certaine : le décès. C’est exact.