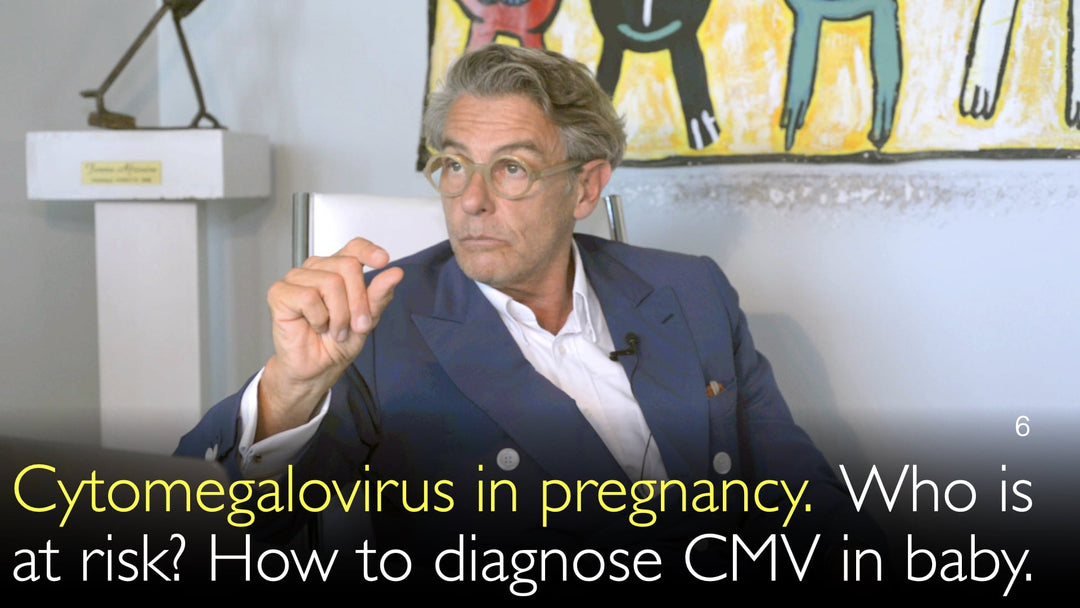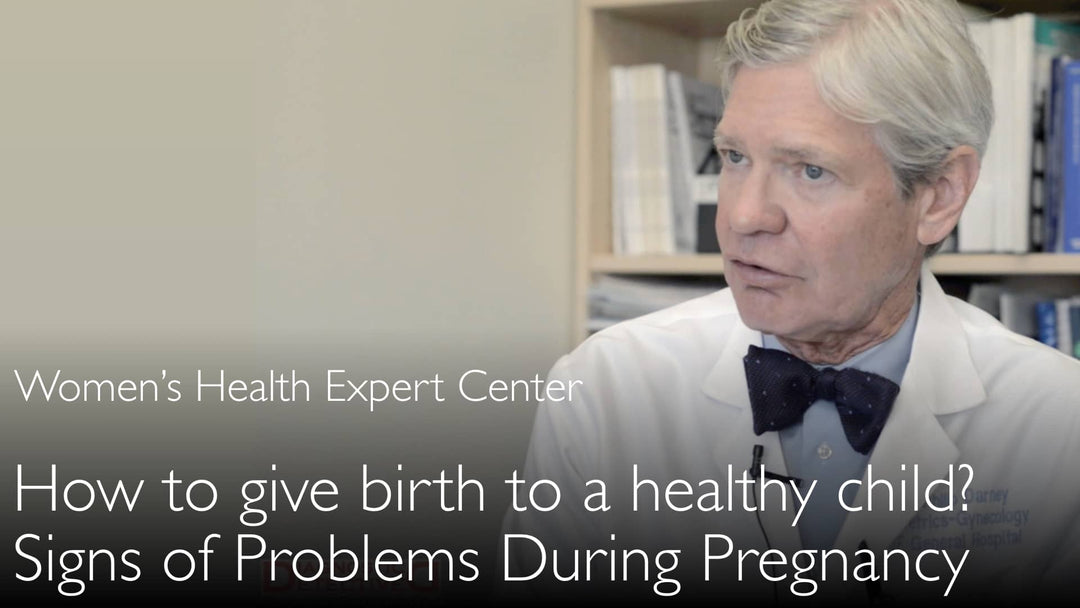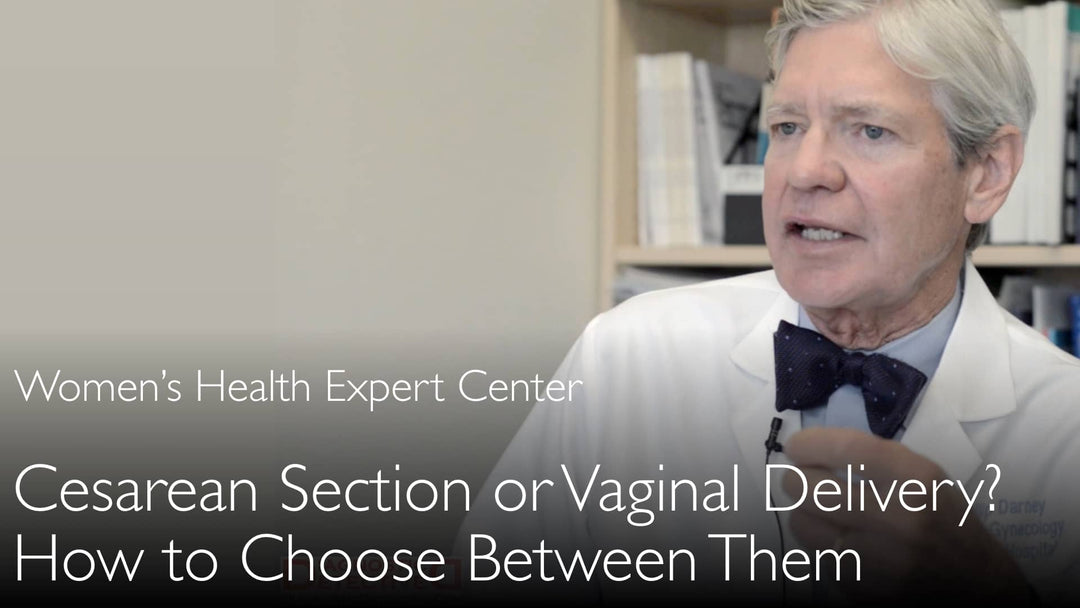Le Dr Yves Ville, MD, spécialiste renommé en médecine materno-fœtale, expose les risques associés au cytomégalovirus (CMV) durant la grossesse. Il décrit le mode de transmission du virus et propose une stratégie de dépistage précise. Selon lui, certaines femmes enceintes présentent un risque d’infection pouvant atteindre 10 %. Il recommande un sérodiagnostic au premier trimestre afin de détecter les infections primaires récentes. Un traitement antiviral à base de valaciclovir pourrait réduire le risque de transmission au fœtus, le faisant passer de 30 % à 10 %. Le Dr Ville évoque également les méthodes diagnostiques telles que la biopsie du trophoblaste (CVS) et l’amniocentèse pour confirmer une infection fœtale.
Cytomégalovirus pendant la grossesse : Facteurs de risque, dépistage et prévention
Aller à la section
- Profil de patiente à haut risque de cytomégalovirus
- Transmission du CMV et prévention primaire vaine
- Prévention secondaire du CMV par traitement antiviral
- Controverse et recommandations sur le dépistage du CMV
- Différences entre infection primaire et non primaire à CMV
- Démarche pratique de dépistage et diagnostic du CMV
- Transcript intégral
Profil de patiente à haut risque de cytomégalovirus
Le Dr Yves Ville, MD, identifie un profil spécifique à haut risque d’infection primaire à cytomégalovirus. Il s’agit généralement d’une jeune femme de niveau socio-économique élevé, ayant un premier enfant âgé de deux ou trois ans. Celui-ci fréquente souvent une crèche tandis que la mère travaille.
Selon le Dr Ville, ce profil présente un risque prospectif de 10 % de contracter le CMV lors d’une deuxième grossesse, ce qui représente un niveau de risque exceptionnel en médecine périnatale. Pourtant, aucun pays ne recommande actuellement un dépistage universel du CMV pendant la grossesse.
Transmission du CMV et prévention primaire vaine
Le cytomégalovirus se transmet par les liquides biologiques d’enfants infectés. Le Dr Yves Ville précise que le virus est présent dans les larmes, la salive, les urines et les selles. Environ 80 % des enfants en crèche excrètent le CMV dans leurs urines.
Ces enfants peuvent excréter le virus pendant deux à quatre ans, ce qui rend son évitement quasiment impossible. Même des mesures d’hygiène rigoureuses s’avèrent souvent insuffisantes. Le Dr Ville qualifie la prévention primaire de « vaine », car les conjoints peuvent également être infectés et transmettre le virus à la femme enceinte.
Prévention secondaire du CMV par traitement antiviral
La prévention secondaire offre des bénéfices significatifs. Le Dr Yves Ville souligne qu’un dépistage précoce permet d’identifier les infections primaires récentes. Un traitement par valaciclovir peut alors réduire considérablement le risque de transmission.
Sans intervention, le taux de transmission fœtale pour une infection primaire à CMV est d’environ 30 %. Le valaciclovir divise ce risque par trois, le ramenant à environ 10 %. Cette réduction substantielle plaide en faveur de programmes de dépistage précoce du CMV.
Controverse et recommandations sur le dépistage du CMV
Le Dr Yves Ville aborde la controverse persistante autour du dépistage du cytomégalovirus. Les autorités sanitaires craignent souvent de générer une anxiété inutile chez les femmes enceintes. Cependant, le Dr Ville estime que les femmes bien informées, notamment dans les catégories à haut risque, souhaitent cette information.
Le défi vient des études obsolètes qui encombrent la littérature. Le Dr Ville affirme que les travaux de plus de quatre ans doivent être écartés en raison de méthodologies imprécises. Les comités de santé s’appuient souvent sur ces données anciennes, ce qui freine l’adoption de recommandations modernes malgré les avancées récentes.
Différences entre infection primaire et non primaire à CMV
L’infection à cytomégalovirus se distingue d’autres infections périnatales comme la toxoplasmose. Le Dr Yves Ville explique que les femmes peuvent présenter des infections non primaires à CMV malgré une immunité préexistante. Les facteurs de risque diffèrent significativement entre infections primaires et non primaires.
L’infection primaire est fortement corrélée à la présence d’un enfant en crèche. L’infection non primaire semble liée à la promiscuité et aux contacts étroits avec plusieurs enfants. L’épidémiologie varie selon les pays : en Chine et au Vietnam, où près de 100 % de la population est immune, on observe tout de même 1 à 4,3 % de naissances avec infection congénitale à CMV suite à des infections maternelles non primaires.
Démarche pratique de dépistage et diagnostic du CMV
Le Dr Yves Ville propose une démarche claire pour le dépistage du cytomégalovirus. Les femmes projetant une grossesse ou déjà enceintes avec un autre enfant devraient demander une sérologie CMV (IgG/IgM). Un résultat négatif indique l’absence d’infection antérieure et impose une hygiène rigoureuse au premier trimestre, avec un contrôle à 15 semaines.
Si les IgG et IgM sont positifs, des tests d’avidité des IgG permettent de dater l’infection. Les infections survenues dans les trois mois doivent être considérées à haut risque. Le Dr Ville recommande un traitement par valaciclovir et soit une biopsie de trophoblaste à 13-14 semaines, soit une amniocentèse à 16-17 semaines pour un diagnostic définitif. Il privilégie la biopsie de trophoblaste, qui apporte une certitude sur le statut infectieux dès le premier trimestre.
Transcript intégral
Dr Anton Titov, MD : Comment les femmes enceintes contractent-elles généralement le cytomégalovirus ? Comment suspecte-t-on habituellement une infection à cytomégalovirus en première intention ?
Dr Yves Ville, MD : Exact. Comme je l’ai mentionné, il existe deux types d’infection à cytomégalovirus : non primaire et primaire. Ce que nous connaissons parfaitement, c’est l’infection primaire. Son profil type est une jeune femme de niveau socio-économique élevé, dont le premier enfant a deux ou trois ans. Habituellement, cet enfant est en crèche parce que la mère travaille.
C’est le profil type ; 99 % des cas de cytomégalovirus correspondent à cela. C’est une population à très haut risque : prospectivement, lorsqu’elles entament une deuxième grossesse, ces femmes ont un risque de 10 % de contracter le cytomégalovirus. Aucun autre risque n’est aussi élevé en médecine périnatale. Pourtant, aucun pays au monde ne préconise le dépistage du CMV.
Même si ce profil est connu, et que le CMV circule en crèche. Elles sont infectées par leurs enfants. Le virus est partout chez le bébé : dans les larmes, la salive, les urines, les selles. Il est donc très difficile d’éviter le contact, même avec des précautions.
Parfois, elles sont très prudentes elles-mêmes et demandent au conjoint de s’occuper des changes. Si celui-ci n’est pas immun, il attrape le CMV et contamine alors la mère. La prévention primaire est donc vaine.
Ce qui a été démontré récemment, c’est que la prévention secondaire est efficace. Si on dépiste précocement et qu’on identifie une infection primaire récente, on administre du valaciclovir—que j’ai mentionné pour traiter les fœtus infectés—à la mère, et on réduit le risque de transmission d’un facteur trois. Au lieu de 30 %, on descend à 10 %. C’est un argument supplémentaire, ces derniers mois ou années, pour préconiser le dépistage.
Mais quand on préconise le dépistage pendant la grossesse, surtout récemment, cela suscite des controverses. « Vous allez inquiéter les femmes pour rien. » Si j’ai 35 ans, je suis bien éduquée et aisée, j’ai mon premier bébé en crèche, je veux savoir si j’ai un risque de 10 % d’attraper cette infection grave, je pense.
Dr Anton Titov, MD : Quelle est la bonne approche pour le cytomégalovirus ? Faut-il dépister régulièrement les enfants, le premier enfant, le conjoint, ou seulement la femme enceinte ?
Dr Yves Ville, MD : Seule la femme enceinte nécessite un dépistage. L’enfant aura ce virus. 80 % des enfants en crèche excrètent le CMV dans leurs urines. 80 %. Et lorsqu’ils excrètent le CMV, c’est pendant 2, 3, 4 ans. Il est inutile de les dépister. Seule la femme enceinte nécessite un dépistage.
L’effort porte sur le premier trimestre. La grande avancée est que nous avons montré qu’après le premier trimestre, le CMV n’a plus d’importance. Notre programme de recherche se concentre actuellement sur l’infection non primaire, car il n’existe encore aucun marqueur fiable. C’est difficile pour les femmes enceintes, donc c’est important.
Dr Anton Titov, MD : Existe-t-il une possibilité que cela soit inclus dans des recommandations de dépistage ?
Dr Yves Ville, MD : Nous militons pour cela depuis des années. La dernière proposition de dépistage remonte à deux ans, et elle n’a pas été acceptée par les autorités sanitaires. Je pense que c’est une grave erreur aujourd’hui. Mais les choses évoluent très vite.
Quand on interroge les autorités, elles convoquent des comités indépendants. Ensuite, ils consultent la littérature. Et la littérature sur le CMV—on peut jeter à la poubelle tout ce qui a plus de quatre ans. Car tout ce qui est plus ancien est inexact, ça mélange tout.
Donc la littérature est polluée par les anciennes études. Et pourtant, ces comités ne veulent pas examiner uniquement les recherches récentes, car ils ont besoin d’une vision plus large. Surtout qu’ils ne connaissent souvent rien au problème du CMV. Donc c’est sans espoir.
Dr Anton Titov, MD : Donc le cytomégalovirus peut survenir à nouveau, ce qui pourrait être une infection secondaire. C’est différent de la toxoplasmose qui, si on l’a déjà eue, ne se contracte plus.
Dr Yves Ville, MD : Exactement. On peut avoir une infection non primaire à CMV. Les facteurs de risque ne sont pas les mêmes. Ils doivent probablement être analysés pays par pays.
Par exemple, en Chine, au Vietnam, en Inde, la proportion de bébés nés infectés est d’environ 1 à 4,3 %. La même chose qu’en France, par exemple. Mais là-bas, presque toutes ces infections sont non primaires, car la population est immune à presque 100 %. Pourtant, le taux d’infection à la naissance est le même.
Alors qu’en France, en Hollande, en Grande-Bretagne, c’est environ moitié-moitié. Donc, pour ces pays, c’est différent. Nous menons actuellement un programme avec le Vietnam. Nous devons trouver des marqueurs qui permettent d’identifier précocement une infection non primaire pendant la grossesse.
Que ce soit une infection primaire ou non primaire, le problème clinique se situe en début de grossesse, pas après. Donc nous progressons. Toutes ces avancées ont eu lieu dans les trois ou quatre dernières années.
Dr Anton Titov, MD : Donc si une femme enceinte ou qui planifie une grossesse et a déjà un enfant regarde cette conversation, que devrait-elle faire ?
Dr Yves Ville, MD : Elle devrait demander une sérologie CMV (IgG/IgM). Si sa sérologie est négative—pas d’IgM, pas d’IgG—elle devrait être prudente pendant les trois premiers mois. Ensuite, contrôler vers 15 semaines. Si elle est toujours négative, elle n’a pas à s’inquiéter. Le CMV peut survenir, mais ce n’est plus un problème.
Au premier trimestre, si on trouve à la fois des IgG et des IgM—pas des IgM seules, qui ne signifient rien—, cela indique une infection récente. On peut affiner avec un test d’avidité des IgG, qui distingue les anciens anticorps des jeunes.
L’avidité des IgG vous dira si l’infection s’est produite il y a plus de trois mois ou moins. Si c’était il y a moins de trois mois, elle doit être considérée à haut risque. Elle doit être mise sous valaciclovir.
Elle pourrait alors bénéficier soit d’un prélèvement de villosités choriales (PVC) à 13 semaines, soit d’une amniocentèse à 16 ou 17 semaines. Je recommande personnellement de faire cet examen plus tôt, vers 13-14 semaines, car si le PVC est négatif à ce stade, on est certain qu’il n’y a aucun risque pour l’embryon.
Si une amniocentèse à 17 semaines est positive, on ignore si l’infection vient de survenir ou si elle date d’avant 14 semaines. Cette incertitude dure un mois. Je préfère donc avoir une certitude dès la fin du premier trimestre. Et si le PVC est positif, on instaure à nouveau un traitement antiviral.
Dr Anton Titov, MD : Que se passe-t-il si les résultats reviennent positifs pour les IgG mais pas pour les IgM ?
Dr Yves Ville, MD : Cela signifie qu’elle était immunisée avant la grossesse. En théorie, elle est donc exposée à une infection non primaire. Mais dans les infections non primaires, les facteurs de risque ne sont pas les mêmes. Cela n’est pas associé, par exemple, au premier enfant en crèche.
Très probablement, l’infection non primaire résulte d’une contamination par promiscuité. Nous avons constaté chez ces femmes, quand on examine leur mode de vie, qu’elles sont beaucoup plus proches de nombreux enfants et de nombreuses personnes au sein d’un même foyer. La promiscuité est donc probablement un facteur de risque majeur pour l’infection non primaire, du moins en France.
Mais cela doit être étudié épidémiologiquement dans chaque pays, car nous connaissons encore mal les infections non primaires.