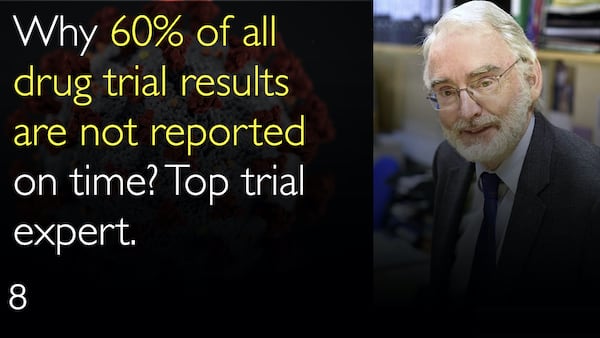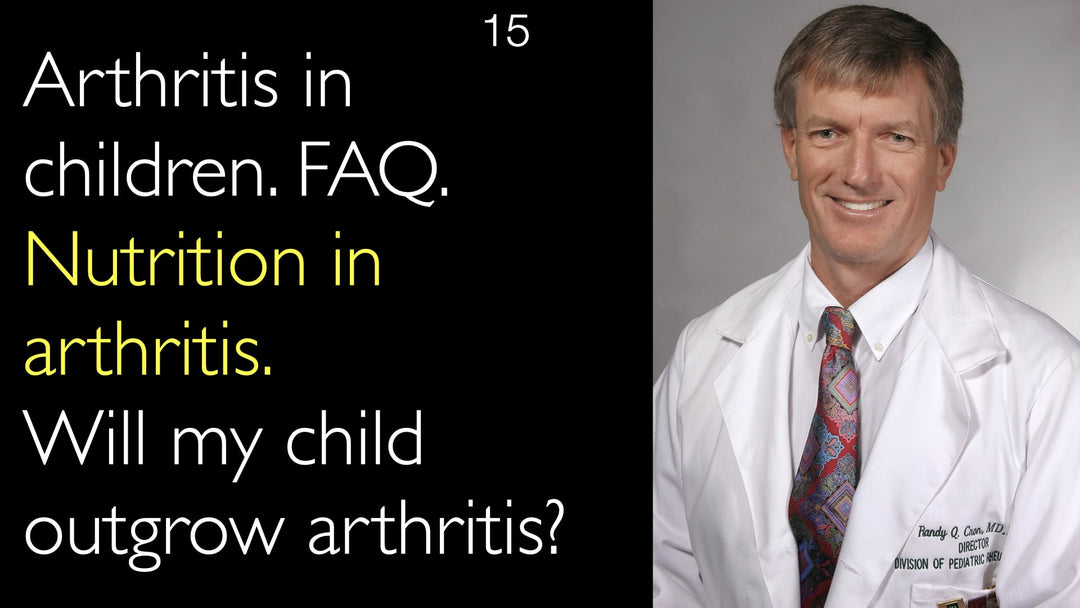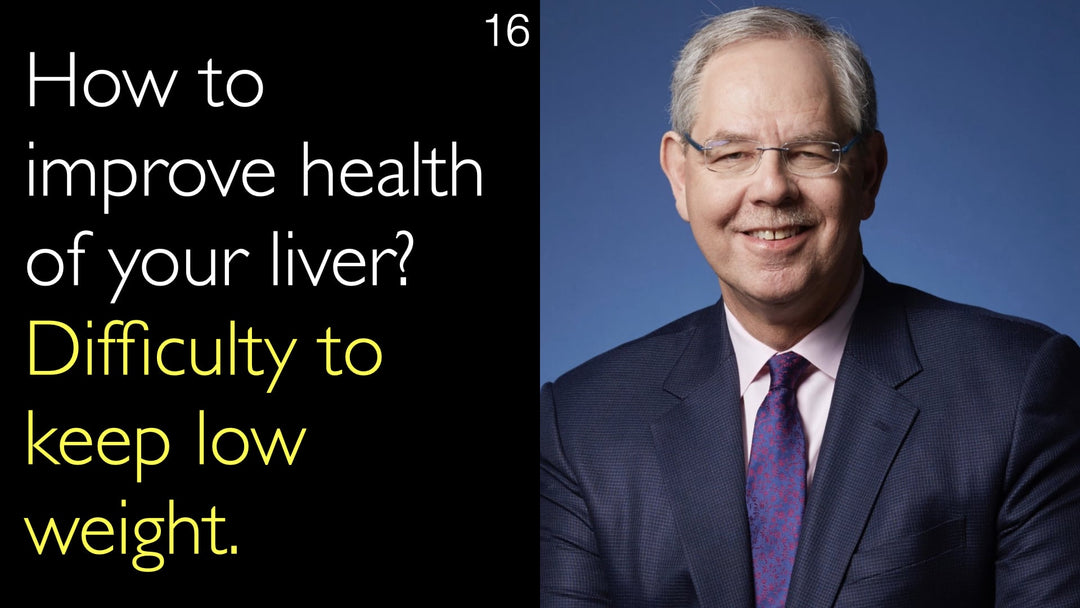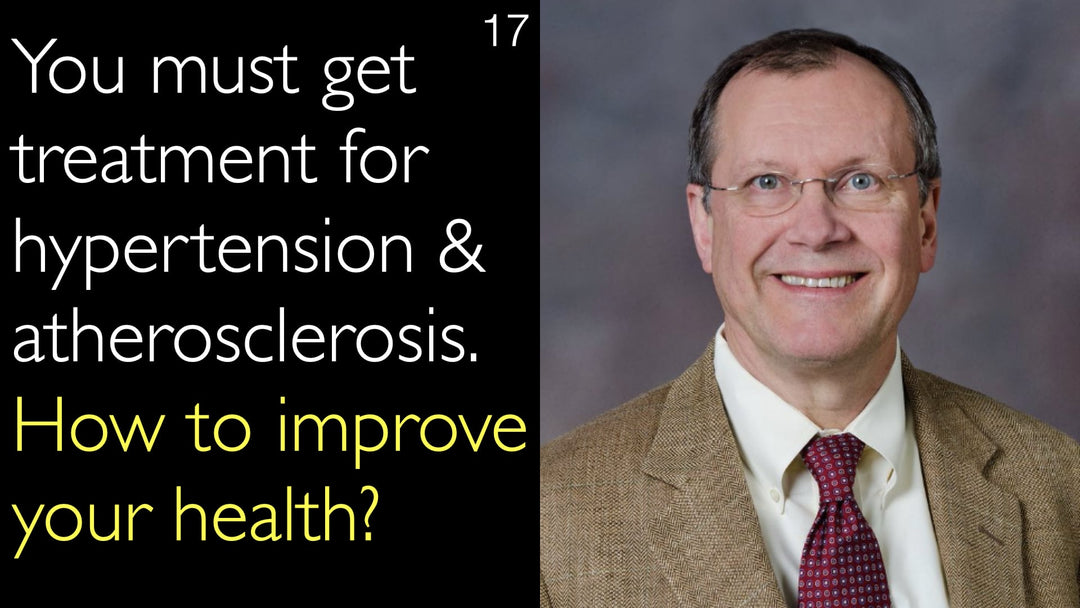Le Dr Stephen Evans, MD, expert de renom en essais cliniques et pharmacoépidémiologie, aborde la question cruciale du biais de publication dans la recherche médicale. Il explique pourquoi 60 % des résultats d’essais cliniques ne sont pas publiés dans les délais. Le Dr Evans évoque la tendance systémique à ne rendre publics que les résultats extrêmement positifs ou négatifs. Il souligne que l’enregistrement des essais, bien qu’utile, ne suffit pas à éliminer le risque de manipulation des données. L’entretien met en lumière l’obligation éthique de publier l’ensemble des résultats, essentielle pour la sécurité des patients et l’intégrité scientifique.
Comprendre le biais de publication et les résultats non rapportés dans les essais cliniques
Aller à la section
- L'ampleur du problème du biais de publication
- Obligation éthique dans la communication des essais cliniques
- L'enregistrement des essais comme solution partielle
- Influence des médias sur la diffusion des résultats
- Risques de manipulation des données et de sélection biaisée
- Transcription intégrale
L'ampleur du problème du biais de publication
Dès le début de son entretien avec le Dr Anton Titov, le Dr Stephen Evans avance un chiffre alarmant : seulement 40 % des résultats d'essais cliniques sont publiés dans les délais légaux, et près de 30 % ne sont jamais rendus publics. Cette lacune prive médecins et chercheurs d'une base de données médicales complète.
Ce phénomène, appelé biais de publication, fausse la littérature scientifique en occultant certains effets des traitements. Il ne concerne pas uniquement les traitements contre la COVID-19, mais tous les domaines de la médecine, qu'ils fassent appel ou non à des médicaments.
Obligation éthique dans la communication des essais cliniques
Le Dr Stephen Evans souligne le devoir éthique envers le public et les participants. Les patients qui se portent volontaires prennent des risques pour faire avancer la science et aider les futurs malades. Il est donc impératif d'analyser correctement les données et de communiquer les résultats une fois l'essai terminé.
Ne pas publier ces résultats trahit la confiance des participants et gaspille leur contribution. Cela peut aussi conduire à administrer à d'autres patients des traitements dont les risques et bénéfices sont mal évalués. Le Dr Anton Titov rappelle qu'il s'agit d'un enjeu crucial de la recherche médicale moderne.
L'enregistrement des essais comme solution partielle
Pour lutter contre le biais de publication, l'enregistrement préalable des essais randomisés est une stratégie clé. Le Dr Stephen Evans explique que cela crée un registre public de l'existence de l'étude et de ses objectifs, ce qui dissuade de passer sous silence les résultats négatifs ou neutres.
L'enregistrement permet aux organismes de surveillance et aux chercheurs de demander des comptes aux investigateurs. Bien que ce système améliore la transparence, le Dr Evans précise qu'il n'est pas infaillible : certains trouvent encore le moyen de contourner l'esprit de la règle.
Influence des médias sur la diffusion des résultats
Le Dr Stephen Evans et le Dr Anton Titov évoquent le rôle déterminant de l'intérêt médiatique. Le Dr Evans observe que tout le monde, y compris les rédacteurs en chef, « aime les titres accrocheurs ». La publication favorise donc ce qu'il appelle les « très bonnes ou très mauvaises nouvelles ».
Les résultats très positifs ou les signalements d'effets indésirables graves sont considérés comme dignes d'intérêt. En revanche, les conclusions neutres ou négatives — comme l'inefficacité avérée de l'hydroxychloroquine — suscitent moins d'enthousiasme. Cette dynamique médiatique influence tant la publication que la perception des preuves scientifiques.
Risques de manipulation des données et de sélection biaisée
Même avec l'enregistrement des essais, le risque de manipulation persiste. Le Dr Stephen Evans décrit comment les investigateurs peuvent « sélectionner de manière biaisée » les résultats les plus frappants, même s'ils ne correspondent pas aux critères prédéfinis. Il cite un adage connu : « On peut torturer les données jusqu'à ce qu'elles avouent ».
Statistiquement, la variabilité des résultats permet presque toujours de trouver un aspect intéressant en fouillant les données. Cette pratique favorise la publication de résultats extrêmes — très positifs ou très négatifs —, tandis que les nuances restent dans l'ombre. Cela altère la base de preuves sur laquelle repose la pratique clinique.
Transcription intégrale
Dr Anton Titov, MD : Parlons de la publication et de la diffusion des résultats des essais cliniques. L'industrie pharmaceutique est la plus rentable, pourtant seuls 40 % des essais respectent les délais légaux de publication, et 30 % ne sont jamais communiqués.
N'y a-t-il pas une obligation envers le public et les participants d'analyser et de rendre publics les résultats une fois l'essai terminé ? Pourquoi tant de résultats ne sont-ils pas divulgués ?
Dr Stephen Evans, MD : La question est essentielle. Elle ne concerne pas que la COVID-19, mais tous les types de traitements, médicamenteux ou non. Nous avons beaucoup œuvré pour prévenir ce biais de publication, notamment en veillant à l'enregistrement préalable des essais randomisés.
Au moins peut-on alors contacter les responsables pour obtenir des réponses. Le problème, c'est que nous aimons tous les titres chocs. Nous aimons les bonnes nouvelles — ou les mauvaises, si l'on est journaliste ou chargé de surveiller les effets indésirables.
La publication privilégie donc les très bonnes ou très mauvaises nouvelles. Les résultats neutres n'intéressent personne ; les rédacteurs ne peuvent en tirer de titre accrocheur.
Annoncer que l'hydroxychloroquine est inefficace est généralement peu attrayant, alors que suggérer son efficacité suscite l'engouement. Heureusement, grâce à notre vigilance, même une étude négative peut être publiée si elle est pertinente. Mais le problème général demeure.
L'enregistrement des essais atténue partiellement le biais de publication. Reste que certains parviennent encore à manipuler leurs résultats et à privilégier ceux qui sont les plus flatteurs, même lorsque l'essai avait préalablement défini des critères précis.
Ce n'est pas intéressant ? Qu'importe : ils mettront en avant un autre critère, plus séduisant. Tout statisticien le sait : la variabilité des données est un vrai piège.
On peut presque toujours y déceler quelque chose d'intéressant si on les malmène assez — « on les torture jusqu'à ce qu'elles avouent », comme on dit.
On a tendance à privilégier les résultats extrêmes, qu'ils soient très bons ou très mauvais. Cela se voit dans les journaux : les bonnes et mauvaises nouvelles, si elles sont dramatisées, se vendent bien.
Les résultats intermédiaires et neutres intéressent moins les médias. Pourtant, la science a besoin de ces résultats sans relief pour avoir une vision juste de l'ensemble des preuves.
L'enregistrement des essais y contribue grandement. Mais même ainsi, certains investigateurs biaisent leur sélection pour ne publier que ce qui montre un effet — bon ou mauvais, pourvu que ce soit frappant.
On observe cela dans plusieurs domaines médicaux : les résultats publiés tendent vers les extrêmes, et la vérité, souvent plus nuancée, reste inédite.