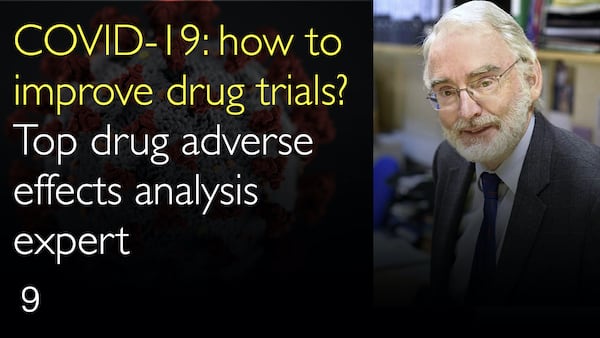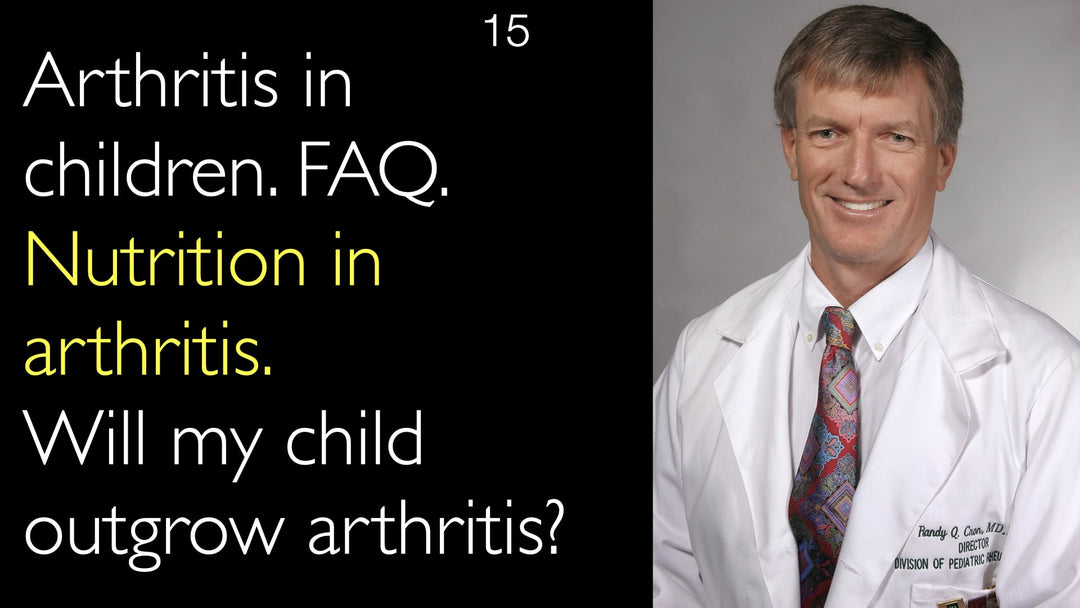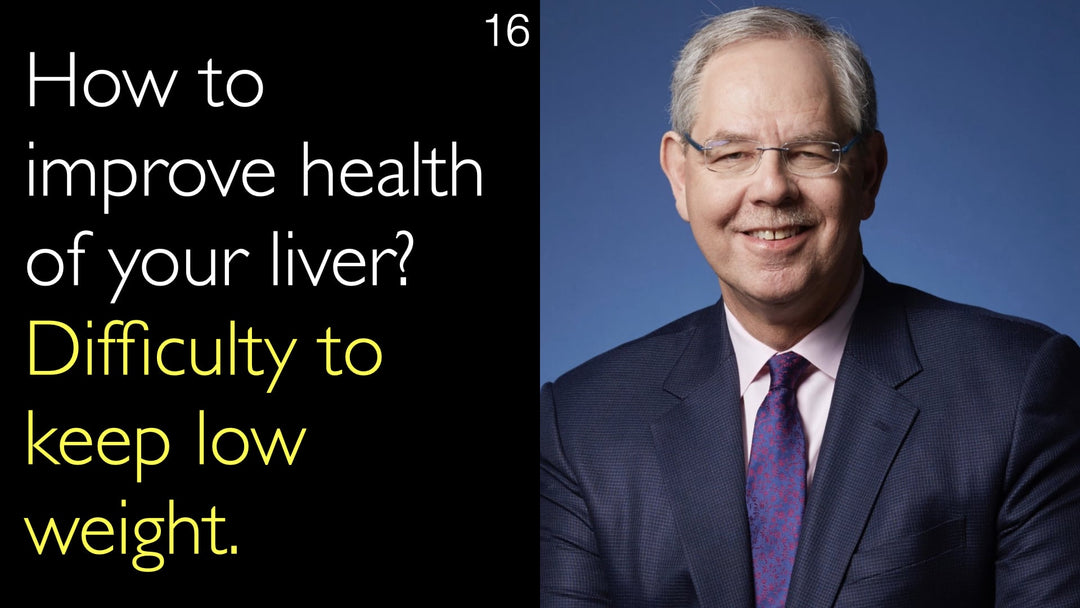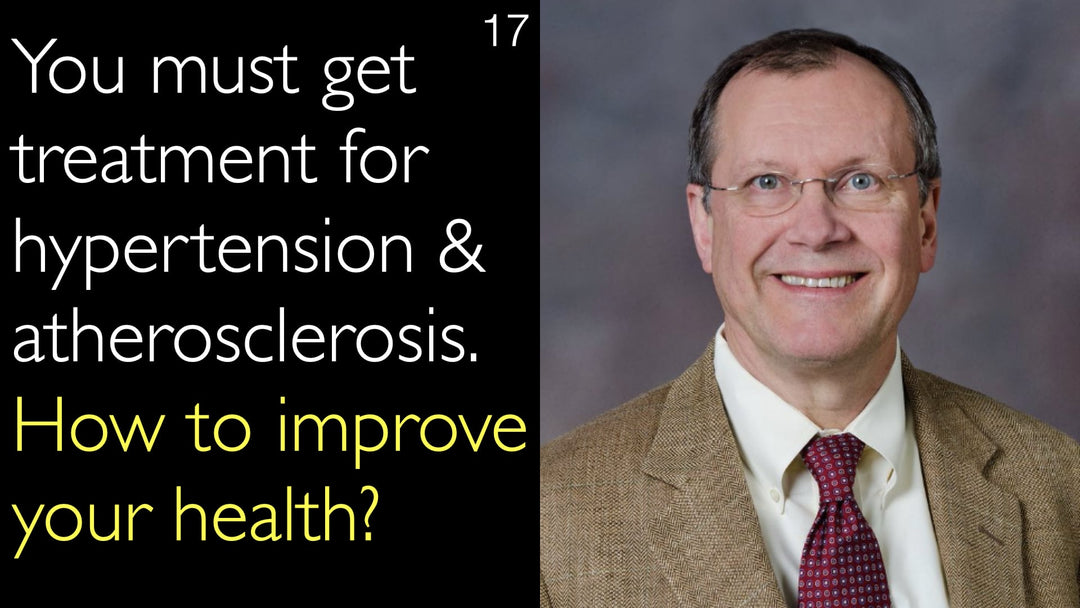Le Dr Stephen Evans, MD, expert de renom en analyse des effets indésirables des médicaments, explique pourquoi les essais cliniques échouent souvent à répondre aux besoins des patients. Il pointe des lacunes majeures, notamment des échantillons trop restreints et une vision à court terme. Le Dr Evans plaide pour une réforme réglementaire visant à simplifier et généraliser les essais randomisés. Il insiste sur la nécessité d’un financement public pour garantir des résultats impartiaux et robustes, permettant une comparaison fiable des traitements.
Améliorer la conception des essais cliniques pour de meilleurs résultats patients
Aller à la section
- Problèmes courants des essais cliniques
- Le problème de la petite taille des essais
- Financement et biais dans les essais
- Obstacles réglementaires à la randomisation
- Besoins d'essais comparatifs de traitements
- Transcription intégrale
Problèmes courants des essais cliniques
Le Dr Stephen Evans, MD, relève plusieurs défauts majeurs dans la conception actuelle des essais cliniques. L’un des principaux problèmes est l’absence d’analyse des résultats sur les échelles de temps les plus pertinentes. Prenant l’exemple de la chirurgie, il note qu’une focalisation exclusive sur les résultats à court terme — comme les trois premiers jours — suggérerait à tort que toute intervention est dangereuse en raison des risques de mortalité opératoire.
De nombreux essais ne mesurent ni les bénéfices à long terme ni les effets indésirables qui peuvent apparaître avec le temps. Cette vision à courte vue peut masquer la valeur réelle et le profil de sécurité d’un traitement. Le Dr Evans souligne également que la notification sélective et l’analyse biaisée sont des problèmes omniprésents qui faussent l’évaluation bénéfices-risques.
Le problème de la petite taille des essais
Pour le Dr Stephen Evans, MD, le problème le plus fréquent est que les essais cliniques sont souvent trop petits. Ces essais sous-dimensionnés échouent régulièrement à détecter un bénéfice lorsqu’il existe, et manquent tout autant de relever des preuves de préjudice, ce qui rend leurs résultats non concluants et de faible utilité.
Ce problème de taille d’échantillon insuffisante concerne les essais de médicaments, de vaccins, de chirurgie et tous les types de traitement. Le Dr Evans explique que ces études inadéquates laissent la prise de décision médicale dans l’incertitude, desservant à la fois les médecins et les patients qui ont besoin de données claires.
Financement et biais dans les essais
Le Dr Stephen Evans, MD, aborde l’influence significative des sources de financement sur les essais cliniques. Lorsque l’industrie privée assume l’intégralité du coût de la recherche clinique, une pression inhérente pousse à produire des résultats commercialement favorables. Cette réalité peut entrer en conflit avec l’objectif de générer des preuves impartiales qui bénéficient réellement aux patients.
Le Dr Evans préconise une refonte de la manière dont la recherche médicale est menée et financée. Il propose des modèles de financement partagé entre acteurs privés et publics pour réduire les biais commerciaux. Un tel changement pourrait aider à garantir que les essais répondent à des questions cliniquement pertinentes plutôt qu’à des impératifs de marché.
Obstacles réglementaires à la randomisation
Lors de son échange avec le Dr Anton Titov, MD, le Dr Evans qualifie les réglementations actuelles des essais cliniques de « scandale ». Il relève le paradoxe suivant : les médecins peuvent librement prescrire des traitements non éprouvés, comme l’hydroxychloroquine ou le remdesivir, sans aucune supervision. Mais dès qu’ils souhaitent randomiser les patients pour étudier correctement ces traitements, d’importants obstacles réglementaires surgissent.
Le Dr Stephen Evans, MD, estime que ce système est contraire à l’éthique, car il autorise un traitement non contrôlé sans générer de données valides. Il plaide pour une restructuration des réglementations, en particulier pendant les pandémies, afin de faciliter grandement la randomisation. Cela permettrait à l’expérience collective du traitement de millions de patients de contribuer significativement aux connaissances médicales.
Besoins d'essais comparatifs de traitements
Le Dr Stephen Evans, MD, met en lumière une lacune critique de la recherche clinique actuelle : le manque d’essais d’efficacité comparative. Si les entreprises pharmaceutiques mènent des essais techniquement excellents, elles les conçoivent souvent pour mettre en valeur leur produit. Il existe bien trop peu d’études comparant directement deux traitements actifs l’un à l’autre.
Cette carence laisse les médecins dans l’incertitude quant au traitement véritablement le plus efficace pour leurs patients. Le Dr Stephen Evans, MD, appelle à davantage d’essais financés sur fonds publics pour répondre à ces questions comparatives pratiques. Il souligne également la nécessité de former plus de chercheurs à mener des essais plus simples et moins complexes, susceptibles d’être déployés à large échelle.
Transcription intégrale
Dr Stephen Evans, MD: Comme nous venons de le dire, la moitié des résultats d’essais cliniques ne sont jamais publiés. L’analyse des données publiées peut être manipulée par ceux qui la réalisent.
J’ai réalisé une analyse approfondie des problèmes des essais cliniques, y compris la notification sélective des résultats. Mais quels sont, globalement, les problèmes les plus courants dans les résultats cliniques, au-delà de la notification sélective ?
Les problèmes les plus fréquents concernent les analyses qui négligent l’échelle de temps la plus pertinente. Si l’on examinait les essais chirurgicaux en ne considérant que les trois premiers jours, toute chirurgie s’arrêterait. Nous savons qu’il existe une mortalité opératoire dans certaines interventions. Certaines chirurgies présentent des taux de mortalité plus élevés autour de l’intervention que d’autres.
Mais dans presque toute chirurgie, il existe un risque de décès. Ce que l’on recherche, c’est un bénéfice à long terme. De nombreux essais ne regardent pas le long terme pour vérifier l’existence d’un réel bénéfice, et risquent de passer à côté des préjudices qui surviennent plus tard. C’est donc un problème clé.
Il reste évidemment un problème de notification sélective. Il peut aussi y avoir un biais dans l’analyse — la façon dont les gens mènent leurs analyses. Parfois, ils réalisent une analyse fine et intelligente pour mettre en évidence des bénéfices, et une analyse grossière, moins susceptible de détecter des preuves de préjudice. L’équilibre bénéfices-risques est souvent très mal évalué.
Le problème le plus fréquent, à mon avis, est que les essais sont trop petits. Ils échouent à détecter un bénéfice quand il existe, et manquent aussi de relever des preuves de préjudice. Leurs résultats restent dans le flou parce qu’ils sont sous-dimensionnés. C’est un problème pour les médicaments, les vaccins, la chirurgie, et tous les types de traitement.
Dr Anton Titov, MD: Pensez-vous que, pour atténuer ce problème des petits essais — la recherche clinique étant très coûteuse — nous devrions repenser la structure de la pratique médicale et peut-être la répartition des financements privés et publics pour les essais cliniques ? Il est clair que si l’industrie privée paie pour tous les essais, elle attend des résultats commerciaux. C’est une réalité, et les patients n’en bénéficient pas nécessairement. Comment, selon vous, l’infrastructure globale de la pratique clinique et la participation aux essais devraient-elles évoluer pour renforcer la puissance des essais cliniques ?
Dr Stephen Evans, MD: Je pense que la gouvernance des essais cliniques doit être simplifiée pour les rendre plus faciles à réaliser. Je trouve scandaleux que, pendant cette pandémie, un médecin ait pu administrer, par exemple, de l’hydroxychloroquine ou du remdesivir à des patients sans aucun contrôle — absolument aucun. Ils pouvaient agir librement.
Mais dès qu’ils veulent randomiser, toutes sortes de réglementations entrent en jeu. Je pense qu’il est contraire à l’éthique de continuer à traiter des patients sans savoir s’il y a un bénéfice, et de ne pas randomiser dans ces conditions. Mais je comprends pourquoi c’est le cas.
Les comités d’éthique et les réglementations entourant la conduite des essais ont rendu les choses difficiles. En situation de pandémie, nous devons revoir notre approche et veiller à randomiser plus facilement les patients, sans exiger tous les contrôles. Les patients et les médecins veulent agir au mieux, mais ils devraient s’assurer, ce faisant, de randomiser les patients pour que les données issues de l’expérience thérapeutique soient valides.
Actuellement, ils peuvent simplement traiter les patients. Des millions de patients ont eu la COVID-19, mais seule une petite fraction a été incluse dans des essais randomisés. Je pense donc que la réglementation doit être assouplie.
Nous devons former les gens à réaliser des essais simples. Nous devons les rendre moins complexes. Nous devons inciter les acteurs à le faire avec un financement public, ou du moins non exclusivement pharmaceutique.
Je pense que l’industrie pharmaceutique mène de très bons essais. Leur interprétation est parfois biaisée en faveur de leur entreprise, mais globalement, ils réalisent leurs essais très bien. On peut certes critiquer certaines de leurs pratiques dans les essais qu’ils mènent, et dans la façon dont les résultats sont présentés pour valoriser leur produit.
Nous manquons cruellement d’essais comparant deux traitements différents, et par conséquent, nous sommes bien plus incertains qu’il ne le faudrait sur l’efficacité comparative des médicaments.