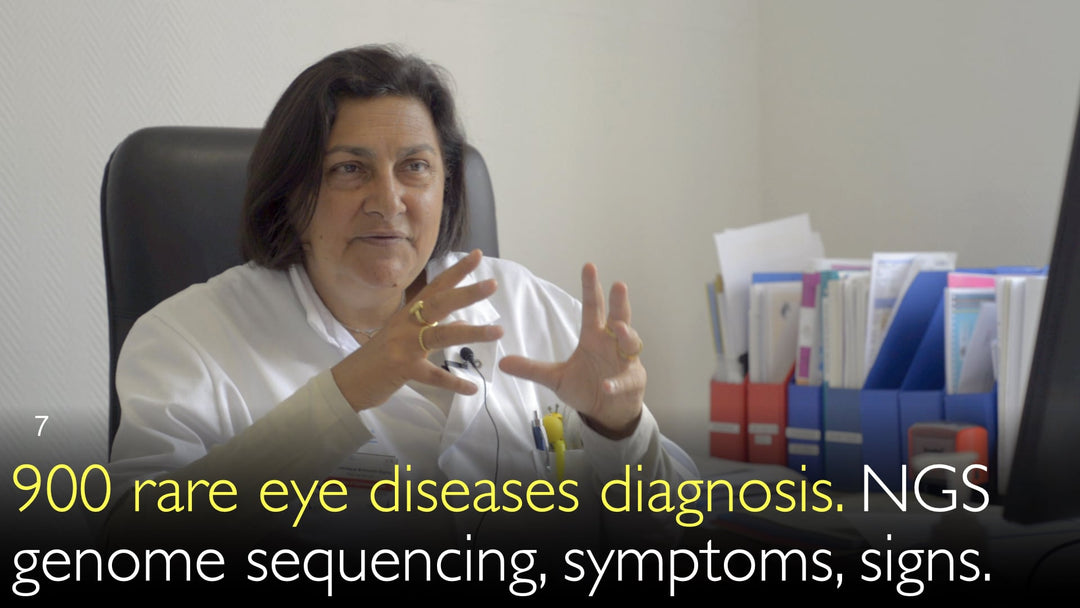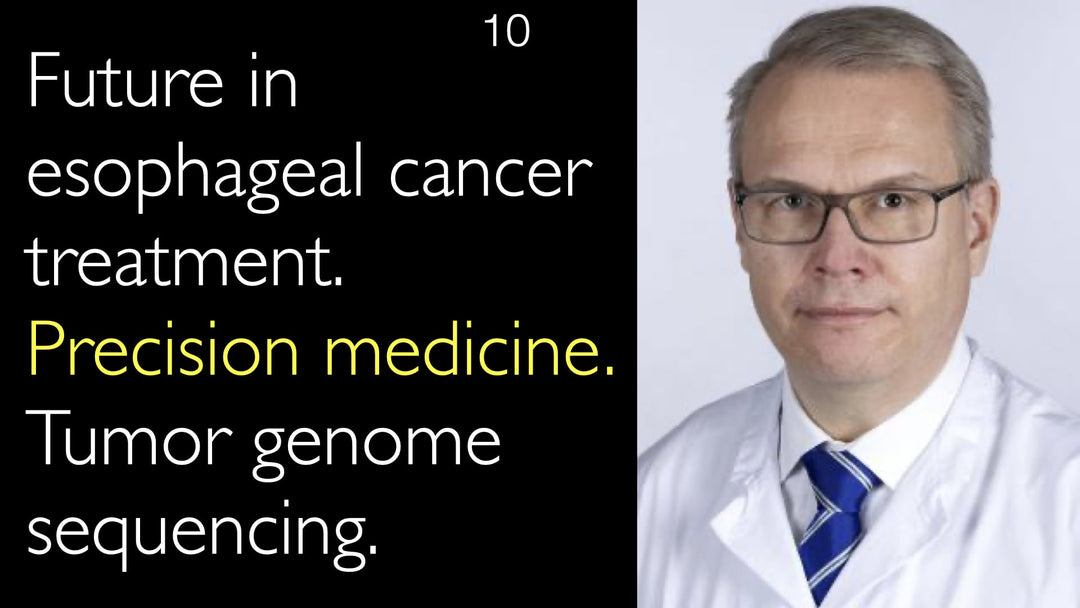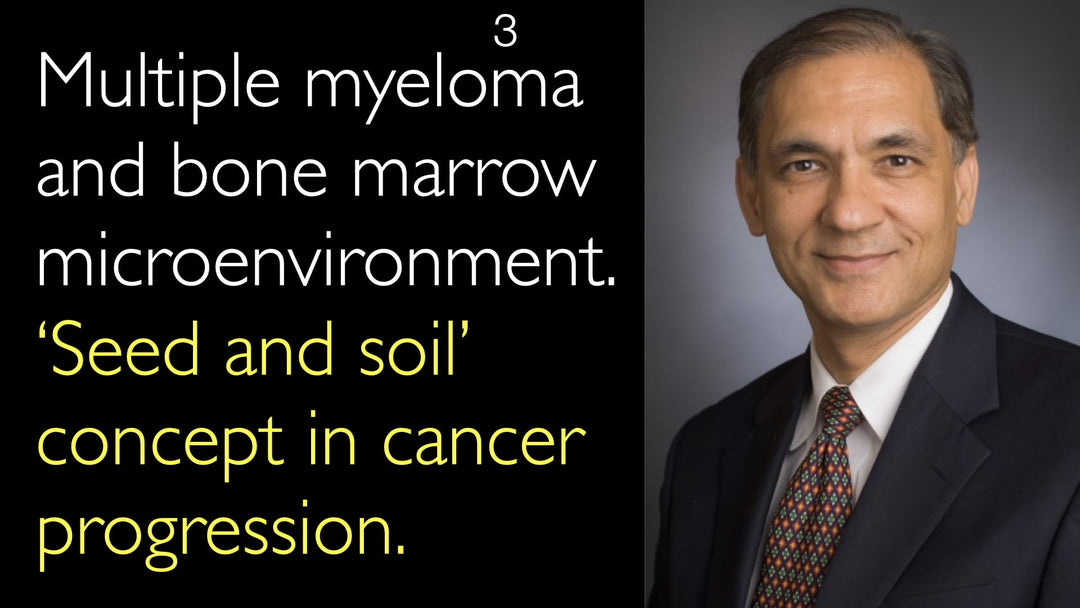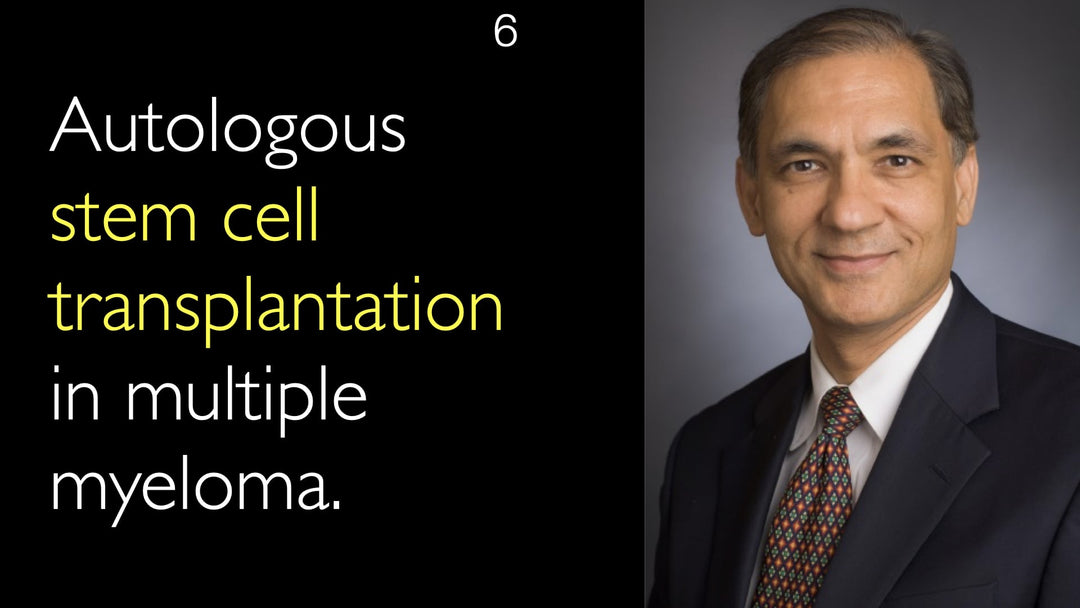Le Dr Dominique Bremond-Gignac, MD, spécialiste de renom dans les maladies oculaires rares, explique en quoi l’imagerie avancée et le séquençage génomique de nouvelle génération sont déterminants pour diagnostiquer plus de 900 affections génétiques rares de l’œil chez l’enfant et le jeune adulte. Elle décrit la démarche diagnostique, du phénotypage précis au séquençage du génome entier, en mettant en lumière le rôle des centres spécialisés et des associations de patients pour poser un diagnostic fiable et améliorer le pronostic visuel.
Diagnostic des maladies oculaires génétiques rares : imagerie avancée et séquençage du génome
Aller à la section
- Aperçu des maladies oculaires rares
- Diagnostic phénotypique et imagerie avancée
- Tests génétiques et méthodes de séquençage
- Avantages du séquençage complet du génome
- Orientation des patients et centres spécialisés
- Recommandations cliniques et rôle du patient
- Transcription intégrale
Aperçu des maladies oculaires rares
Les maladies oculaires rares constituent la principale cause de déficience visuelle et de cécité chez les enfants et les jeunes adultes. Le Dr Dominique Bremond-Gignac souligne qu’on recense plus de 900 maladies oculaires rares, dont beaucoup sont d’origine génétique. Ces pathologies couvrent un large spectre, incluant notamment la rétinite pigmentaire et diverses anomalies du développement oculaire. Leur nombre élevé rend l’établissement d’un diagnostic précis particulièrement complexe.
Diagnostic phénotypique et imagerie avancée
La première étape, et la plus cruciale, du diagnostic d’une maladie oculaire rare consiste à établir un phénotype précis, c’est-à-dire une description détaillée des symptômes et signes cliniques. Le Dr Dominique Bremond-Gignac insiste sur le fait que sans un phénotype exact, identifier la cause génétique correcte est quasiment impossible. Son centre, OPHTARA, a développé l’une des plus grandes et des plus précises plateformes d’imagerie oculaire pédiatrique au monde.
Celle-ci intègre des dispositifs spécialisés de tomographie par cohérence optique (OCT) portables et des systèmes de funduscopie rétinienne à très grand champ. Ces outils sont spécifiquement adaptés aux enfants, permettant un diagnostic plus rapide et plus aisé. Cette imagerie avancée est essentielle pour dresser un tableau clinique détaillé avant de procéder à l’analyse génétique.
Tests génétiques et méthodes de séquençage
Une fois le phénotype solidement établi, l’étape suivante est le génotypage, visant à identifier la cause génétique de la maladie oculaire rare. Ce processus implique une collaboration avec des généticiens cliniciens et moléculaires. Le test génétique initial privilégié est souvent le séquençage de nouvelle génération (NGS).
Le Dr Dominique Bremond-Gignac explique qu’un panel NGS typique pour les maladies oculaires rares analyse environ 200 gènes connus pour être impliqués. Cette méthode permet d’identifier la mutation génétique dans une proportion significative des cas, par exemple dans environ 30 % des maladies rétiniennes et jusqu’à 90 % des cas d’aniridie, souvent liés à des mutations du gène PAX6.
Avantages du séquençage complet du génome
Lorsque le test NGS ne permet pas d’établir un diagnostic, le séquençage complet du génome (WGS) constitue l’étape suivante. Le Dr Dominique Bremond-Gignac dirige une plateforme nommée Sequoia qui réalise cette analyse exhaustive. Le coût du WGS ne cesse de baisser, le rendant plus accessible.
Le WGS est puissant car il peut identifier de nouveaux gènes pathogènes et de nouvelles mutations que les panels ciblés pourraient manquer. Le Dr Bremond-Gignac cite la découverte récente de la mutation ITPR1 associée au syndrome de Gillespie, une forme d’aniridie, comme exemple de la façon dont le WGS mène à de nouvelles avancées génétiques et à une meilleure compréhension des maladies oculaires rares.
Orientation des patients et centres spécialisés
Les familles parcourent souvent une longue et frustrante odyssée diagnostique avant d’atteindre un centre de soins tertiaires spécialisé dans les maladies oculaires rares. Le Dr Dominique Bremond-Gignac indique que les patients sont généralement orientés vers son centre, mais cela ne suffit pas toujours. La collaboration avec des associations de patients, comme Aniridia Europe, est cruciale pour connecter les familles aux soins spécialisés dont elles ont besoin.
Ces associations aident à diffuser l’information et à guider les patients vers des centres experts. Le Dr Anton Titov et le Dr Bremond-Gignac soulignent combien ce réseau est vital pour garantir que les enfants présentant des problèmes de vision complexes ou non diagnostiqués trouvent enfin le bon spécialiste.
Recommandations cliniques et rôle du patient
Diffuser les connaissances sur les maladies oculaires rares est essentiel pour améliorer leur diagnostic et leur prise en charge. Le Dr Dominique Bremond-Gignac insiste sur l’importance de créer et de distribuer des recommandations cliniques à destination des médecins généralistes et des patients. Ces guides fournissent des informations critiques, comme la nécessité de prescrire des collyres sans conservateurs aux patients atteints d’aniridie.
Le Dr Anton Titov abonde dans ce sens, notant que cela s’inscrit dans une tendance vers des soins de santé davantage pilotés par le patient. Les patients informés, qui comprennent leur diagnostic et les recommandations cliniques pertinentes, peuvent devenir des partenaires actifs de leurs propres soins, en plaidant pour eux-mêmes et en veillant à recevoir le traitement spécialisé adapté.
Transcription intégrale
Les maladies oculaires rares sont la principale cause de déficience visuelle et de cécité chez les enfants et les jeunes adultes. On dénombre plus de 900 maladies oculaires rares. Beaucoup sont d’origine génétique. Elles incluent la rétinite pigmentaire et les anomalies du développement oculaire.
Dr Anton Titov : Comment utiliser les méthodes génétiques pour diagnostiquer correctement les maladies oculaires rares ? Quels tests génétiques sont employés ? Le séquençage complet du génome a-t-il un rôle à jouer ? Quand les parents doivent-ils demander un test génétique si leur enfant présente un problème de vision ?
Dr Dominique Bremond-Gignac : Excellente question concernant les maladies oculaires génétiques rares, car il est parfois très difficile d’en établir un diagnostic précis. Pourquoi ? Parce que ce sont des maladies rares. On en compte probablement autour de 1000. Leur nombre important rend le diagnostic complexe.
Il est crucial d’avoir un bon phénotype—une description des symptômes et signes de la maladie—avant de passer au génotype, c’est-à-dire la cause génétique. Sans une description précise des symptômes, on ne peut poser le bon diagnostic.
D’abord, nous devons décrire les signes de la maladie oculaire à l’aide d’une imagerie performante. Notre centre, OPHTARA, spécialisé dans les maladies oculaires rares, a développé la plus grande et la plus précise plateforme d’imagerie oculaire pédiatrique. Nous l’utilisons aussi pour les adultes, mais elle est surtout dédiée aux enfants.
L’imagerie doit être adaptée aux enfants. Nous disposons d’instruments portables, de systèmes de diagnostic faciles et rapides. Par exemple, nous avons de beaux OCT (tomographie par cohérence optique) pédiatriques portables.
Nous utilisons également une funduscopie rétinienne à très grand champ avec un système étendu. Ces outils diagnostiques sont essentiels pour établir un bon diagnostic de maladie oculaire rare. Après ce diagnostic phénotypique, nous procédons au génotypage pour identifier la cause.
Nous collaborons avec des généticiens, à la fois cliniciens et moléculaires. Je dirige une plateforme de séquençage complet du génome appelée Sequoia. Nous travaillons également avec le Professeur Sophie Valleix en génétique moléculaire.
Nous nous concentrons sur les troubles du segment antérieur de l’œil et les dysgénésies du segment antérieur, ainsi que sur les maladies rétiniennes. Nous commençons par le séquençage NGS, qui couvre généralement 200 gènes impliqués dans les maladies oculaires génétiques rares.
Si le séquençage NGS n’est pas concluant, nous passons au séquençage complet du génome via la plateforme Sequoia. C’est très spécifique. Nous tenons des réunions multidisciplinaires pour sélectionner les enfants à diagnostiquer.
Ensuite, nous utilisons la plateforme NGS, et si besoin, le séquençage complet du génome. C’est très intéressant car le NGS permet de résoudre environ 30 % des maladies rétiniennes. Pour certaines pathologies, comme l’aniridie, le taux de résolution atteint 90 %, avec des mutations PAX6 identifiées par NGS.
Mais pour d’autres maladies oculaires rares, une exploration plus large est nécessaire. Nous pouvons découvrir de nouveaux gènes impliqués et de nouvelles mutations responsables. C’est pourquoi cette approche est passionnante.
Par exemple, pour l’aniridie, nous avons identifié la mutation ITPR1 associée au syndrome de Gillespie. C’est une découverte très récente. Très intéressant.
Pour résumer, un bon phénotype, étayé par une imagerie spécifique, est essentiel pour diagnostiquer les troubles oculaires rares chez l’enfant. Ensuite, avec un phénotype solide, on peut procéder à un génotypage efficace. Le séquençage complet du génome est de plus en plus accessible, son coût ne cessant de diminuer.
Dr Anton Titov : Probablement, lorsque les parents d’enfants patients viennent dans votre centre de soins tertiaires spécialisé, ils ont déjà consulté plusieurs médecins. Soit le diagnostic de maladie oculaire n’a pas été identifié, soit les enfants ont reçu un diagnostic commun mais peut-être erroné.
Comment ces patients pédiatriques finissent-ils par vous trouver ? Est-ce l’initiative des parents ? Celle de l’ophtalmologiste ? Qu’est-ce qui arrive le plus souvent ?
Dr Dominique Bremond-Gignac : Beaucoup de patients nous sont adressés. Mais parfois, cela ne suffit pas. Nous travaillons avec des associations dédiées aux maladies oculaires rares. Cette collaboration est très importante.
Par exemple, je préside le Comité Scientifique d’Aniridia Europe et l’Association des Maladies Oculaires Rares en France. Grâce à ces associations, les patients peuvent être orientés vers les centres appropriés. Nous diffusons ainsi l’information.
Il est également crucial d’élaborer des recommandations cliniques sur les maladies oculaires rares. Celles-ci sont utiles aux médecins généralistes et aux patients. Par exemple, pour l’aniridie, il faut utiliser des collyres sans conservateurs. Ce n’est pas toujours évident pour un généraliste. En consultant les recommandations, il peut le savoir.
Ensuite, il peut orienter le patient vers un centre spécialisé comme OPHTARA. Au moins, il dispose d’une connaissance de base sur ces maladies rares, ce qui est précieux. La diffusion de l’information sur les maladies oculaires génétiques rares est donc primordiale.
C’est une santé pilotée par le patient, car ce sont eux qui sont ultimement responsables de leur santé. Même s’il est parfois tentant de déléguer cette responsabilité au médecin. Un patient devrait consulter les recommandations cliniques pertinentes pour sa pathologie. Exactement.