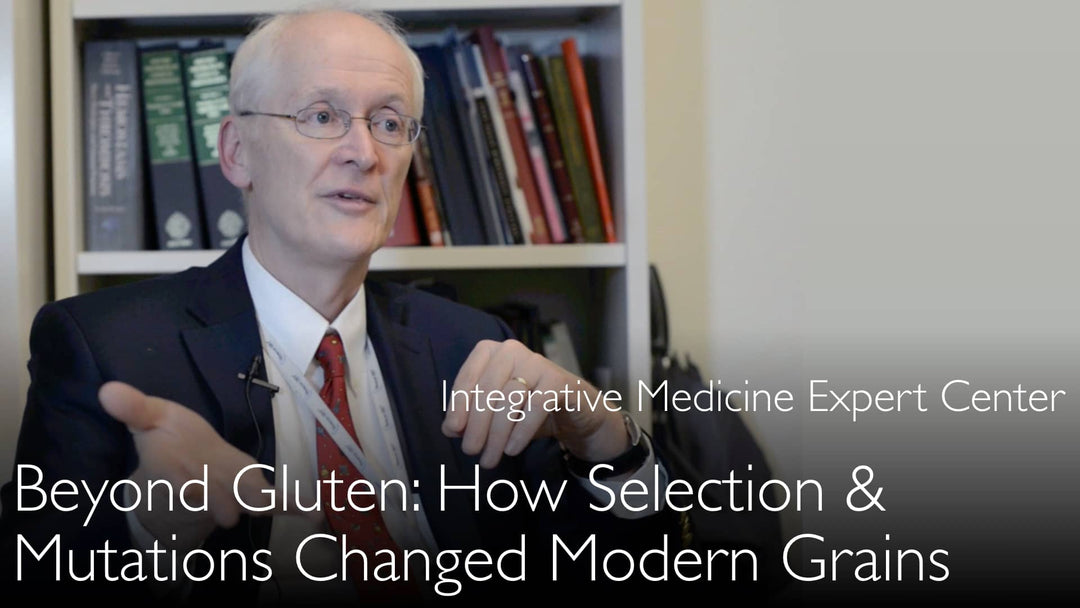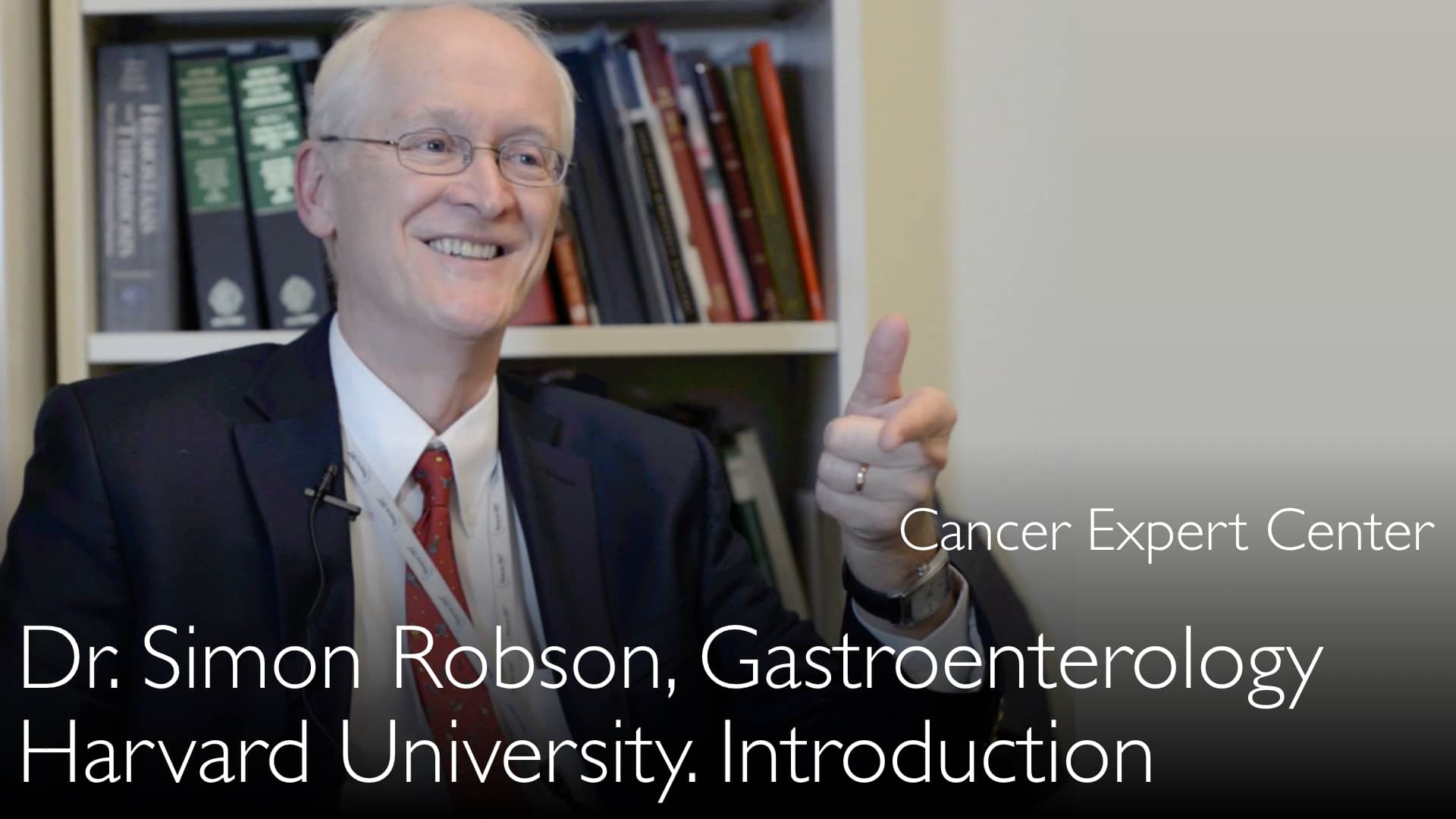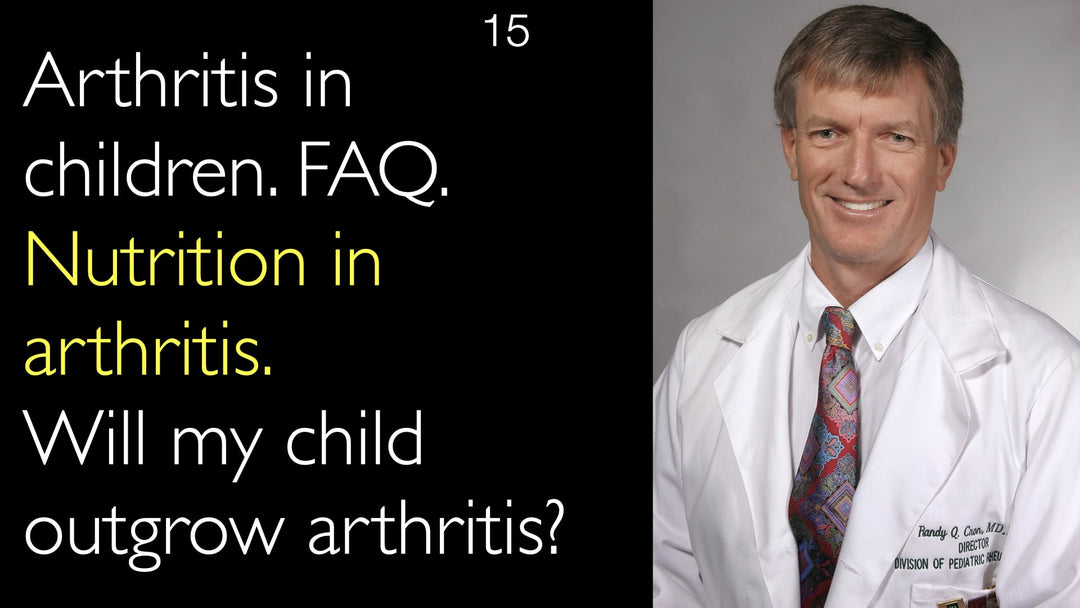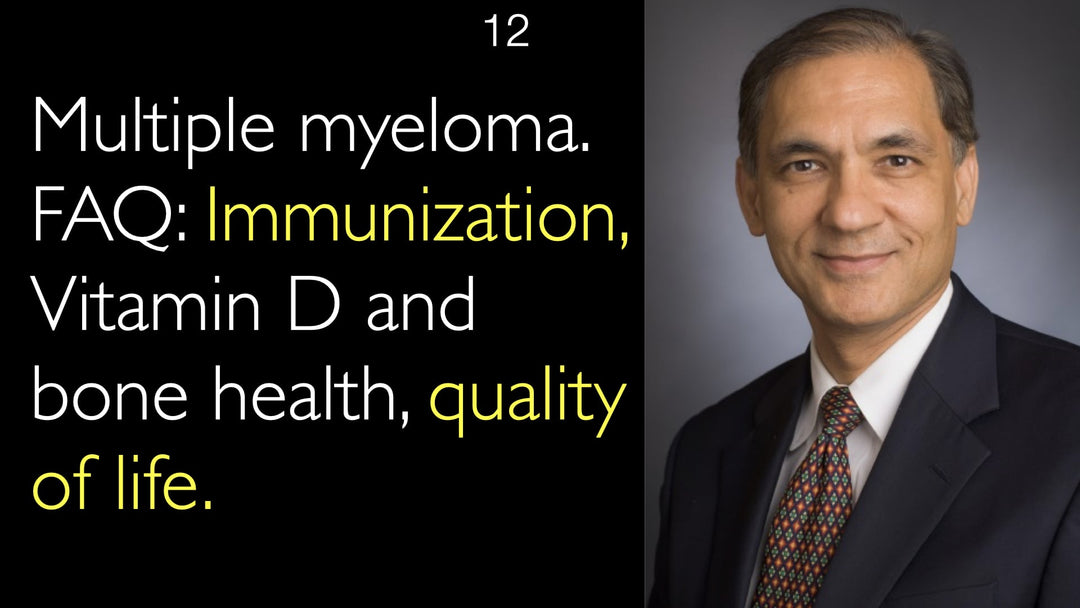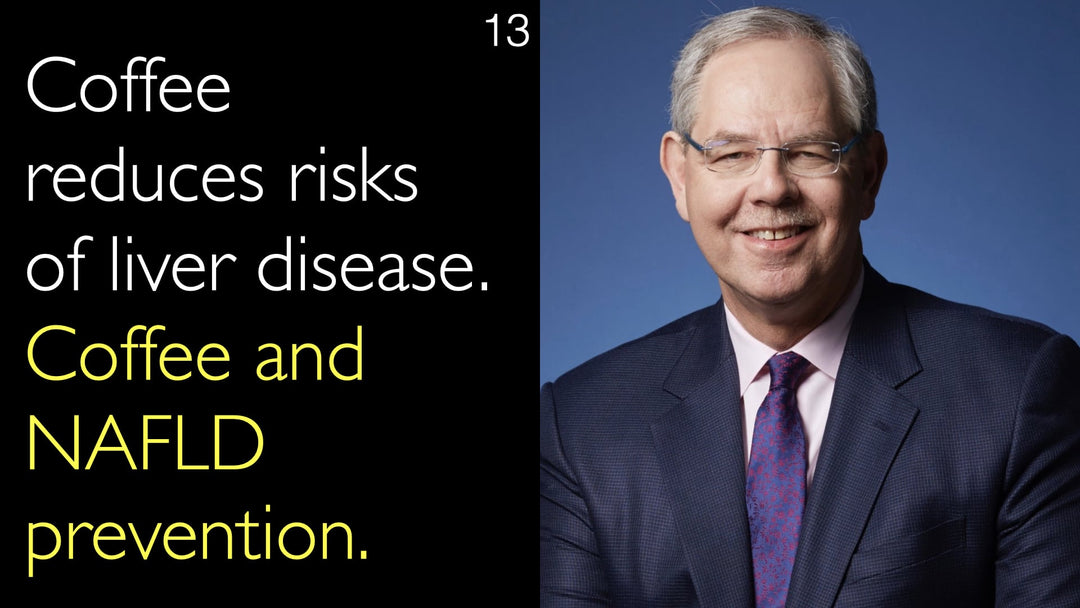Le Dr Simon Robson, MD, expert de premier plan en gastro-entérologie et maladies hépatiques, explique comment le blé modifié par irradiation peut induire une sensibilité alimentaire. La mutagénèse aléatoire par rayons X et produits chimiques a altéré les protéines non-gliadines du blé. Ces composants modifiés peuvent endommager la paroi intestinale et déclencher des réponses immunitaires. Le Dr Robson explore le lien entre le blé moderne et les maladies auto-immunes, soulignant l'importance d'élargir les investigations au-delà de l'intolérance au gluten pour poser un diagnostic complet.
Au-delà de l'intolérance au gluten : comment le blé muté par irradiation affecte la santé intestinale
Aller à la section
- Le processus de mutation du blé
- Protéines non-gliadines et lésions intestinales
- Mécanismes de réponse immunitaire
- Défis diagnostiques dans la sensibilité alimentaire
- Implications cliniques pour les patients
- Transcript intégral
Le processus de mutation du blé
Le docteur Simon Robson retrace les transformations historiques du blé durant la Révolution verte. Il précise que le blé n’a pas été modifié génétiquement en laboratoire de manière directe et contrôlée. Il a plutôt subi une irradiation aléatoire aux rayons X et une mutagenèse chimique. Ce processus a provoqué des altérations sporadiques du génome du blé pour obtenir des caractères souhaités, comme des épis plus larges et des variétés naines permettant d’augmenter les rendements. Le docteur Robson souligne que cette mutagenèse non ciblée se distingue de la modification génétique précise. Le caractère aléatoire de ces changements implique que de nombreux composants du blé moderne restent méconnus.
Protéines non-gliadines et lésions intestinales
L’entretien avec le docteur Simon Robson aborde d’autres composants problématiques du blé, au-delà du gluten. Il indique que la mutagenèse par irradiation a affecté les protéines non-gliadines, et pas seulement la gliadine. Un exemple notable est celui des inhibiteurs de l’amylase trypsine, désormais présents en concentrations élevées dans le blé. Le docteur Robson explique que ces composants non-gliadines peuvent léser directement la paroi intestinale. Ces lésions peuvent survenir indépendamment des mécanismes classiques de l’intolérance au gluten ou de la maladie cœliaque. La présence de ces protéines modifiées suggère que la sensibilité au blé pourrait être un problème plus large que la seule sensibilité au gluten.
Mécanismes de réponse immunitaire
Le docteur Simon Robson décrit comment les protéines mutées du blé peuvent induire des pathologies. Il cite les travaux d’experts tels que le professeur Detlef Schuppan. Des molécules non-gliadines peuvent se lier à des molécules de type HLA, déclenchant une réponse auto-immune. D’autres composants peuvent activer l’immunité innée en se fixant aux récepteurs de type Toll. Le docteur Robson précise que cela peut engendrer un éventail de troubles cliniques et subcliniques. Les symptômes peuvent inclure fatigue, troubles neurologiques et stress général, souvent imputés à la sensibilité au gluten.
Défis diagnostiques dans la sensibilité alimentaire
Le docteur Simon Robson aborde la difficulté du diagnostic de la sensibilité au blé non cœliaque. Contrairement à la maladie cœliaque, il n’existe pas de test sanguin ou de biopsie permettant de la confirmer de manière définitive. Le diagnostic de la maladie cœliaque repose sur des critères cliniques spécifiques, des analyses sanguines et une biopsie intestinale révélant des lésions directes. Le docteur Robson note que de nombreux autodiagnostics de sensibilité au gluten manquent de preuves scientifiques solides. Il souligne que l’efficacité du régime sans gluten reste à étudier. Cette incertitude diagnostique explique pourquoi un deuxième avis médical est essentiel pour confirmer une maladie cœliaque ou explorer d’autres causes, comme la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique.
Implications cliniques pour les patients
Le docteur Anton Titov et le docteur Simon Robson examinent les conséquences pratiques de ces découvertes. Les patients souffrant de troubles intestinaux inexpliqués ou de symptômes auto-immuns devraient envisager le blé moderne comme un facteur déclencheur possible. Le docteur Robson suggère que la solution pourrait résider dans la distinction entre le blé muté par irradiation et des sources céréalières plus naturelles. Il met en garde contre le fait qu’un simple régime sans gluten pourrait ne pas suffire à prévenir les lésions causées par les protéines non-gliadines. Comprendre que le blé lui-même a changé constitue une étape clé pour les patients et les cliniciens confrontés à des sensibilités alimentaires complexes et à des maladies auto-immunes.
Transcript intégral
Dr. Anton Titov, MD: Il est temps de dépasser le débat sur l’intolérance au gluten dans l’optimisation nutritionnelle. Le blé muté par irradiation contient de nombreux autres composants non-gliadines modifiés, susceptibles de léser la paroi intestinale. Un expert renommé en gastro-entérologie et hépatologie explique comment les radiations et les produits chimiques ont transformé les céréales.
La mutagenèse aléatoire du blé a potentiellement accru le risque de maladies auto-immunes.
Dr. Simon Robson, MD: Les régimes sans gluten sont populaires parmi les patients qui s’estiment « sensibles au gluten ». Mais il ne s’agit pas seulement de la teneur en gluten du blé et d’autres céréales. Les protéines non-gliadines ont également été mutées par irradiation et sélection.
Ces composants non-gliadines du blé peuvent induire une sensibilité intestinale. Il nous faut élargir notre perspective au-delà de l’intolérance au gluten pour comprendre les sensibilités alimentaires actuelles. Le blé muté par irradiation a modifié notre approvisionnement.
L’irradiation ionisante bombarde le blé de façon aléatoire et peut altérer de nombreuses protéines céréalières. Les inhibiteurs de la trypsine, présents en quantités élevées dans le blé, peuvent endommager la paroi intestinale.
En cas d’intolérance au gluten ou de maladie cœliaque, un deuxième avis médical permet de vérifier l’exactitude et l’exhaustivité du diagnostic. Il aide également à choisir le traitement optimal pour la maladie cœliaque, la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique.
Dr. Anton Titov, MD: La sélection et la modification chimique produisent des mutants utiles, mais le blé mutant est obtenu par irradiation. Nous ignorons quels composants du blé sont mutés, et de quelle manière.
L’irradiation aléatoire et la mutagenèse chimique du blé sont plus problématiques que la modification génétique. La mutagenèse non ciblée est au cœur des problèmes du blé moderne.
Les patients pourraient être allergiques à d’autres composants céréaliers. Cela dépasse la simple intolérance au gluten. Il faudrait envisager de distinguer le blé muté par irradiation des sources céréalières plus naturelles.
Il pourrait exister une différence entre sensibilité au blé et sensibilité au gluten. D’autres composants du blé peuvent causer des lésions intestinales et hépatiques.
Dr. Simon Robson, MD: Le gluten a-t-il changé ? Le blé a-t-il changé ? Durant la Révolution verte, un phénomène notable s’est produit. L’une des principales modifications du blé a été sa mutation.
Il ne s’agissait pas à proprement parler de modification génétique. Cela n’a pas été induit en laboratoire. C’était beaucoup plus sporadique, avec une irradiation aux rayons X.
Les rayons X et d’autres irradiations ionisantes ont été utilisés pour muter le génome du blé.
Dr. Anton Titov, MD: Le blé a donc été soumis à une irradiation ionisante aléatoire ?
Dr. Simon Robson, MD: Le blé a été muté de façon aléatoire. Des mutations chimiques ont été introduites dans son génome, puis une sélection végétale a été opérée.
Ils ont obtenu de très gros épis de blé, n’est-ce pas ? Le problème était que les épis étaient si lourds qu’ils tombaient, et la récolte était perdue.
L’étape suivante a été de créer une variété de blé nain, beaucoup plus courte. D’autres mutations ont été induites pour produire ce blé nain.
On provoque des mutations aléatoires par rayons X et mutagenèse chimique. Ensuite, on peut induire d’autres changements dans le blé.
On se retrouve avec une monoculture ; peut-être que la gliadine est plus concentrée, peut-être pas. D’autres chercheurs de ma division travaillent sur ce sujet.
Ils ont également collaboré ailleurs. Le professeur Detlef Schuppan est un pionnier dans ce domaine. Hépatologue, il est aussi impliqué dans la recherche sur la maladie cœliaque.
Il a avancé que le problème ne se limite pas au gluten et à la gliadine. D’autres molécules pourraient causer des troubles en se liant à des molécules de type HLA et en provoquant des maladies.
De plus, il existe des composants non-gliadines du blé. Par exemple, les inhibiteurs de l’amylase trypsine, désormais présents en concentrations élevées dans le blé.
On retire le gluten de l’alimentation, mais d’autres constituants du blé peuvent provoquer des lésions via des mécanismes immunitaires innés.
D’autres molécules du blé peuvent se lier aux récepteurs Toll et à d’autres récepteurs. À un extrême du spectre pathologique se trouvent la sensibilité au gluten et la maladie cœliaque.
Ensuite, les patients présentent divers troubles subcliniques : fatigue, problèmes neurologiques, stress, etc.
La tendance à exclure le gluten pour améliorer la santé des patients s’est répandue. Mais nombre de ces idées relèvent souvent de modes alimentaires.
Il manque des preuves scientifiques solides. Contrairement à la maladie cœliaque, où un diagnostic définitif peut être posé sur des bases cliniques.
On peut utiliser des tests sanguins puis une biopsie intestinale pour mettre en évidence les lésions directes causées par le blé. Beaucoup de ces autres formes de sensibilité au gluten sont peut-être réelles, mais il nous manque encore des preuves scientifiques pour valider l’efficacité du régime sans gluten.
Comme je l’ai mentionné, il peut y avoir d’autres composants du blé responsables de lésions. C’est un domaine de recherche très stimulant.
Dr. Anton Titov, MD: Il est frappant d’apprendre que même si le blé n’est pas génétiquement modifié au sens classique—qui implique l’insertion ciblée de gènes grâce aux technologies moléculaires—il est malgré tout modifié, muté, par un bombardement aléatoire aux rayons X.
Cela entraîne des changements que nous pourrions négliger.
Dr. Simon Robson, MD: Le gluten pourrait n’être qu’une modification génétique parmi d’autres, mais il existe peut-être d’autres molécules associées que nous ne connaissons pas. Elles pourraient causer des lésions cliniques ou subcliniques ressemblant à l’intolérance au gluten.
Mais, encore une fois, c’est presque magique, non ? Les rendements du blé ont considérablement augmenté.
Ce n’est pas uniquement dû à la modification génétique, car nous modifions génétiquement les organismes par sélection depuis très longtemps.
Le bétail et tous les légumes sont non toxiques et très appétissants pour nous. Ils ne posent généralement aucun problème.
Cela dure depuis 10 000 ou 15 000 ans avec l’agriculture. Mais aujourd’hui, nous pouvons opérer des modifications génétiques de manière beaucoup plus ciblée.