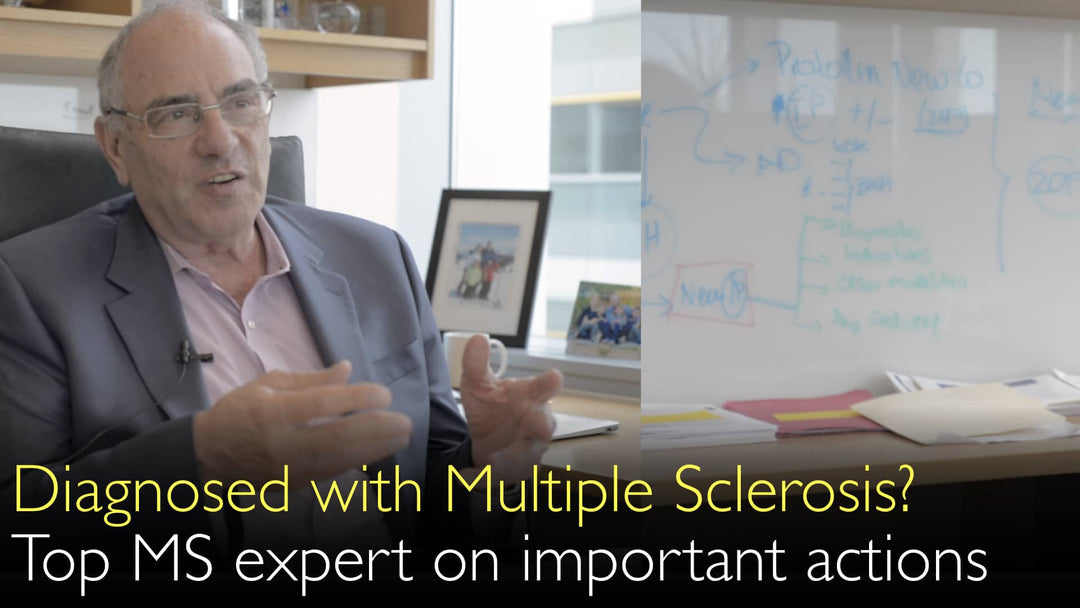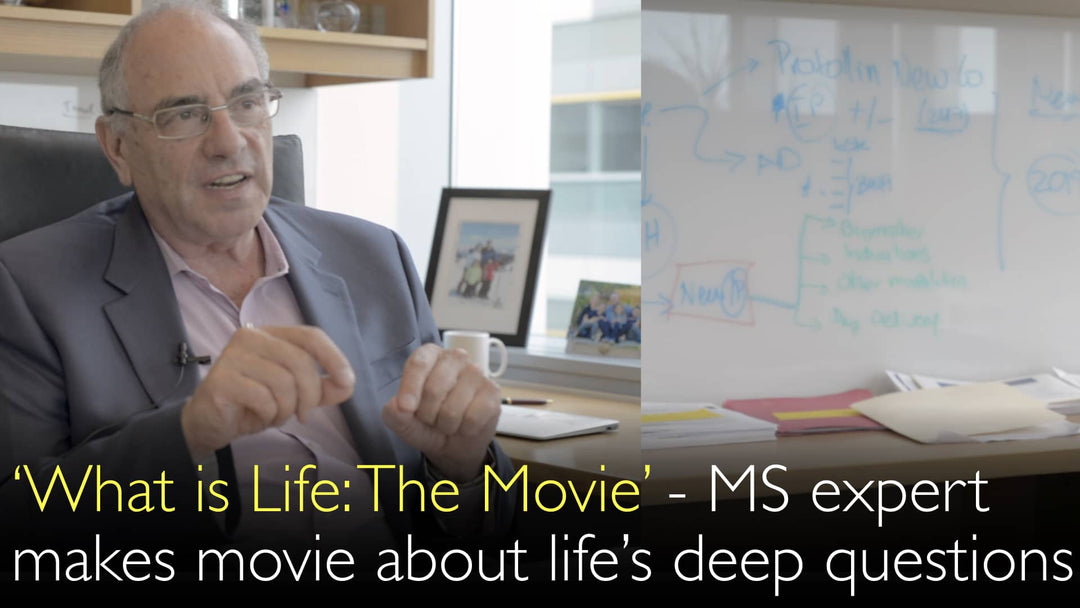Expert de premier plan en sclérose en plaques et en neuro-imagerie, le Dr Paul Matthews, MD, explique comment la neuromyélite optique (NMO) est désormais considérée comme une maladie distincte de la SEP. Il détaille le rôle de l'anticorps anti-aquaporine-4 en tant que biomarqueur unificateur. Le Dr Matthews aborde également le parcours complexe vers un traitement personnalisé de la SEP, qui intègre des facteurs génétiques, environnementaux et d'imagerie par résonance magnétique (IRM) pour la stratification des patients et le choix thérapeutique.
Comprendre la neuromyélite optique et l’avenir de la médecine de précision dans la sclérose en plaques
Aller à la section
- NMO : une maladie distincte
- Le rôle de l’anticorps anti-aquaporine 4
- Facteurs génétiques dans le pronostic de la SEP
- IRM en médecine de précision
- Personnalisation du traitement de la SEP
- Transcription intégrale
NMO : une maladie distincte
Le Dr Paul Matthews, MD, souligne que la neuromyélite optique (NMO) est désormais reconnue comme une entité nosologique spécifique, distincte de la sclérose en plaques. Cette reclassification marque une avancée majeure pour la médecine de précision en neurologie. Les travaux de la Mayo Clinic et de l’Université d’Oxford ont montré qu’un syndrome apparenté à la SEP était exclusivement lié à un anticorps, ce qui a conduit à sa distinction.
La NMO présente un pronostic différent, répond différemment aux traitements de la SEP et touche des populations de patients distinctes. Le Dr Paul Matthews, MD, note qu’il existe des formes spécifiques asiatique et caucasienne de la maladie, désormais unifiées grâce à cette nouvelle compréhension.
Le rôle de l’anticorps anti-aquaporine 4
La découverte de l’anticorps anti-aquaporine 4 a été un tournant décisif. Le Dr Paul Matthews, MD, explique que cet anticorps, présent dans le sérum sanguin, sert de biomarqueur unificateur pour la NMO. Il a fourni une cible biologique claire pour la recherche et le diagnostic.
Son identification a permis aux scientifiques de développer des modèles animaux de NMO, conduisant à une compréhension relativement précise de la physiopathologie de la maladie, dépassant ainsi une classification basée sur les symptômes pour une définition fondée sur les mécanismes.
Facteurs génétiques dans le pronostic de la SEP
Pour le syndrome plus large de la sclérose en plaques, les facteurs génétiques jouent un rôle crucial dans la détermination de la sévérité de la maladie. Le Dr Paul Matthews, MD, souligne l’importance du génotype HLA, en particulier l’haplotype HLA 1501, associé à une progression plus agressive de la SEP.
La découverte d’autres marqueurs génétiques forts représente un espoir majeur pour l’avenir. Ces marqueurs aideront à stratifier les patients atteints de SEP et ouvriront la voie à un traitement véritablement personnalisé, dépassant l’approche standardisée.
IRM en médecine de précision
Le Dr Paul Matthews, MD, souligne que l’IRM avancée est un outil puissant pour personnaliser la prise en charge de la SEP. L’imagerie IRM sériée dans les essais cliniques documente l’évolution de la charge lésionnelle T2, de la démyélinisation, de la perte axonale et de l’atrophie cérébrale.
Cela offre une vision directe de la progression et de la sévérité de la pathologie. Le Dr Matthews espère que les données IRM permettront de développer des algorithmes pour stratifier les patients de manière plus précise dès la première année de la SEP, facilitant ainsi des décisions thérapeutiques plus précoces et mieux informées.
Personnalisation du traitement de la SEP
L’objectif ultime est de personnaliser le traitement de la SEP en fonction des profils individuels des patients. Le Dr Paul Matthews, MD, indique que cette démarche est complexe et ne reposera pas sur un seul biomarqueur. Elle nécessite d’intégrer la susceptibilité génétique, les facteurs environnementaux comme la latitude et la vitamine D, ainsi que les facteurs liés au mode de vie, tels que le tabagisme.
Cette évaluation personnalisée aide à établir un pronostic probable pour chaque patient. Avec la large gamme de médicaments disponibles contre la SEP, chacun ayant des profils d’efficacité et de sécurité distincts, les patients et les médecins peuvent décider conjointement du meilleur rapport bénéfice-risque. Certains patients auront besoin de thérapies hautement efficaces, tandis que d’autres pourront opter pour des options plus sûres et moins agressives.
Transcription intégrale
Dr Anton Titov, MD : La sclérose en plaques comprend-elle plusieurs maladies différentes ? Que révèlent les essais cliniques avancés en IRM ? Vous menez des essais cliniques d’IRM dans vos recherches sur la sclérose en plaques.
Dr Paul Matthews, MD : Je pense que tous les neurologues sont bien conscients de ce fait. Plusieurs découvertes sont survenues au cours de la dernière décennie. Les travaux sur la sclérose en plaques à la Mayo Clinic, soutenus par des recherches à Oxford et ailleurs, ont démontré qu’un syndrome spécifique de SEP était étroitement associé à la présence d’un anticorps.
Cet aspect du syndrome de SEP était très distinct. L’anticorps ciblait l’aquaporine 4, une protéine présente dans le sérum. De plus, il s’est avéré que cet anticorps anti-aquaporine 4 était responsable de la forme asiatique de la neuromyélite optique.
Il existe une forme asiatique spécifique de la neuromyélite optique, ainsi qu’une forme caucasienne. Cet anticorps fournit un biomarqueur unificateur pour ce syndrome. Beaucoup a été appris depuis, car il a également été possible de créer des modèles animaux de NMO.
Nous avons vraiment commencé à comprendre la physiopathologie de la NMO de manière relativement précise. Je considère cela comme la réussite la plus marquante d’une approche de médecine de précision. La neuromyélite optique est un sous-groupe de syndromes autrefois tous classés comme sclérose en plaques.
Désormais, la neuromyélite optique est définie comme une entité nosologique spécifique, tout à fait distincte. Elle répond différemment aux médicaments de la SEP, a un pronostic différent.
Dr Anton Titov, MD : Et elle survient dans des populations de patients différentes. Examinons ce qui reste du syndrome plus large de la sclérose en plaques.
Dr Paul Matthews, MD : Cela aussi est clair. Les patients avec différents génotypes HLA sont susceptibles de présenter différents niveaux de sévérité de la SEP. Par exemple, l’haplotype HLA 1501 est associé à une progression plus maligne.
Nous espérons découvrir d’autres marqueurs génétiques forts de la SEP. Cela nous aidera à stratifier les patients et à entamer le chemin vers la personnalisation du traitement.
Enfin, je noterais que la voie vers la personnalisation du traitement de la SEP n’est probablement pas simple. Elle ne dépendra pas d’un seul biomarqueur. Le cas de la NMO a été très chanceux, mais il sera probablement moins fréquent.
De multiples facteurs de risque devront être pris en compte pour personnaliser le traitement de la SEP. Il existe des facteurs génétiques, environnementaux et liés au mode de vie qui influencent la maladie. Nous devons reconnaître l’impact de la latitude, des taux de vitamine D, du tabagisme et d’autres comportements à risque.
Les facteurs de susceptibilité génétique pour la SEP sont également importants. Tout cela nous aidera à mieux évaluer les patients lors de la première consultation et à leur fournir des informations sur le pronostic.
Enfin, je pense que cette personnalisation peut être considérablement renforcée par l’utilisation de l’IRM spécialisée. L’imagerie IRM nous offre une vision directe de l’évolution de la pathologie. Les essais cliniques d’imagerie sériée permettent de documenter le taux de changement de la charge lésionnelle T2 dans le cerveau.
L’IRM nous permet d’observer les dommages concomitants, exprimés en termes de démyélinisation et de perte axonale, ainsi que l’atrophie cérébrale.
Dr Anton Titov, MD : Globalement, les IRM sériées nous donnent une idée de la sévérité de la pathologie dans la SEP. J’espère que nous les utiliserons pour un traitement de médecine de précision.
Dr Paul Matthews, MD : L’IRM nous mènera à des algorithmes permettant de stratifier les patients de manière beaucoup plus précise durant la première année de la SEP. Nous pourrons distinguer ceux qui ont vraiment besoin de thérapies très efficaces.
Nous pourrons également identifier les patients qui pourraient bénéficier de thérapies moins efficaces sur le plan anti-inflammatoire global, mais potentiellement plus sûres.
Clairement, cela relève de la médecine de précision. Il s’agit de la capacité prédictive aux stades précoces de la SEP pour stratifier les patients. Certains auront besoin d’une thérapie plus agressive, d’autres d’une approche moins intensive. Oui, je pense que c’est vrai.
En médecine de précision, nous voulons offrir au patient une meilleure explication de son pronostic probable. Ensuite, le patient doit décider du meilleur rapport bénéfice-risque pour son traitement.
Dr Anton Titov, MD : Le patient atteint de SEP peut choisir parmi la large gamme de médicaments disponibles aujourd’hui. Nous sommes dans une position favorable, avec de nombreux traitements présentant des profils d’efficacité et de sécurité très variés.