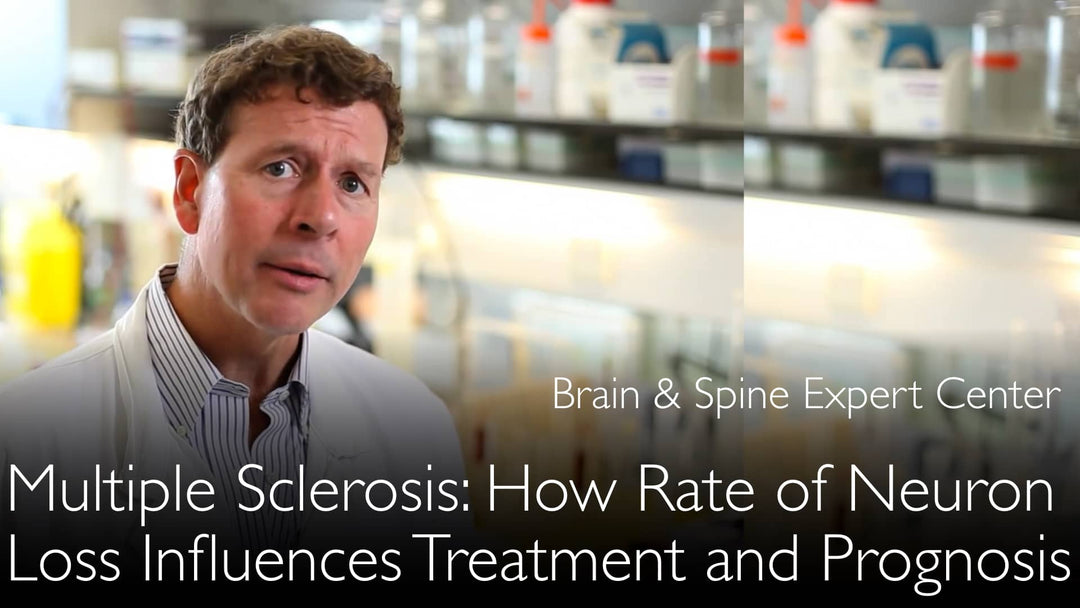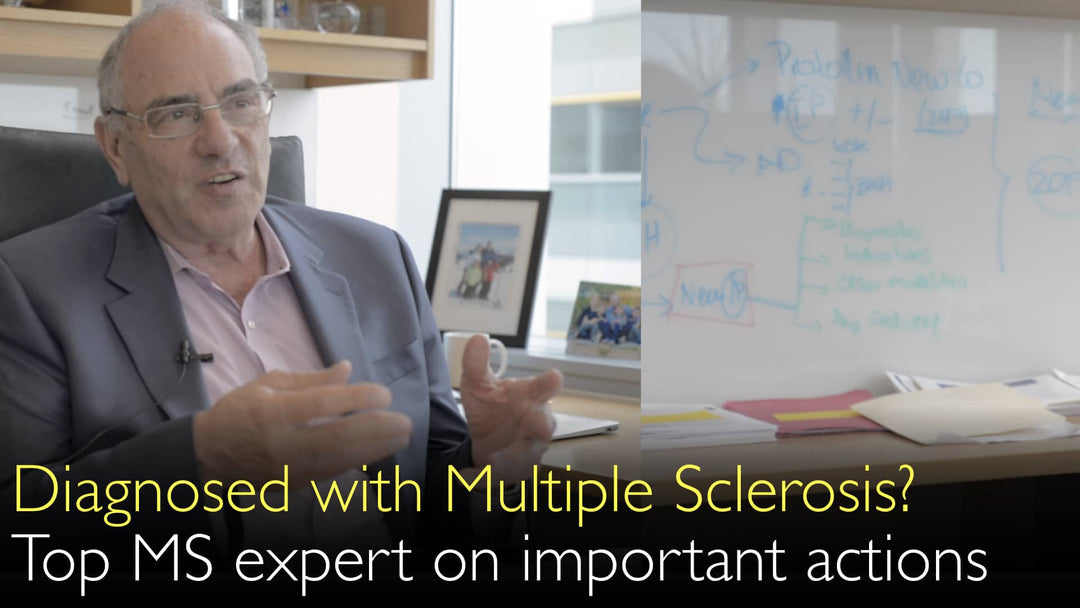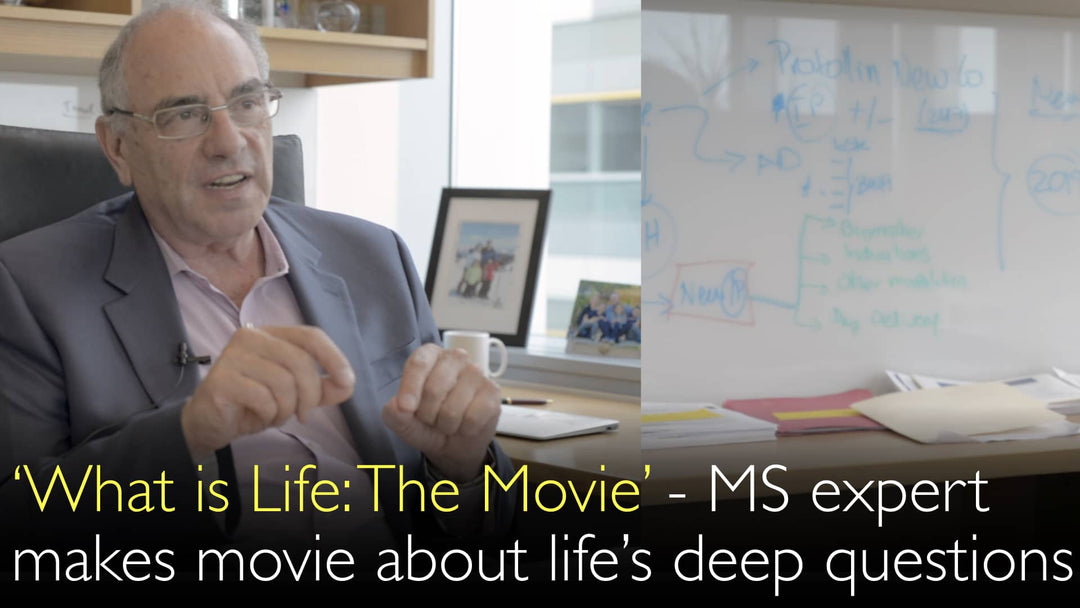Le Dr Paul Matthews, MD, expert de renommée mondiale dans la neurodégénérescence liée à la sclérose en plaques, explique comment la perte axonale et neuronale sous-tend la progression de la maladie. Il présente les recherches innovantes qui ont redéfini la SEP comme une pathologie neurodégénérative. Le Dr Matthews aborde le rôle central de l’inflammation dans la genèse des lésions nerveuses directes. Il souligne l’importance de mesurer la perte de volume cérébral en parallèle des lésions inflammatoires. Cette approche combinée permet d’établir un pronostic plus précis du handicap chez les patients atteints de SEP.
La neurodégénérescence, facteur central du handicap dans la sclérose en plaques
Aller à la section
- Découverte de la neurodégénérescence dans la SEP
- Preuves de la perte axonale
- Atteinte de la substance grise
- Lien inflammation-neurodégénérescence
- Implications cliniques et pronostic
- Transcription intégrale
Découverte de la neurodégénérescence dans la SEP
Le Dr Paul Matthews décrit un tournant dans la compréhension de la sclérose en plaques. Longtemps considérée comme une maladie auto-immune démyélinisante, la SEP s’est révélée posséder une forte composante neurodégénérative grâce aux travaux du Dr Matthews et de ses collègues. Ces recherches ont remis au jour des preuves anatomopathologiques négligées depuis le début du XXᵉ siècle.
Ce changement de paradigme a émergé entre 1990 et 1995, lorsque le Dr Doug Arnold à Montréal et l’équipe du Dr Matthews ont fait deux observations critiques et inattendues, ébranlant la vision établie de la maladie.
Preuves de la perte axonale
Une preuve déterminante de la neurodégénérescence dans la SEP provient du dosage du N-acétyl-aspartate (NAA), une molécule présente presque exclusivement dans les neurones. Le Dr Paul Matthews rapporte des pertes substantielles de NAA, à la fois dans la substance blanche et la substance grise des patients.
Parallèlement, les chercheurs ont constaté une atrophie cérébrale significative, preuve macroscopique de lésions neuronales étendues. Le Dr Bruce Trapp a ensuite publié des études neuropathologiques fondamentales montrant comment l’inflammation au sein des lésions de SEP cause directement des dommages et une perte axonaux.
Atteinte de la substance grise
La neurodégénérescence dans la SEP dépasse largement les lésions classiques de la substance blanche. Le Dr Paul Matthews souligne les travaux déterminants du Dr Jeroen Geurts et d’autres, qui ont démontré une perte neuronale dans la substance grise, incluant des structures sous-corticales critiques comme le thalamus et le néocortex.
Cette perte axonale généralisée dans la substance blanche, associée à la mort neuronale dans la substance grise, dessine un tableau complet de dégénérescence cérébrale, affectant à la fois les axones conducteurs et les corps cellulaires des neurones.
Lien inflammation-neurodégénérescence
L’inflammation est le principal déclencheur de la neurodégénérescence dans la sclérose en plaques. Le Dr Matthews précise qu’une lésion de SEP débute par une activité inflammatoire aiguë, suivie de processus inflammatoires chroniques et d’autres facteurs conduisant à une neurodégénérescence progressive.
Le Dr Anton Titov anime cette discussion sur les atteintes directes aux neurones. L’inflammation n’est pas distincte de la neurodégénérescence ; elle en est le mécanisme causal. Ce lien est fondamental pour comprendre l’évolution de la SEP et développer des traitements efficaces.
Implications cliniques et pronostic
Reconnaître la SEP comme maladie neurodégénérative a des implications majeures pour le pronostic des patients. Le Dr Paul Matthews explique que le nombre de lésions inflammatoires à l’IRM ne donne qu’une approximation du handicap. Le degré de perte irréversible des axones et des neurones apporte des informations cruciales et indépendantes sur l’avenir du patient.
Cette neurodégénérescence constitue le substrat direct de la progression du handicap. Ainsi, les cliniciens doivent dépasser l’analyse des lésions T2 à l’IRM et évaluer la perte de volume cérébral pour comprendre la cause principale du handicap et établir un pronostic à long terme précis.
Transcription intégrale
Dr. Anton Titov, MD: La neurodégénérescence dans la sclérose en plaques. Commençons par ce thème majeur de vos recherches. La sclérose en plaques est généralement décrite comme une maladie auto-immune primaire. Mais vous et vos collègues avez apporté des preuves révolutionnaires montrant qu’il s’agit aussi d’une maladie neurodégénérative, avec une perte axonale et neuronale significative.
Dr. Anton Titov, MD: Quelle est la portée de ces découvertes sur la perte axonale et neuronale ? Quelles implications pour la prise en charge et le pronostic des patients ?
Dr. Paul Matthews, MD: Merci ! D’abord, il faut souligner la contribution des nombreux patients. En réalité, il s’agissait d’une redécouverte. Les preuves de perte axonale et neuronale étaient bien documentées dans la littérature neuropathologique du début du XXᵉ siècle, mais les aspects démyélinisants et inflammatoires ont dominé les manuels à partir des années 1960.
Le Dr Doug Arnold à Montréal et nous-mêmes avons fait deux observations clés entre 1990 et 1995.
D’abord, nous avons mis en évidence une perte substantielle de N-acétyl-aspartate (NAA), une molécule principalement contenue dans les neurones, chez les patients atteints de SEP. Ces pertes, inattendues, concernaient à la fois la substance blanche et la substance grise.
Ensuite, nous avons observé une atrophie cérébrale significative, témoin de pertes neuronales sévères.
Le Dr Bruce Trapp de la Cleveland Clinic a publié dans le New England Journal of Medicine une étude neuropathologique fondamentale montrant comment l’inflammation dans les lésions de substance blanche entraîne une perte axonale concomitante à la démyélinisation.
Ensuite, le Dr Trapp et notre groupe avons apporté des preuves de lésions plus étendues, incluant la substance grise.
Mes collègues, le Dr Bruce Trapp, le Dr Jeroen Geurts de l’Université libre d’Amsterdam et d’autres équipes ont publié une série d’articles importants démontrant la perte neuronale dans la substance grise, en particulier dans des structures sous-corticales comme le thalamus et le néocortex.
Dr. Anton Titov, MD: Une perte axonale généralisée dans la substance blanche s’ajoute à cela, brossant un tableau de dégénérescence cérébrale. L’inflammation s’accompagne de lésions nerveuses directes. La SEP endommage à la fois les axones et les corps cellulaires, un processus qui évolue dans le temps : une lésion se forme, puis des mécanismes inflammatoires chroniques et d’autres facteurs entraînent une neurodégénérescence progressive.
Dr. Paul Matthews, MD: Pourquoi est-ce important pour le patient ? Nous avons réalisé que le nombre et la distribution des lésions inflammatoires – celles visibles en hypersignal T2 à l’IRM – ne corrèlent qu’approximativement avec le degré de handicap et sa progression.
Des informations supplémentaires et indépendantes proviennent de l’évaluation de la perte en corps cellulaires neuronaux et en axones. Nous pensons que cette perte irréversible est le substrat direct de la progression du handicap dans la SEP.
Dr. Paul Matthews, MD: Ainsi, lorsque nous examinons les lésions T2 à l’IRM, nous observons la cause primaire de la neurodégénérescence. C’est cette neurodégénérescence elle-même qui est la cause principale du handicap chez la majorité des patients.