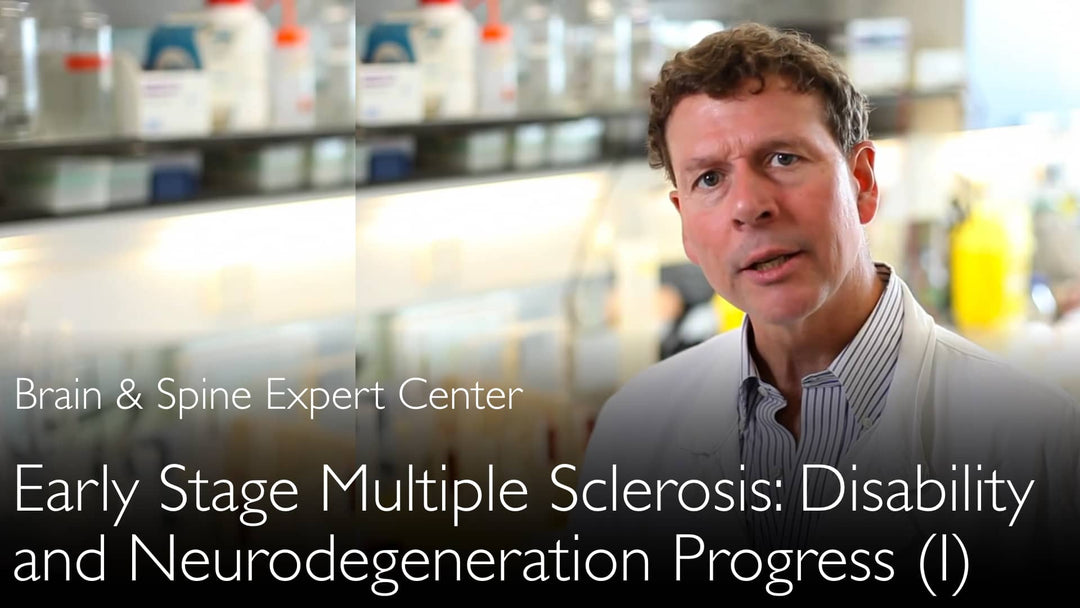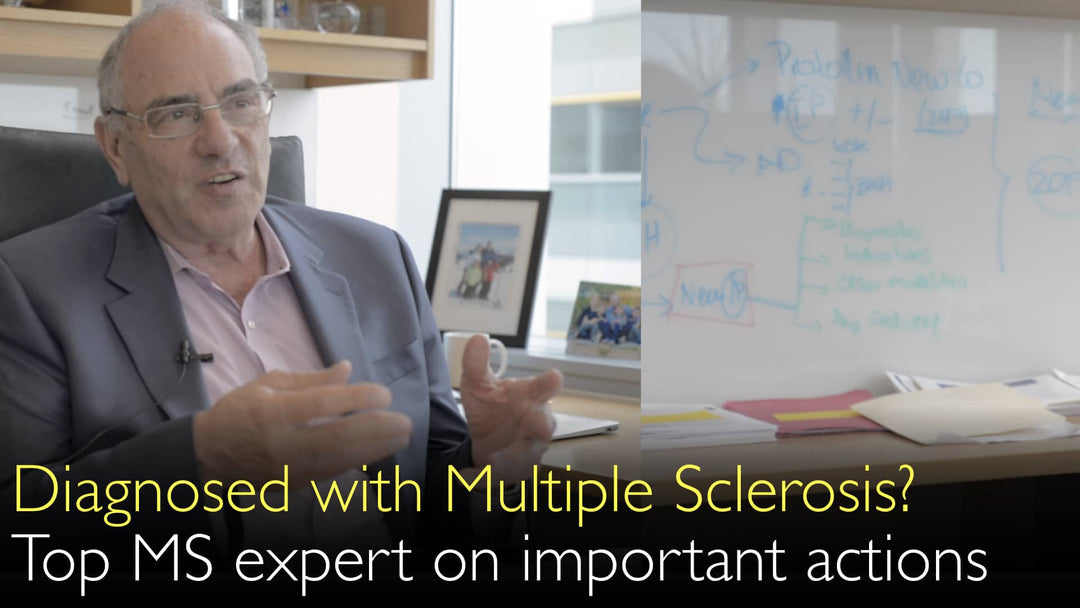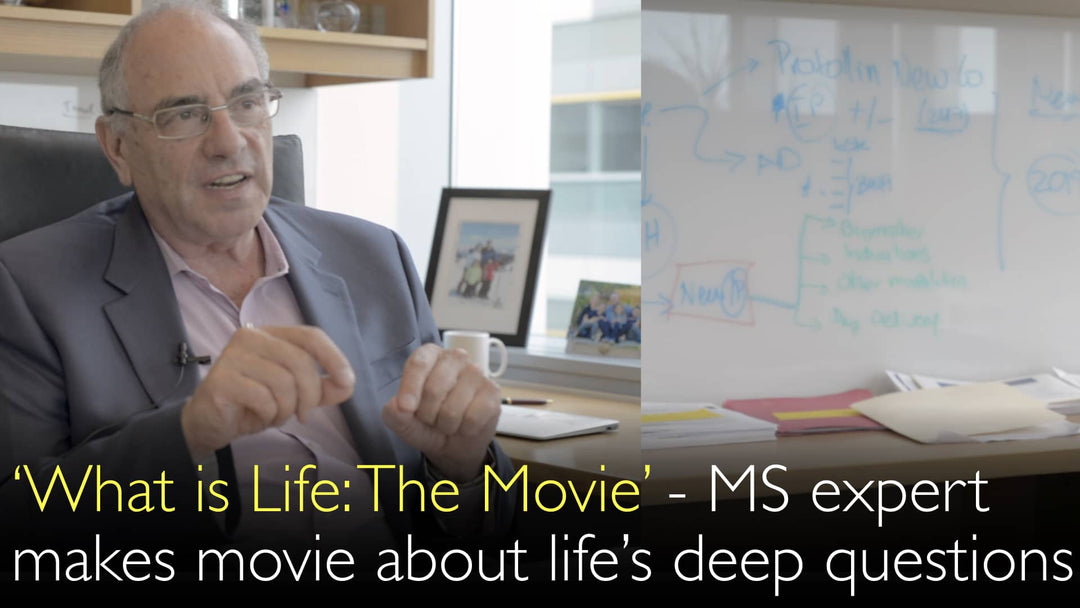Le docteur Paul Matthews, MD, spécialiste de renom en neurodégénérescence et en sclérose en plaques, explique que la perte axonale débute tôt dans la SEP et conduit à un handicap permanent. Il décrit comment l’IRM permet de quantifier l’atrophie cérébrale comme biomarqueur essentiel. Cette neurodégénérescence progresse à un rythme soutenu dès l’apparition des premiers symptômes. Une intervention thérapeutique précoce est donc déterminante pour prévenir les lésions cumulatives et l’aggravation du handicap.
Perte axonale précoce et neurodégénérescence dans la sclérose en plaques
Aller à la section
- Perte axonale précoce et handicap
- IRM et mesure du volume cérébral
- Taux constant de neurodégénérescence
- Prédiction de la progression du handicap
- Implications pour le traitement précoce
- Transcript intégral
Perte axonale précoce et handicap
Selon le Dr Paul Matthews, l’objectif principal du traitement de la sclérose en plaques doit être la réduction du handicap permanent, qui résulte directement d’une perte axonale cumulative. Cette atteinte axonale survient très tôt dans l’évolution de la maladie. Le Dr Matthews souligne que les décisions thérapeutiques ne doivent pas se fonder uniquement sur la sévérité des symptômes à un instant donné, mais viser à prévenir les agressions cumulatives menant à des lésions neurologiques irréversibles.
IRM et mesure du volume cérébral
Les techniques avancées d’IRM offrent des outils puissants pour évaluer la neurodégénérescence dans la sclérose en plaques. Le Dr Matthews indique que ces examens permettent d’identifier la perte neuronale et axonale dès les stades initiaux, y compris lors du syndrome cliniquement isolé (SCI), souvent précurseur du diagnostic de SEP. La perte de volume cérébral, biomarqueur clé, sert d’indicateur indirect de l’atteinte des cellules nerveuses et des axones. Les travaux fondateurs du Pr Nicola De Stefano ont validé l’utilité de cette approche pour le suivi de l’activité de la maladie.
Taux constant de neurodégénérescence
Une découverte majeure dans la recherche sur la SEP est la constance du taux de neurodégénérescence. Le Dr Matthews souligne que la perte de volume cérébral progresse de façon similaire tout au long de l’évolution de la maladie, depuis le syndrome cliniquement isolé jusqu’à la phase progressive secondaire. Les travaux du Dr Elizabeth Fisher et du Dr Rick Rudick de la Cleveland Clinic, qui ont suivi des cohortes de patients sur plus de dix ans, ont confirmé cette constance dans le temps.
Prédiction de la progression du handicap
La mesure de la perte de volume cérébral n’est pas seulement diagnostique ; elle constitue également un indicateur pronostique fort. Le Dr Matthews explique que ce taux de perte prédit efficacement la progression du handicap, soulignant le lien direct entre neurodégénérescence et aggravation clinique. Plusieurs équipes, dont celle du Dr Matthews, ont confirmé cette corrélation, offrant ainsi une cible quantifiable pour les thérapies visant à ralentir l’évolution de la maladie.
Implications pour le traitement précoce
Ces observations ont des implications majeures pour la stratégie thérapeutique. Le Dr Matthews soutient que l’intervention doit refléter la précocité de l’atteinte axonale, justifiant un traitement initié le plus tôt possible pour prévenir les dommages cumulatifs. Dans son entretien avec le Dr Anton Titov, il explore comment ces insights doivent guider le neurologue dans le choix thérapeutique, l’objectif étant de protéger le système nerveux contre l’agression menant au handicap permanent.
Transcript intégral
Dr. Anton Titov, MD: Vous êtes l'un des neurologues de premier plan ayant étudié la neurodégénérescence dans la sclérose en plaques. Vous avez collaboré avec le Dr Douglas Arnold à l’Université McGill et le Dr Margaret Esiri, neuropathologiste à Oxford, sur la perte axonale.
Je cite l’un de vos articles : « L’objectif principal du traitement de la SEP doit être la réduction du handicap permanent. Il est admis que ce handicap résulte d’une perte axonale cumulative, survenant très précocement. »
Un traitement efficace étant disponible, le moment de l’intervention devrait correspondre au début de l’atteinte axonale, donc traiter tôt. Les décisions ne doivent pas se baser sur la sévérité clinique instantanée, mais viser à prévenir les agressions cumulatives évitant ainsi le handicap permanent.
Cela a des implications profondes pour la stratégie thérapeutique. Pouvez-vous évaluer par IRM la perte neuronale et axonale chez un patient nouvellement diagnostiqué ? Comment cela influencerait-il les choix thérapeutiques ?
Dr. Paul Matthews, MD: Nous disposons aujourd’hui de techniques d’imagerie variées permettant d’identifier la perte neuronale et axonale, même aux stades précoces comme le syndrome cliniquement isolé.
Les travaux fondateurs du Pr Nicola De Stefano, aujourd’hui à l’Université de Sienne, ont montré que le taux de perte de volume cérébral évolue de manière similaire tout au long de la maladie. Cette perte volumétrique reflète indirectement l’atteinte des cellules nerveuses et des axones.
Ainsi, les neurones continuent de mourir depuis le SCI jusqu’à la phase progressive secondaire, à un rythme relativement constant.
D’autres données, comme celles du Dr Elizabeth Fisher à la Cleveland Clinic, en collaboration avec le Dr Rick Rudick, ont renforcé cette observation. Le suivi de cohortes traitées par interféron bêta sur plus de dix ans a confirmé la constance du taux de perte cérébrale.
De plus, ces travaux – auxquels nous avons contribué – montrent que ce taux prédit bien la progression du handicap.