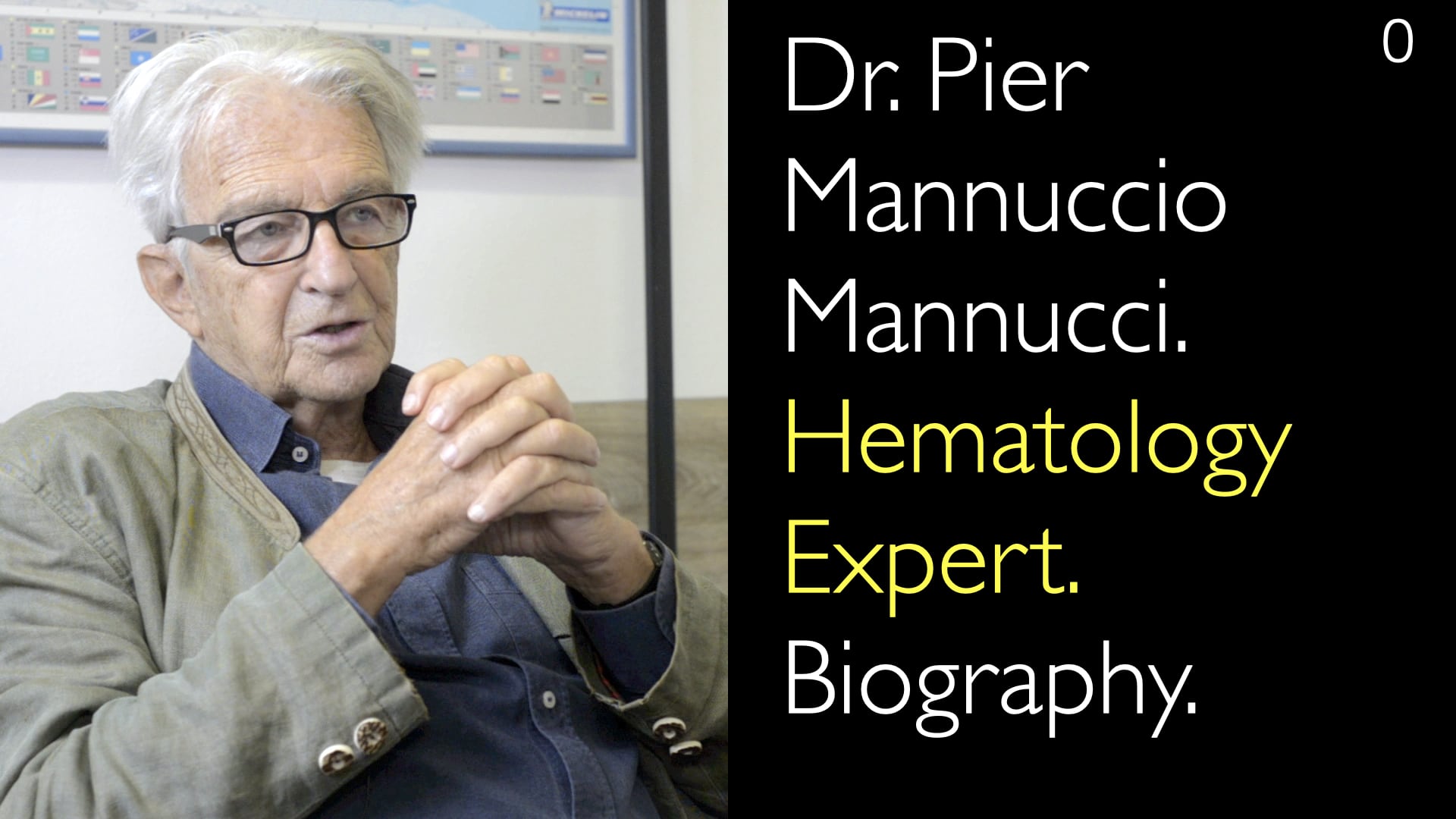Le Dr Pier Mannucci, MD, expert de renom en polymédication et en médecine interne, explique pourquoi les personnes âgées se voient trop souvent prescrire un nombre excessif de médicaments. Il détaille les risques graves liés à la polymédication, notamment les effets indésirables et l’augmentation de la mortalité. Le Dr Pier Mannucci présente une étude italienne significative qui a permis de réduire le nombre moyen d'ordonnances de six à quatre médicaments. Il souligne que l’absence d’un médecin coordinateur unique constitue le problème central. La solution repose sur une déprescription systématique et l’utilisation d’outils comme le logiciel INTERCheck pour détecter les interactions médicamenteuses dangereuses.
Polythérapie chez la personne âgée : causes, risques et solutions de déprescription
Aller à la section
- Les risques de la polythérapie
- Pourquoi les médecins surprescrivent-ils
- La solution : la déprescription
- L'étude italienne REPOSI
- Le rôle des médecins généralistes
- Transcription intégrale
Les risques de la polythérapie
La polythérapie se définit par la prise d’au moins cinq médicaments par un patient. Fréquente en gériatrie, cette situation comporte des risques significatifs. Le docteur Pier Mannucci, médecin, souligne les principaux dangers, notamment une probabilité accrue d’interactions médicamenteuses et d’effets indésirables.
L’observance thérapeutique des patients est souvent compromise par la complexité des schémas posologiques, ce qui entraîne de moins bons résultats de santé. Plus grave encore, la polythérapie est associée à une augmentation des hospitalisations et de la mortalité.
Pourquoi les médecins surprescrivent-ils
La cause profonde de la polythérapie n’est pas une intention malveillante, mais une défaillance systémique dans la coordination des soins. Le docteur Pier Mannucci explique que les patients âgés présentent généralement plusieurs pathologies chroniques. Chaque problème est souvent pris en charge par un spécialiste d’organe différent, comme un cardiologue ou un pneumologue.
Ces spécialistes suivent des recommandations spécifiques à leur domaine, sans intégrer leurs prescriptions avec celles des autres médecins. Le docteur Pier Mannucci constate que « personne ne fait l’intégration ». Cette approche fragmentée fait qu’aucun médecin ne considère le patient dans sa globalité, ce qui conduit à une accumulation de prescriptions sans supervision.
La solution : la déprescription
La déprescription est le processus délibéré de révision et d’arrêt des médicaments inutiles. Son efficacité est solidement étayée par des preuves. Le docteur Pier Mannucci cite une étude israélienne où des médicaments ont été arrêtés chez des patients âgés en moyenne de 82 ans.
Les résultats sont frappants : seuls 2 % des patients ont dû reprendre les médicaments interrompus. Près de 90 % ont rapporté une amélioration globale de leur santé et de leur bien-être. Cela montre que de nombreux médicaments apportent peu de bénéfices tout en présentant des risques substantiels.
L'étude italienne REPOSI
Le docteur Pier Mannucci a dirigé en Italie une initiative majeure, le registre REPOSI. Ce projet a mis à disposition des médecins un logiciel gratuit nommé INTERCheck, conçu pour identifier les interactions médicamenteuses dangereuses. L’objectif était de les alerter sur les risques de la polythérapie et d’encourager la déprescription.
Les résultats sont significatifs : les médecins participants ont réduit le nombre moyen de prescriptions de six à quatre médicaments par patient. L’étude a aussi rendu la polythérapie extrême (plus de dix médicaments) beaucoup moins fréquente. Cette initiative, sponsorisée par la Société Italienne de Médecine Interne, sert de modèle pour d’autres systèmes de santé.
Le rôle des médecins généralistes
Résoudre la polythérapie nécessite un changement de philosophie des soins. La responsabilité incombe aux médecins généralistes, qui considèrent le patient dans sa globalité. Le docteur Pier Mannucci identifie trois acteurs clés : les médecins généralistes, les internistes et les gériatres.
Ces professionnels possèdent les connaissances étendues nécessaires pour évaluer les avantages et inconvénients d’une liste médicamenteuse complète. Ils peuvent réaliser l’intégration essentielle que les spécialistes manquent souvent. Comme le note le docteur Pier Mannucci dans sa discussion avec le docteur Anton Titov, cette approche holistique est cruciale pour la sécurité des patients et la réduction des prescriptions superflues ou nocives.
Transcription intégrale
Dr. Anton Titov, MD: Les personnes âgées se voient souvent prescrire de nombreux médicaments. On parle de polythérapie lorsqu’un patient prend au moins cinq médicaments. Celle-ci entraîne un risque accru d’interactions médicamenteuses, d’effets indésirables et d’une mauvaise observance. Elle conduit aussi à une hausse des hospitalisations et de la mortalité.
Une étude israélienne a examiné des patients âgés en moyenne de 82 ans. Ils utilisaient initialement huit médicaments en moyenne, puis environ quatre ou cinq ont été arrêtés. Seuls 2 % des patients ont dû reprendre les médicaments interrompus. Près de 90 % ont rapporté une amélioration globale de leur santé et de leur bien-être.
Vous avez dirigé une étude italienne majeure sur la polythérapie chez les patients âgés pendant plus de 10 ans. Quelles leçons en avez-vous tirées ? Que peuvent retenir les professionnels du monde entier, notamment concernant les patients âgés et la polythérapie ?
Dr. Pier Mannucci, MD: Vous avez très bien résumé la situation, je n’ai donc que peu à ajouter. Je peux peut-être préciser ceci : pourquoi la polythérapie est-elle si fréquente ? Pourquoi mes collègues prescrivent-ils autant de médicaments ? Que peut-on faire pour améliorer le système ?
Même si vous avez déjà abordé le problème de la polythérapie et de son arrêt, celui-ci a un effet positif sur la survie.
Pourquoi les médecins prescrivent-ils autant de médicaments aux personnes âgées ? C’est très simple. La polythérapie survient parce que les personnes âgées ont presque inévitablement plusieurs maladies. En conséquence, elles consultent souvent de nombreux médecins différents.
Chacun est expert d’un organe particulier. Les patients voient un cardiologue—c’est fréquent—, un pneumologue pour les poumons, ou un gastro-entérologue pour des problèmes digestifs.
Ces médecins tendent à prescrire indépendamment, selon les recommandations propres à chaque pathologie. Par exemple, un cardiologue voit un patient pour une insuffisance cardiaque, de l’hypertension ou une coronaropathie. Un pneumologue pour une BPCO ou un asthme.
Un gastro-entérologue pour une gastrite, peut-être due à la prise de nombreux médicaments. De même pour les néphrologues, les rhumatologues, etc. C’est très fréquent.
Le problème est que les médecins suivent leurs recommandations sans intégration. Personne ne fait la synthèse. En d’autres termes, personne ne combine les indications thérapeutiques de la cardiologie avec celles d’autres domaines.
Malheureusement, c’est un problème actuel : on raisonne par organe, sans voir la personne dans sa globalité. C’est là qu’intervient le médecin généraliste.
Qui sont ces médecins ? Les généralistes, les internistes (comme moi) et les gériatres. Malheureusement, il arrive souvent que les patients consultent dans l’espoir d’intégrer leurs multiples médicaments, pour distinguer ce qui est nécessaire de ce qui est dangereux.
Comme vous l’avez mentionné, le problème—que vous avez très bien expliqué—est que les médicaments interagissent entre eux. En grec, “pharmakon” signifie à la fois “remède” et “poison”. Le manque d’intégration, la prescription basée sur des recommandations par maladie, sans vision d’ensemble, posent problème.
Les médecins qui devraient assurer cette intégration sont ceux que j’ai cités : le généraliste, l’interniste et le gériatre. Même si chaque spécialiste d’organe devrait aussi être conscient des interactions qu’il peut provoquer.
La surprescription que vous avez évoquée appelle une prescription judicieuse : réviser tous les médicaments pris par le patient, identifier qui les a prescrits, et les évaluer non pas avec une connaissance pointue d’un organe, mais avec une vision générale étendue.
Par “médecin généraliste”, je n’entends rien de péjoratif, mais au contraire une compétence positive que le spécialiste d’organe n’a pas. Il est inévitable de se concentrer sur l’organe concerné, mais les problèmes doivent être envisagés globalement.
La déprescription, comme vous l’avez dit, est très importante. Son efficacité a été démontrée, notamment dans l’étude que vous avez citée. Inutile de répéter ses résultats.
Il faut procéder à une bonne déprescription, ou du moins à une révision des médicaments, en évaluant leurs avantages et inconvénients, les risques d’interaction, les coûts, et les risques de non-observance.
Il peut arriver que le patient ne prenne pas les médicaments essentiels, ou qu’il en prenne d’autres—comme un inhibiteur de la pompe à protons—simplement parce que la multiplicité des traitements provoque une gastrite.
Il y a ainsi une cascade de prescriptions : les multiples médicaments causent d’autres maladies, sans que l’on comprenne que celles-ci sont induites par les traitements, et non par l’âge.
Je peux vous donner un exemple d’action que nous avons menée en 2008, il y a plus de dix ans. Nous avons montré que les services de médecine interne utilisant notre registre d’interactions médicamenteuses—et nous avons fourni gratuitement ce système à d’autres médecins—pouvaient identifier les interactions et leur degré.
Les résultats des médecins participants à l’étude REPOSI (Registro POliterapie SIMI Società Italiana di Medicina Interna) ont été probants : ils ont réduit le nombre de médicaments prescrits. Ceux qui prescrivaient habituellement sont passés de six médicaments en moyenne à quatre. C’est une amélioration, même s’il pourrait y en avoir moins.
Quoi qu’il en soit, cela montre l’utilité du registre. Le logiciel INTERCheck—disponible gratuitement en ligne—est fourni par l’Institut Mario Negri et la Société Italienne de Médecine Interne, qui parraine ce registre.
Cette initiative est bénévole ; nous n’avons pas de financement dédié. Outre la publication de nombreux articles prouvant l’efficacité de la déprescription, le résultat le plus visible a été de sensibiliser les médecins aux interactions médicamenteuses significatives.
Nous avons observé une réduction du nombre moyen de médicaments utilisés, passant de six à quatre. Nous espérons avoir au moins limité les prescriptions de plus de dix médicaments, qui sont très fréquentes. La polythérapie extrême est devenue moins courante.
C’est ce que nous avons accompli. Heureusement, l’agence italienne du médicament a pris note de nos efforts. La semaine prochaine, nous nous rendons à Rome pour une réunion sur la polythérapie.
Il est important que le Ministère de la Santé et l’ANSM, l’Agence nationale de sécurité du médicament, soient informés de ces travaux. Cela a aussi des implications sur le coût des médicaments, car beaucoup de traitements sont gaspillés—inutiles et coûteux pour notre système de santé—, sans compter les risques pour les patients.
Voilà ce que je peux vous dire. La déprescription est la solution. Il existe des indications sur sa mise en œuvre. Vous en avez déjà mentionné les résultats. J’espère que cette démarche sera reproduite dans d’autres pays.
Par exemple, l’Espagne y réfléchit. L’efficacité de la déprescription a été démontrée, comme dans l’étude israélienne que vous avez citée. En Nouvelle-Zélande, où elle est aussi pratiquée, davantage de médecins prennent conscience du problème.
Malheureusement, il faudrait une meilleure connaissance de la polymédication parmi les spécialistes d’organe. Ils ont tendance à avancer en ne regardant que l’organe dont ils sont responsables. Je peux être partial, en tant que généraliste qui croit tout savoir.
Mais c’est un vrai problème. La spécialisation a pris une importance considérable dans les années 70-80, avec les progrès technologiques. Il était difficile pour les internistes, généralistes et gériatres de suivre le rythme.
Souvent, les spécialistes—surtout les plus jeunes, moins formés à la médecine générale—ont tendance à se concentrer sur la technologie et à négliger la vision globale du patient. C’est probablement là que réside le problème.
Nous ne sommes bien sûr pas un exemple parfait, car même la Société italienne de médecine interne a rencontré des difficultés en lançant le registre. Mais nous avons au moins montré qu’une amélioration est possible.
Aborder la polymédication ne signifie pas s’y consacrer exclusivement. Moi-même, je suis expert dans un domaine relativement spécifique, comme les troubles de la coagulation ou la thrombose. Mais en fin de carrière, avec le vieillissement de la population—et peut-être mon âge—, j’ai pensé qu’il fallait s’intéresser à ce problème.
Dr. Anton Titov, MD: Merci. C’est très important, car avec le vieillissement de la population et la focalisation des spécialistes sur un organe, la polymédication reste un enjeu majeur. Elle doit être abordée par les médecins de premier recours, les gériatres et les internistes, car ce sont eux qui peuvent vraiment actionner ces leviers.


![Polypharmacie chez les patients âgés : pourquoi les médecins prescrivent-ils trop de médicaments ? 10. [Parties 1 et 2]](http://diagnosticdetectives.fr/cdn/shop/products/Dr_Pier-Mannuccio_Mannucci_thrombosis_bleeding_hematology_treatment_Diagnostic_Detectives_Network.011.jpg?v=1660905435&width=1080)
![Polypharmacie chez les patients âgés : pourquoi les médecins prescrivent-ils trop de médicaments ? 10. [Parties 1 et 2]](http://diagnosticdetectives.fr/cdn/shop/products/Dr_Pier-Mannuccio_Mannucci_thrombosis_bleeding_hematology_treatment_Diagnostic_Detectives_Network.011_cfeb155e-d136-4e10-ad5a-5130e0785b56.jpg?v=1660905445&width=1080)
![Polypharmacie chez les patients âgés : pourquoi les médecins prescrivent-ils trop de médicaments ? 10. [Parties 1 et 2]](http://diagnosticdetectives.fr/cdn/shop/products/Dr_Pier-Mannuccio_Mannucci_thrombosis_bleeding_hematology_treatment_Diagnostic_Detectives_Network.011.jpg?v=1660905435&width=720)
![Polypharmacie chez les patients âgés : pourquoi les médecins prescrivent-ils trop de médicaments ? 10. [Parties 1 et 2]](http://diagnosticdetectives.fr/cdn/shop/products/Dr_Pier-Mannuccio_Mannucci_thrombosis_bleeding_hematology_treatment_Diagnostic_Detectives_Network.011_cfeb155e-d136-4e10-ad5a-5130e0785b56.jpg?v=1660905445&width=720)