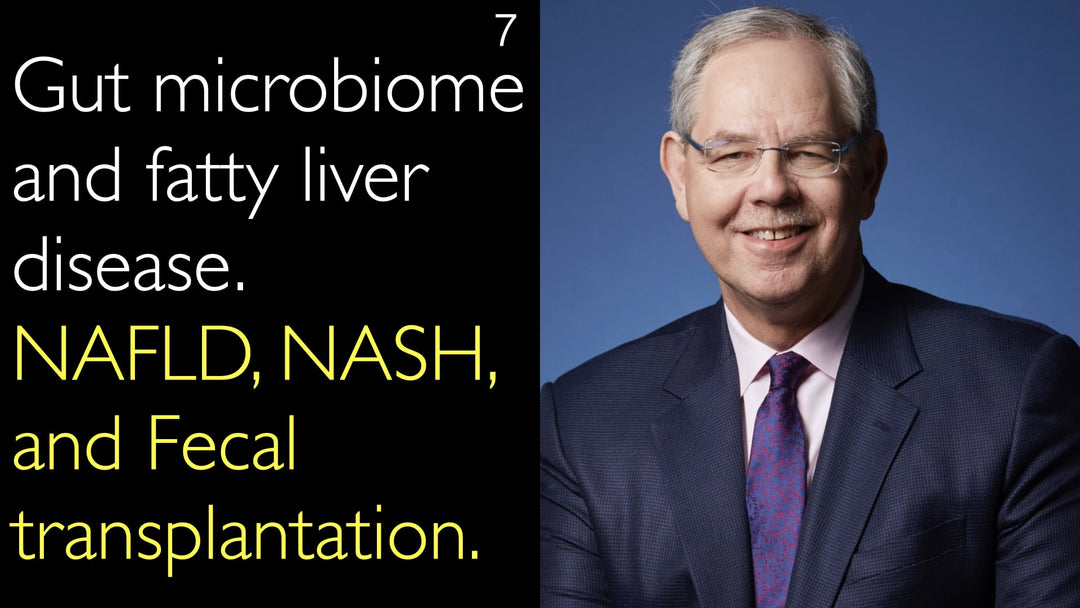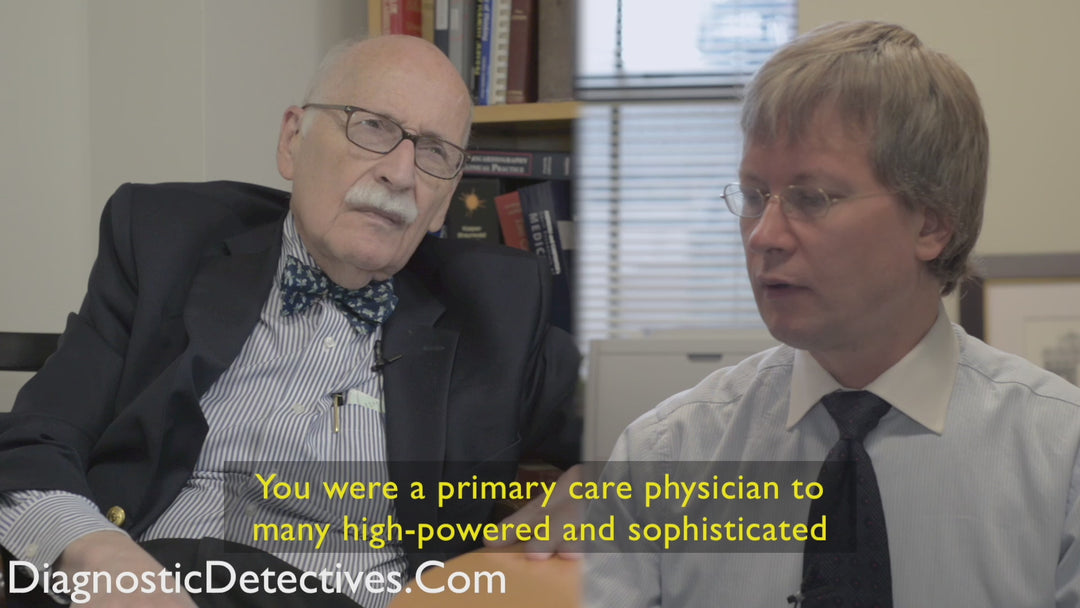Le Dr Scott Friedman, MD, expert de renommée mondiale en maladies hépatiques, explore le lien essentiel entre le microbiome intestinal et la stéatopathie métabolique. Il décrit comment l'alimentation, les antibiotiques et l'environnement domestique influencent le microbiome. Le Dr Friedman présente des preuves convaincantes issues de modèles animaux et de cas humains rares, comme le syndrome d'auto-brasserie. Il évalue également l'état actuel et le potentiel futur de la transplantation de microbiote fécal dans le traitement de la NASH (stéatohépatite non alcoolique).
Rôle du microbiote intestinal dans la NAFLD et la NASH : de la dysbiose au traitement
Aller à la section
- Lien entre microbiote et NAFLD/NASH
- Impact de l'alimentation et des antibiotiques sur le microbiote
- Explication du syndrome de l'autobrassage
- Transplantation de microbiote fécal pour le traitement de la NASH
- Recherche future sur le microbiote
- Transcript intégral
Lien entre microbiote et NAFLD/NASH
Le Dr Scott Friedman, MD, établit un lien étroit entre le microbiote intestinal et la progression de la stéatopathie hépatique non alcoolique. Il explique que des billions de bactéries résident dans l’intestin humain, formant ce qu’on appelle le microbiote. Les études sur modèles animaux et chez l’humain indiquent que certaines compositions du microbiote peuvent influencer le risque et l’évolution de la NASH.
Le Dr Friedman souligne que des preuves solides montrent que la NASH peut être transmise entre animaux par transplantation de microbiote. Cette transférabilité confirme le rôle clé du microbiote dans le développement de la maladie. Toutefois, il précise que les composants bactériens spécifiques responsables de la pathogenèse de la NASH n’ont pas encore été identifiés.
Impact de l'alimentation et des antibiotiques sur le microbiote
Selon le Dr Scott Friedman, MD, l’alimentation joue un rôle majeur dans la composition du microbiote intestinal. Il ajoute que d’autres facteurs, au-delà de l’alimentation, influencent également ce microbiote. L’environnement domestique, par exemple, affecte significativement les profils microbiens, les membres d’une même famille partageant généralement des communautés bactériennes similaires.
Le Dr Friedman avance une théorie convaincante : l’exposition aux antibiotiques pourrait expliquer l’émergence de la NASH au cours des 25 dernières années. Il note que les antibiotiques pénètrent dans notre organisme non seulement par les médicaments, mais aussi par l’alimentation. Les animaux d’élevage en reçoivent, et les plantes les absorbent, créant une exposition généralisée susceptible de modifier durablement le microbiote à l’échelle des populations. Ces modifications pourraient favoriser la rétention énergétique et l’accumulation de graisse, conduisant ainsi au développement de la NAFLD et de la NASH.
Explication du syndrome de l'autobrassage
Le Dr Scott Friedman, MD, évoque le syndrome de l’autobrassage, un exemple frappant d’interaction entre microbiote et foie. Cette affection rare implique certaines bactéries intestinales, notamment une sous-espèce de Klebsiella, qui fermentent les glucides pour produire de l’éthanol. L’alcool ainsi généré passe de l’intestin au foie via la veine porte, provoquant des lésions identiques à celles observées dans la maladie alcoolique du foie.
Lors de son entretien avec le Dr Anton Titov, MD, le Dr Friedman souligne que, bien que rare, ce syndrome montre comment des métabolites bactériens peuvent directement endommager le foie. Ce phénomène explique pourquoi la NAFLD a initialement été confondue avec une hépatopathie alcoolique. Il constitue une preuve tangible que les bactéries intestinales peuvent produire des substances toxiques pour le foie sans qu’il y ait consommation d’alcool.
Transplantation de microbiote fécal pour le traitement de la NASH
La transplantation de microbiote fécal (TMF) a été testée comme traitement potentiel de la NASH, rapporte le Dr Scott Friedman, MD. Cependant, les preuves actuelles ne permettent pas de la considérer comme une thérapie robuste ou efficace contre la stéatohépatite non alcoolique. L’effet pourrait manquer de durabilité, le microbiote tendant à revenir à son état initial après le traitement.
Le Dr Friedman explique au Dr Titov que les compositions utilisées pour la transplantation ne sont peut-être pas encore optimales. Malgré ces limites, il estime que la communauté médicale doit rester ouverte au potentiel de la TMF. À mesure que progresse la compréhension de la composition et du comportement bactériens, une manipulation ciblée du microbiote pourrait offrir des bénéfices thérapeutiques aux patients atteints de NAFLD ou de NASH.
Recherche future sur le microbiote
Le Dr Scott Friedman, MD, est convaincu que la recherche sur le microbiote permettra des avancées significatives dans le traitement de la NASH. Chercheurs académiques et entreprises travaillent activement à identifier les bactéries, virus et champignons spécifiques qui favorisent la progression de la NASH. L’objectif est de développer des stratégies thérapeutiques ciblant ces composants microbiens nocifs.
Lors de sa discussion avec le Dr Anton Titov, MD, le Dr Friedman reconnaît la difficulté de modifier durablement un microbiote établi. Il note que celui-ci tend à retrouver son état initial même après intervention. Malgré ces défis, il reste optimiste : une meilleure compréhension de la flore intestinale ouvrira la voie à des traitements efficaces basés sur le microbiote pour les maladies hépatiques.
Transcript intégral
Dr. Anton Titov, MD : Quel est le rôle de l'alimentation dans la dysbiose du microbiote intestinal dans la stéatopathie hépatique et dans la NASH ?
Dr. Scott Friedman, MD : Ce domaine est très important et en pleine expansion. Commençons par rappeler que nous hébergeons tous des billions de bactéries dans l’intestin, ce qui constitue le microbiote. Chacun possède un microbiote légèrement différent.
Néanmoins, des preuves de plus en plus nombreuses, issues de modèles animaux et d’études humaines, indiquent que la nature du microbiote peut influencer la propension et le risque de progression de la NASH. Nous n’avons pas encore identifié quelles bactéries spécifiques sont à l’origine de ce risque.
Mais il est solidement établi que la NASH peut être transférée d’un animal à un autre par transplantation de microbiote. Certaines observations cliniques montrent même que la transplantation de microbiote peut soit transmettre, soit atténuer le risque de NASH.
Nous sommes donc certains qu’il existe un lien fort entre le microbiote et la NASH. Mais nous ne maîtrisons pas encore suffisamment ses composants pour en faire une thérapeutique ou pour manipuler le microbiote dans un but curatif.
L’alimentation influence beaucoup le microbiote, mais elle n’est pas le seul facteur. Le foyer dans lequel on vit compte aussi : les membres d’une même famille partagent généralement un microbiote similaire.
L’exposition aux antibiotiques joue également un rôle. N’oublions pas que ceux-ci ne proviennent pas seulement des médicaments prescrits pour un rhume ou une infection bactérienne—ils sont aussi présents dans notre alimentation.
Les animaux d’élevage reçoivent des antibiotiques. Les plantes et céréales y sont exposées. Une théorie que je trouve très convaincante suggère que l’émergence de la NASH ces 25 dernières années pourrait s’expliquer par une modification systématique du microbiote à l’échelle populationnelle, due à cette exposition pervasive aux antibiotiques. Ceux-ci favoriseraient l’émergence de bactéries augmentant la rétention énergétique et l’accumulation de graisses, menant ainsi à la NAFLD et à la NASH.
L’un des grands défis est d’identifier les composants clés du microbiote responsables de la NASH. Ensuite, nous pourrons chercher à les atténuer ou à modifier le microbiote. Nous n’y sommes pas encore.
Mais de nombreux chercheurs académiques et entreprises sont sur la piste des bactéries, virus ou champignons causaux de la NASH. L’objectif est de cibler ces éléments pour freiner l’apparition ou la progression de la maladie.
Comme je l’ai mentionné, modifier le microbiote est difficile. Nous avons un microbiote relativement stable. Même après une modification, il tend à revenir à son état initial, ce qui maintient le risque de NASH.
Dr. Anton Titov, MD : Professeur Friedman, dans l’une de vos revues, vous mentionnez le syndrome de l’autobrassage, où une fermentation microbienne des glucides dans l’intestin produit de l’alcool endogène, nocif pour le foie. Pouvez-vous développer ?
Dr. Scott Friedman, MD : Il s’agit d’une situation très intéressante et probablement rare. Quelques cas ont été décrits, dont un rapport convaincant venant de Chine.
Il concernait une bactérie particulière, une sous-espèce de Klebsiella, qui produisait de l’éthanol. Celui-ci passait de l’intestin au foie via la veine porte, endommageant le foie en raison des taux élevés d’éthanol.
Pourquoi est-ce fascinant ? Parce que rappelons-nous que nous appelons cette maladie « stéatopathie hépatique non alcoolique ».
Pourquoi « non alcoolique » ?
Parce qu’à ses débuts, elle ressemblait à une hépatopathie alcoolique. Les patients étaient souvent suspectés de boire en cachette. Il a fallu du temps pour comprendre que, bien que similaire, elle n’était pas liée à l’alcool.
Le syndrome de l’autobrassage n’est probablement pas une cause majeure de NASH. Mais il illustre comment, dans des cas extrêmes, les bactéries intestinales peuvent provoquer des lésions hépatiques—ici via l’éthanol.
C’est un exemple, peut-être y en a-t-il d’autres, où les bactéries produisent un métabolite—en l’occurrence l’éthanol—qui cause une hépatopathie sans que le patient ne consomme d’alcool. Les microbes en produisent qui atteint le foie et l’endommage.
Dr. Anton Titov, MD : Vous avez évoqué la transplantation de microbiote fécal. A-t-elle été essayée pour traiter la stéatohépatite non alcoolique, la NASH, et la stéatopathie hépatique ?
Dr. Scott Friedman, MD : Elle a été testée ponctuellement. Jusqu’à présent, aucune grande étude ne démontre de façon convaincante que la TMF est une thérapie robuste et efficace contre la NASH.
Il se peut que nous n’utilisions pas le bon microbiote, ou que la transplantation manque de durabilité—les microbes revenant à leur état antérieur.
Je dirais donc qu’il n’existe pas encore de preuve solide que la TMF soit une thérapie viable généralisée pour la NAFLD ou la NASH. Mais le jury est encore délibéré.
À mesure que nous approfondissons notre compréhension de la composition et du comportement des bactéries intestinales, je suis confiant que nous verrons des percées montrant qu’une manipulation sélective du microbiote, par TMF ou autre moyen, pourra bénéficier aux patients atteints de NAFLD ou de NASH. Nous n’en sommes simplement pas encore là.