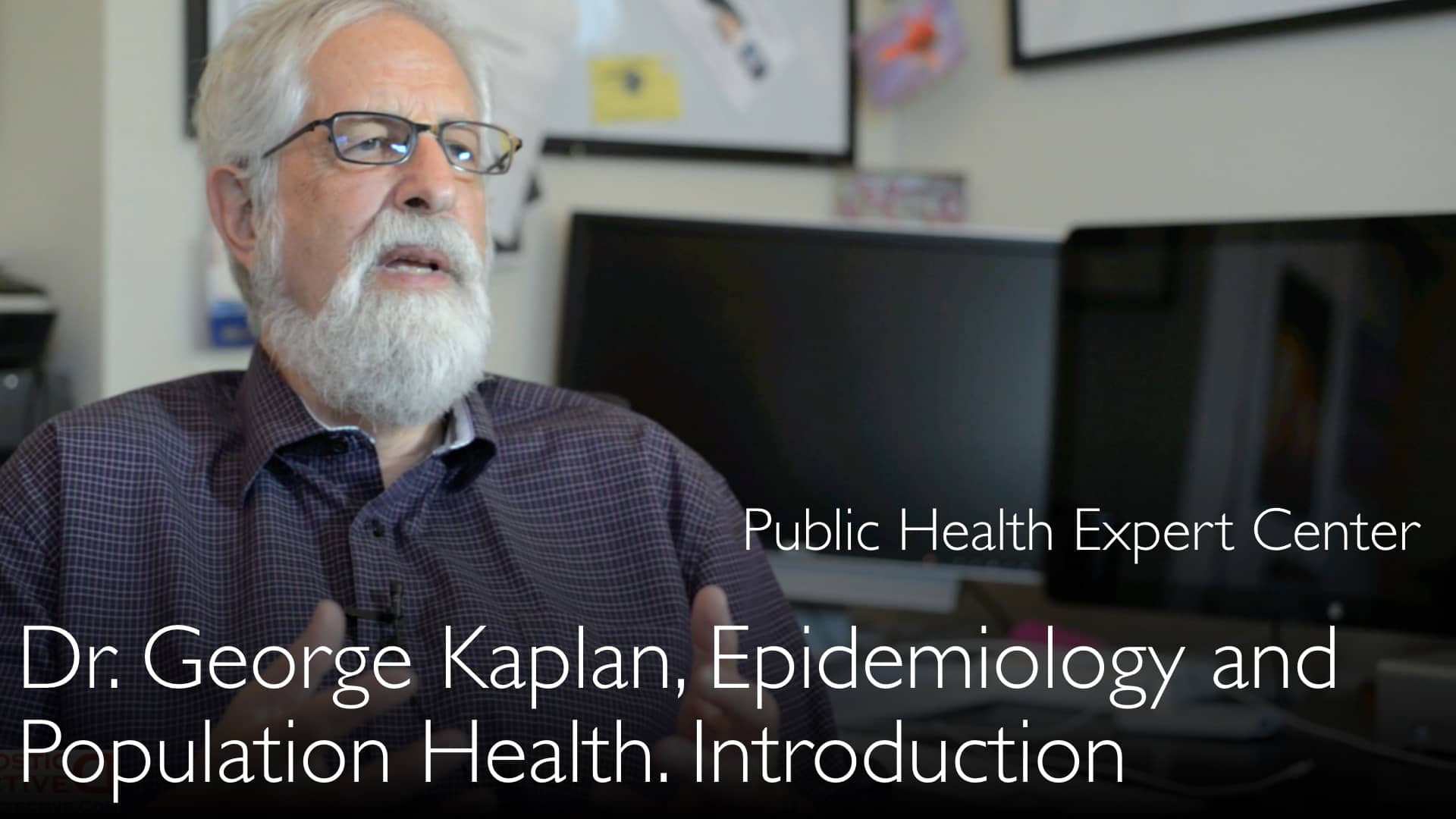Le Dr George Kaplan, MD, expert de premier plan en épidémiologie sociale et santé des populations, explique comment la mobilité socioéconomique est entravée par des facteurs systémiques et l’automatisation. Il préconise des investissements tout au long de la vie, des changements de politiques sociétales et une perspective mondiale pour réduire les inégalités et améliorer les résultats de santé des populations défavorisées.
Défis de la mobilité socioéconomique et solutions politiques pour l'équité en santé
Aller à la section
- La crise de la mobilité socioéconomique
- Dépasser le mythe de la méritocratie
- Mécanismes politiques de réduction de la pauvreté
- Investissements stratégiques tout au long de la vie
- Rendements de l'éducation et montée des inégalités
- Un phénomène mondial exigeant des solutions globales
La crise de la mobilité socioéconomique
Les économies modernes dressent d’importants obstacles à la mobilité ascendante. Le docteur George Kaplan, médecin, soulève un problème crucial : aux États-Unis, deux tiers des personnes vivant sous le seuil de pauvreté travaillent à temps plein. Ces patients sont souvent piégés dans des emplois de services peu rémunérés, sans bénéficier des avantages ou de la sécurité économique dont jouit la classe moyenne. Le docteur Kaplan cite les analyses de l’économiste Pavlina Chernova, qui montrent que la plupart des salariés n’ont pas profité des récentes reprises économiques.
Une menace plus profonde vient de la numérisation et de l’automatisation. Les études indiquent que 47 % des quelque 700 types d’emplois existants risquent d’être automatisés dans les deux prochaines décennies. Cette révolution technologique creuse un fossé considérable, réservant potentiellement les postes bien payés à une minorité qualifiée et aisée, tandis que 85 à 90 % de la population se retrouve avec peu de perspectives économiques.
Dépasser le mythe de la méritocratie
Pour relever ces défis, un changement de perspective s’impose. Le docteur George Kaplan affirme qu’il faut renoncer à l’idée d’une société purement méritocratique. Le succès ne dépend pas uniquement du mérite ou des compétences, mais aussi de nombreux autres facteurs. Cette prise de conscience modifie notre regard sur la pauvreté.
Le docteur Kaplan insiste : il ne faut pas considérer les personnes pauvres comme indignes, mais plutôt comme des individus qui, comme tout le monde, manquent simplement de ressources financières. Cette reformulation est essentielle, car elle ouvre la voie à des politiques sociales différentes, plus compassionnelles, visant un soutien véritable plutôt que la punition ou l’indifférence.
Mécanismes politiques de réduction de la pauvreté
Des solutions efficaces existent et ont été mises en œuvre avec des résultats variables selon les pays. Le docteur George Kaplan explique que les mécanismes sociétaux et monétaires peuvent radicalement modifier la répartition des revenus. Les systèmes fiscaux et de transferts dans de nombreux pays de l’Union européenne, par exemple, ont considérablement réduit les taux de pauvreté chez les enfants et les adultes.
Le docteur Kaplan relève un contraste frappant : « La France accomplit un énorme travail là-dessus, les États-Unis font plutôt piètre figure ». Ces politiques permettent une redistribution des ressources publiques, donnant accès à des services essentiels, à l’éducation et à des opportunités autrement inaccessibles. Le docteur Anton Titov, qui anime cet échange, facilite la discussion sur l’efficacité comparative des politiques.
Investissements stratégiques tout au long de la vie
Les interventions doivent être globales et se poursuivre tout au long de la vie. Le docteur Kaplan souligne l’importance cruciale des interventions précoces dans l’enfance, évoquant l’écart langagier : à quatre ans, les enfants de familles modestes ont entendu 13 millions de mots de moins et un langage moins complexe. Ces expériences précoces façonnent directement les compétences cognitives et relationnelles nécessaires aux futurs emplois mieux rémunérés.
Mais le docteur Kaplan met en garde : l’investissement ne doit pas s’arrêter là. Une cohorte de jeunes adultes très éduqués échouera sans emplois disponibles. De même, les personnes âgées privées d’un système de retraite solide deviennent un poids pour la société. La solution exige des investissements stratégiques à chaque étape de la vie, évitant les conflits générationnels et assurant un soutien de la petite enfance jusqu’à un âge avancé.
Rendements de l'éducation et montée des inégalités
Les rendements économiques extrêmes de l’éducation et du capital ne sont pas une fatalité des économies modernes, mais résultent de choix politiques. Le docteur Kaplan remet en cause l’idée qu’un PDG gagnant 400 fois plus qu’un ouvrier soit une conséquence économique inévitable. Cette disparité reflète des politiques fiscales spécifiques, des cultures d’entreprise privilégiant parfois la cupidité au bien commun, et une négligence de l’investissement dans les employés comme bénéfique à la société.
Cette dynamique a entraîné une explosion des inégalités dans de nombreux pays, une tendance largement documentée par des économistes comme Thomas Piketty. Le docteur Kaplan souligne que ces résultats « ne sont pas automatiques. Ils ne découlent pas de notre biologie ». Ils sont le fruit direct de décisions prises par les politiques et les individus, qu’il faut constamment évaluer à l’aune de leurs effets sur la santé des populations.
Un phénomène mondial exigeant des solutions globales
Les inégalités extrêmes et la mobilité entravée ne connaissent pas de frontières ; c’est un défi mondial. Le docteur Kaplan note que des villes comme Moscou et New York abritent les plus fortes concentrations de milliardaires, tandis que beaucoup d’autres populations peinent. Cette polarisation est une force sociale puissante aux implications planétaires, alors que la richesse circule au-delà des frontières—comme en témoignent les investisseurs russes achetant des appartements de luxe à Manhattan.
Les solutions doivent donc aussi être mondiales. Le docteur Kaplan conclut qu’il faut réfléchir à la manière dont les pratiques globales alimentent les inégalités et, surtout, comment elles affectent la santé et le bien-être des populations partout dans le monde. Un effort international concerté est nécessaire pour bâtir des systèmes économiques favorisant l’équité en santé pour tous. Le docteur Anton Titov aide à cadrer cette question complexe pour un public médical soucieux de la santé des populations.
Transcription intégrale
Docteur Anton Titov, médecin : Parlons des moyens d’améliorer le statut socioéconomique et, espérons-le, d’aider dans la vie moderne. Les ascenseurs sociaux ne fonctionnent pas aussi bien qu’ils le devraient. Vous avez raison dans vos travaux : de nombreux patients pauvres travaillent, mais sans bénéficier des avantages auxquels accède la classe moyenne.
Aux États-Unis, deux tiers des patients sous le seuil de pauvreté travaillaient à temps plein, souvent dans des emplois de services peu rémunérés. De plus, contrairement aux reprises précédentes, la plupart des salariés américains n’ont pas profité de la récente relance économique.
Un graphique frappant, basé sur l’analyse de Pavlina Chernova, illustre cela. Je ne suis guère optimiste quant à une amélioration pour les patients de statut modeste. Un article récent du magazine The Economist, « La troisième grande vague », indique que la révolution numérique creuse un fossé entre une minorité qualifiée et aisée et le reste de la société.
Les recherches montrent que 47 % des quelque 700 types d’emplois actuels risquent d’être automatisés, susceptibles de disparaître dans une ou deux décennies. The Economist affirme que l’innovation permettra à des individus motivés, talentueux et consciencieux de rejoindre le cercle restreint des travailleurs très bien payés. Mais les 85 à 90 % restants pourraient trouver peu de place dans la nouvelle économie.
Cet avenir est assez inquiétant. Comme vous l’avez écrit, on estime qu’avant quatre ans, les enfants de familles modestes entendent moins d’un tiers des mots prononcés par des adultes par rapport aux enfants de familles de cadres, soit 13 millions de mots de moins. Ils entendent aussi des phrases moins complexes et davantage d’interdictions.
Or, la richesse et la complexité du langage développent précisément les compétences cognitives et relationnelles de l’enfant—celles-là mêmes qui seront exigées pour les emplois mieux rémunérés à venir. Rien ne présage d’un avenir favorable pour ces enfants sur le marché du travail.
Que peuvent faire la société, le gouvernement et les organisations de santé pour améliorer le sort des patients, face à ces statistiques et tendances plutôt sombres ?
Docteur George Kaplan, médecin : Vaste question. Commençons par dire qu’il faut cesser de croire que le succès dans la société relève d’une méritocratie. Il est faux de penser que les patients atteignent le sommet uniquement par le mérite ou le savoir. Bien d’autres facteurs entrent en jeu.
Il faut considérer les personnes pauvres non comme indignes, mais, comme on l’a dit, comme des gens comme vous et moi qui manquent d’argent. Cette vision conduit à des politiques sociales totalement différentes.
En comparant les pays, on observe d’énormes variations dans les mécanismes sociétaux aidant les patients à s’élever. Les systèmes fiscaux et de transferts dans l’UE, par exemple, réduisent considérablement la pauvreté des enfants et des adultes.
Pourtant, des écarts persistent : la France accomplit un énorme travail ; les États-Unis font plutôt piètre figure. Je recommande à toute personne intéressée de consulter les nombreux rapports sur ces différences.
Premièrement, nous disposons de mécanismes sociétaux et monétaires. Ils peuvent modifier la distribution des revenus, redistribuer les ressources publiques et donner accès à des biens et services autrement inaccessibles. C’est une partie de la solution.
Deuxièmement, il faut penser aux investissements tout au long de la vie. Les interventions précoces, comme l’exemple que vous citez—l’enfant exposé à moins de mots et développant moins de complexité cognitive—transforment radicalement sa capacité à acquérir les compétences nécessaires pour réussir.
Mais attention : même avec une éducation solide, des jeunes de 18 ou 20 ans échoueront sans emplois. De même, des personnes âgées sans retraite deviendront un fardeau. Il faut des investissements stratégiques à chaque étape, sans opposition entre générations.
Enfin, interrogeons-nous sur les rendements croissants de l’éducation—les gains économiques. De nombreux économistes, et The Economist le suggère, soulignent qu’un PDG gagnant 400 fois le salaire d’un ouvrier n’est pas une conséquence automatique.
Cela reflète des politiques fiscales, des cultures d’entreprise privilégiant parfois la cupidité, et une vision où investir dans les employés n’est pas perçu comme bénéfique à la société.
Il existe donc tout un éventail d’interventions socioéconomiques, mises en œuvre différemment selon les sociétés. Être au chômage en Suède est très différent qu’aux États-Unis. Ces politiques varient.
Nous devons faire face à l’explosion des inégalités dans de nombreux pays. The Economist en a parlé ; beaucoup citent Piketty, l’économiste français désormais célèbre. Ces phénomènes ne sont pas automatiques ; ils ne relèvent pas de la biologie.
Ils découlent de décisions prises par les politiques et les individus. Nous devons constamment nous demander : ces décisions sont-elles favorables ou défavorables à la santé ?
La Russie est devenue l’une des sociétés les plus polarisées. Moscou compte la plus forte concentration de milliardaires au monde ; New York arrive deuxième. La Russie représente une faiblesse, et pas seulement depuis quelques décennies. C’est aussi une force sociale considérable.
Je sais que certains appartements de luxe à 80 millions de dollars à Manhattan sont achetés par des Russes, ce qui en fait un phénomène mondial. Cela dépasse le cadre local. Nous devons y réfléchir à l’échelle planétaire.
Il faut examiner comment les pratiques mondiales y contribuent et, surtout, comment elles influencent la santé et le bien-être des populations.