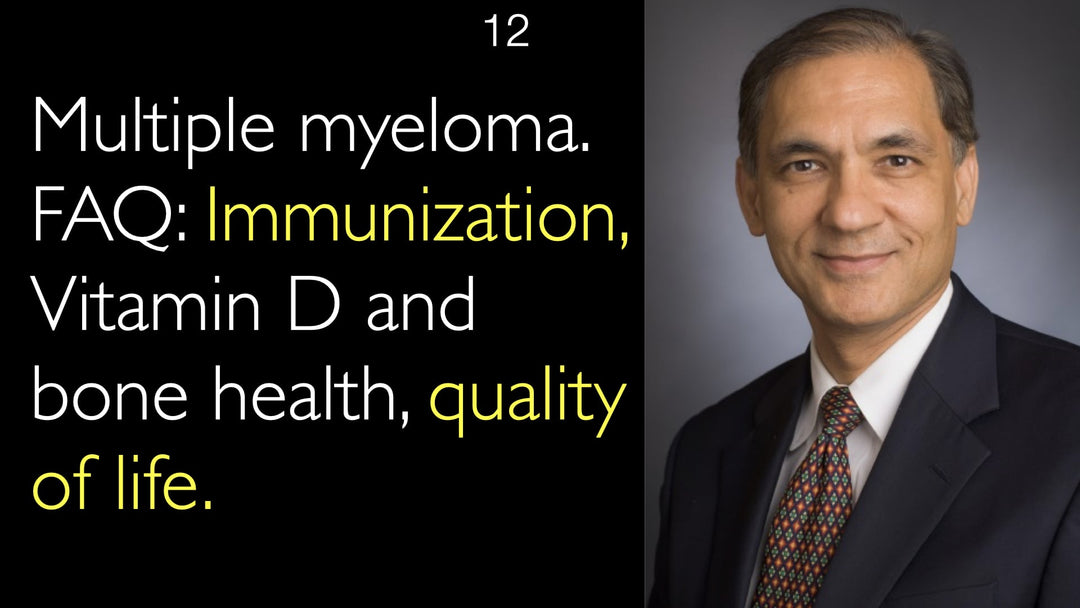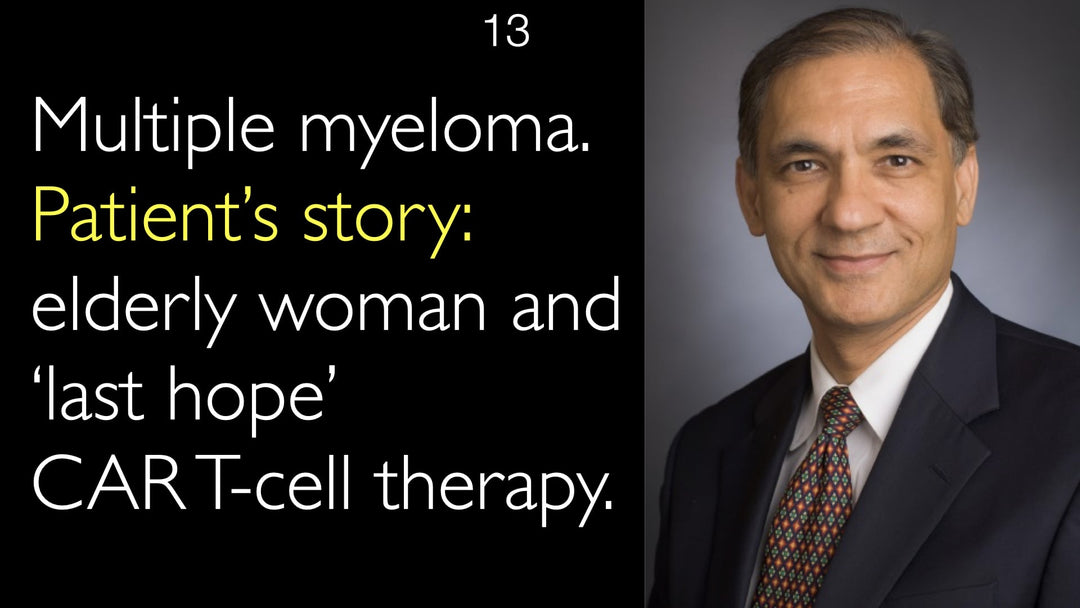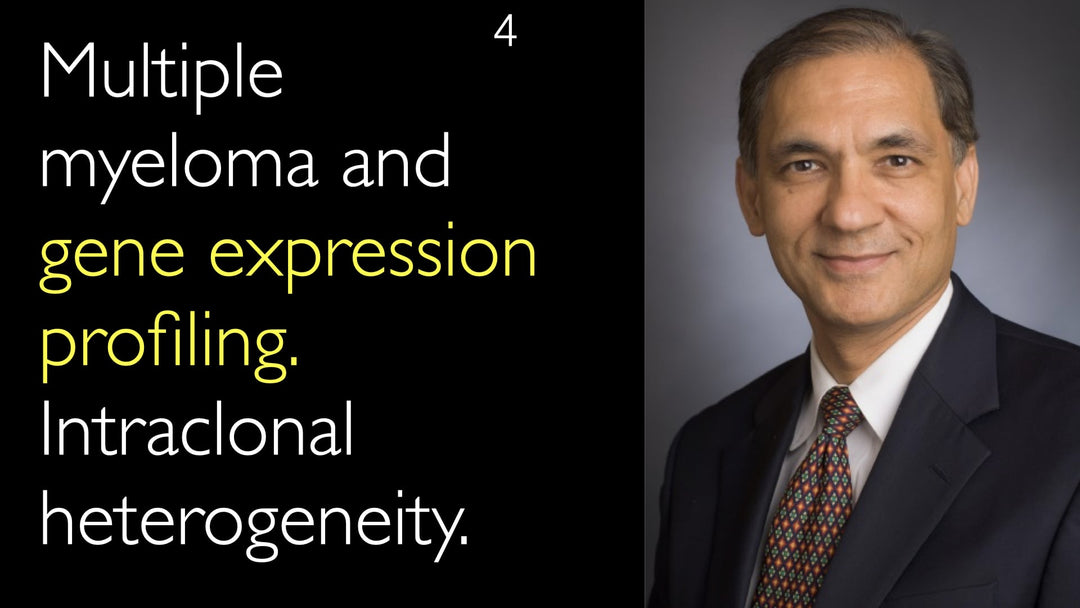Le Dr Nikhil Munshi, MD, expert de renom en génétique du myélome multiple, décrit les altérations génétiques majeures qui sous-tendent la progression de la maladie. Il explique comment certaines anomalies chromosomiques apparaissent très tôt, dès le stade de gammapathie monoclonale de signification indéterminée (GMSI) ou de myélome indolent. Des mutations génétiques secondaires et des modifications de l’ADN non codant interviennent ensuite pour favoriser le passage au myélome multiple actif. La compréhension de cette évolution génétique est essentielle pour élaborer de nouvelles approches préventives et thérapeutiques.
Évolution génétique du myélome multiple : de la MGUS à la maladie active
Aller à la section
- Altérations génétiques précoces dans la MGUS et le MM indolent
- Deux sous-types génétiques distincts du myélome
- Modifications chromosomiques du myélome hyperdiploïde
- Les mutations secondaires conduisent à la progression de la maladie
- Implications cliniques et recherches futures
- Transcription intégrale
Altérations génétiques précoces dans la MGUS et le MM indolent
Le myélome multiple suit une progression pathologique prévisible. Le Dr Nikhil Munshi explique que la maladie est généralement précédée d’une gammapathie monoclonale de signification indéterminée (MGUS), qui évolue ensuite vers un myélome multiple indolent (MM indolent) avant de devenir actif. Il est important de souligner qu’environ 1 % seulement des patients atteints de MGUS progressent chaque année vers un myélome multiple.
Les travaux du Dr Munshi montrent que des altérations génétiques majeures surviennent très tôt dans ce processus. Des anomalies chromosomiques et des translocations sont déjà présentes au stade de MGUS. Ces modifications initiales déclenchent les signaux responsables de la croissance anormale des plasmocytes. Ces fondations génétiques précoces préparent le terrain pour une éventuelle progression de la maladie.
Deux sous-types génétiques distincts du myélome
Le myélome multiple présente deux profils génétiques principaux, selon le Dr Nikhil Munshi. Environ la moitié des cas correspondent à un myélome hyperdiploïde, caractérisé par la présence de copies supplémentaires de certains chromosomes. L’autre moitié présente des translocations impliquant le chromosome 14. Malgré ces différences génétiques, les deux mécanismes conduisent à la même maladie clinique.
Le Dr Munshi souligne que ces deux sous-types apparaissent précocement dans le spectre de la maladie. Ces modifications chromosomiques fondamentales sont déjà établies au stade de MGUS. Son laboratoire s’est concentré sur le décryptage de l’évolution de ces altérations du nombre de copies au cours du développement du myélome.
Modifications chromosomiques du myélome hyperdiploïde
Le myélome hyperdiploïde se caractérise par des gains chromosomiques spécifiques qui servent de marqueurs de la maladie. Le Dr Nikhil Munshi identifie six à sept chromosomes présentant typiquement une trisomie dans ce sous-type, notamment les chromosomes 3, 5, 7, 9, 11, 15 et 19. La recherche révèle des schémas critiques dans l’accumulation de ces modifications.
L’équipe du Dr Munshi a constaté que certains gains chromosomiques apparaissent systématiquement ensemble. La présence de deux de ces trisomies est observée dans près de 100 % des cas hyperdiploïdes, ce qui indique qu’il s’agit d’altérations génétiques précoces et fondamentales initiant le processus pathologique. Des pertes chromosomiques ultérieures contribuent ensuite à l’évolution vers un myélome multiple actif.
Les mutations secondaires conduisent à la progression de la maladie
La transition du myélome indolent vers le myélome multiple symptomatique nécessite des événements génétiques supplémentaires. Le Dr Nikhil Munshi explique que des mutations secondaires, ainsi que des altérations plus subtiles dans les régions non codantes de l’ADN, déclenchent cette progression. Des modifications transcriptomiques contribuent également à l’activation de la maladie.
Le Dr Munshi souligne que si les altérations chromosomiques précoces établissent la MGUS et le MM indolent, d’autres mécanismes interviennent dans le passage à la maladie symptomatique. De nombreux gènes acquièrent des mutations durant cette phase de transition. Comprendre ces événements génétiques secondaires est essentiel pour développer des interventions visant à prévenir la progression vers le myélome multiple actif.
Implications cliniques et recherches futures
Décrypter l’évolution génétique du myélome multiple a des retombées cliniques importantes. Le Dr Nikhil Munshi souligne comment ces connaissances éclairent le développement thérapeutique. Comprendre la séquence des modifications génétiques permet de cibler des voies spécifiques à différents stades de la maladie, ouvrant la voie à des stratégies thérapeutiques plus efficaces.
La recherche ouvre également des perspectives en matière de prévention. En identifiant précocement les patients présentant des profils génétiques à haut risque, les cliniciens pourraient intervenir avant la progression. Les travaux du Dr Munshi représentent une avancée majeure dans la compréhension du spectre génétique complet du myélome multiple, ce qui bénéficiera in fine aux soins et au pronostic des patients.
Transcription intégrale
Dr Anton Titov : Le myélome multiple est généralement précédé d’un état prémalin appelé MGUS (gammapathie monoclonale de signification indéterminée). La MGUS évolue ensuite en myélome indolent (MM indolent), avant de donner lieu à un myélome multiple. Mais seulement 1 % des personnes atteintes de MGUS développent un myélome multiple chaque année.
Vous êtes un expert mondialement reconnu des altérations génétiques dans le myélome multiple. Quelles sont les principales modifications génétiques intervenant au cours de son développement ? Beaucoup s’y intéressent, car une meilleure compréhension de ce processus pourrait permettre de prévenir la progression, voire le développement de la MGUS ou du myélome indolent.
Dr Nikhil Munshi : Notre laboratoire s’est attelé, il y a quelques années, à décrypter l’évolution des altérations du nombre de copies dans le myélome. On observe deux profils : environ la moitié des myélomes présentent une augmentation du nombre de certains chromosomes—on parle de trisomie ou de myélome hyperdiploïde. L’autre moitié présente principalement des translocations impliquant le chromosome 14. Ces deux types présentent des altérations génétiques très différentes, mais aboutissent au même résultat.
Nous avons cherché à identifier quelles modifications surviennent en premier et lesquelles interviennent ensuite, conduisant finalement au développement du myélome. Étonnamment, nous avons constaté que ces altérations du nombre de copies et ces translocations apparaissent très tôt—dès le stade de MGUS ou de myélome indolent.
Ainsi, certaines de ces modifications chromosomiques sont cruciales pour induire les signaux initiaux responsables de la croissance des plasmocytes, menant à la MGUS et au myélome indolent. C’est un point important.
Parmi les chromosomes concernés, nous avons commencé à identifier ceux qui sont de véritables moteurs. Dans le myélome hyperdiploïde, six à sept chromosomes présentent typiquement une trisomie : les chromosomes 3, 5, 7, 9, 11, 15 et 19. Nous avons observé que les chromosomes 3 et 5 sont presque toujours impliqués—dans près de 100 % des cas. Cela indique qu’il s’agit d’une altération précoce.
Cette modification marque le début du développement de la maladie. Ensuite, d’autres altérations chromosomiques surviennent. Nous avons également identifié des pertes chromosomiques qui jouent un rôle dans l’évolution vers le myélome.
Cependant, ces modifications sont précoces. Nous émettons l’hypothèse qu’elles sont nécessaires au développement de la MGUS et du myélome indolent, mais qu’un autre mécanisme est requis pour passer à la maladie symptomatique, qui nécessite un traitement.
Nous pensons qu’il s’agit de modifications secondaires—liées à des mutations. Notre équipe et d’autres ont identifié plusieurs gènes mutés. Ces mutations s’accompagnent également d’altérations plus subtiles dans les régions non codantes de l’ADN et de diverses modifications transcriptomiques.
Ainsi, nous commençons à distinguer les altérations précoces et tardives impliquées dans le développement du myélome. La compréhension de l’ensemble de ce spectre nous aide à démêler les mécanismes à l’origine de la maladie.
Il s’agit d’une avancée importante, car elle orientera les stratégies thérapeutiques et préventives pour cette maladie.