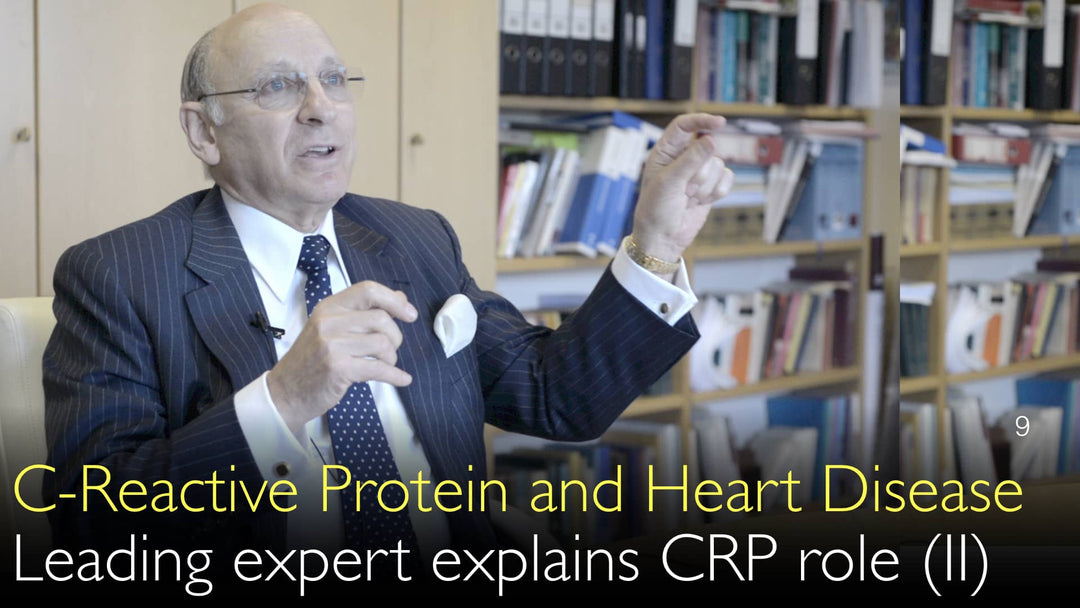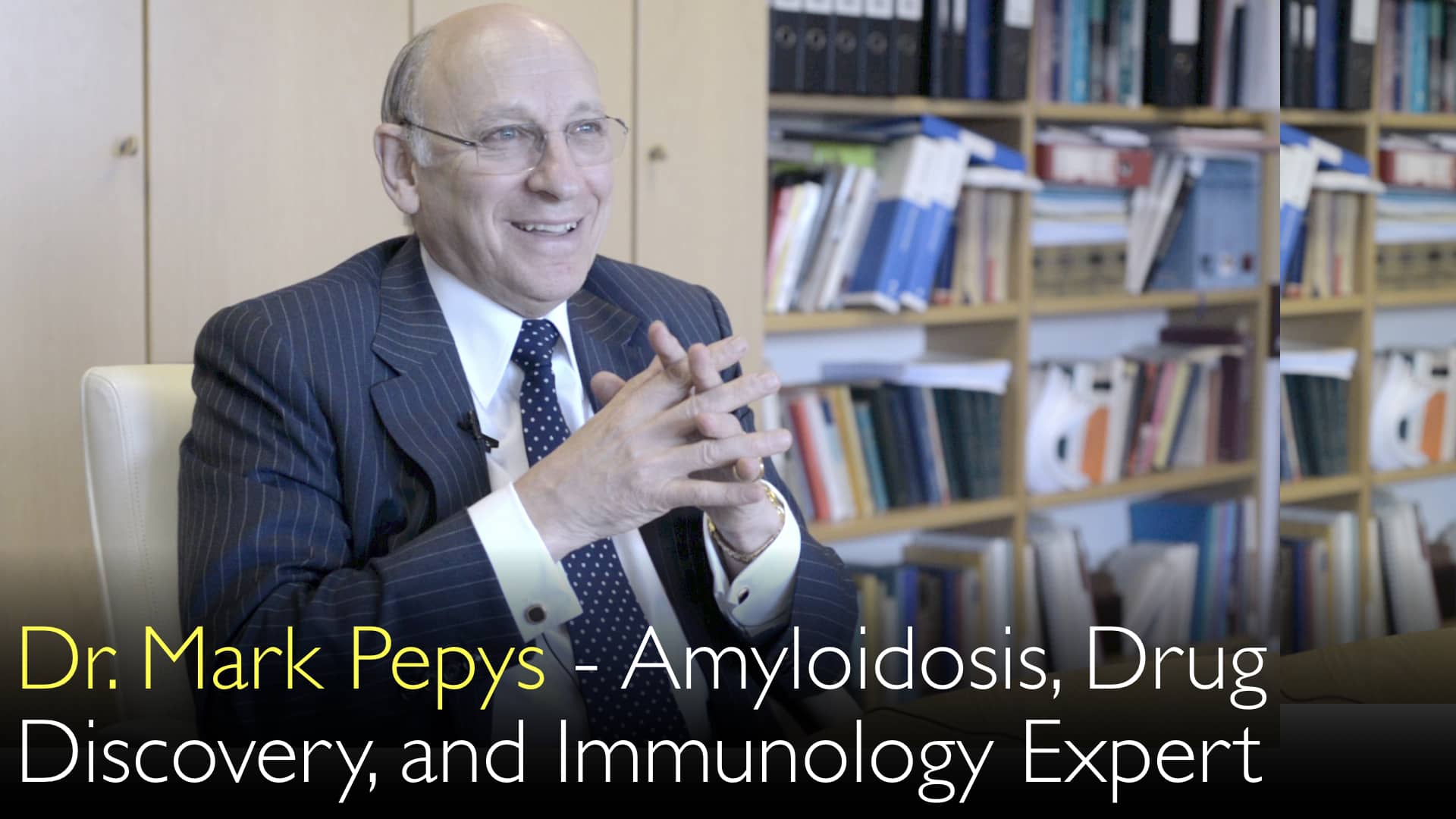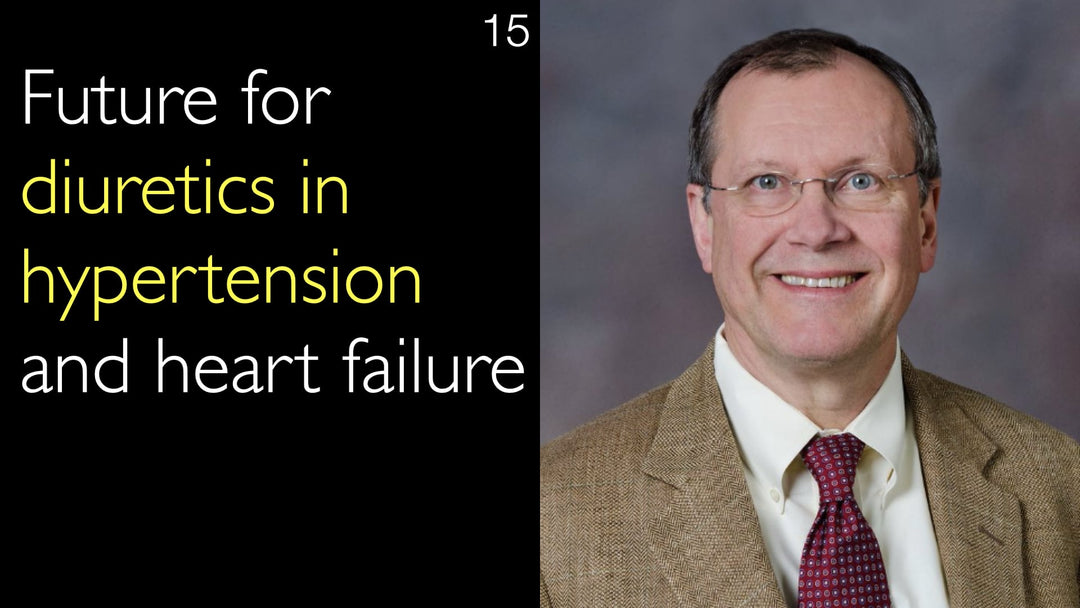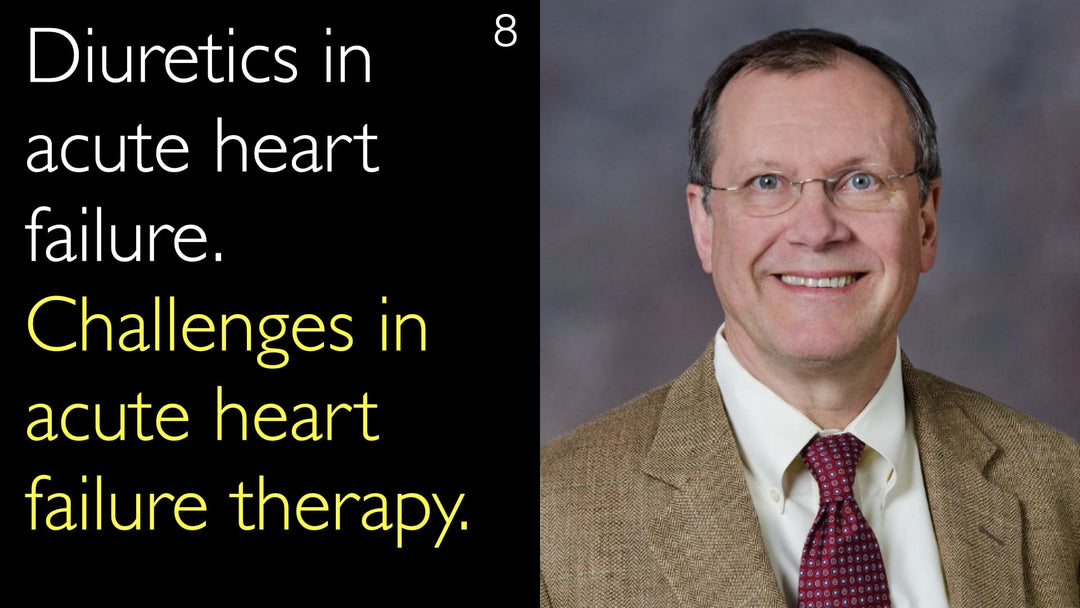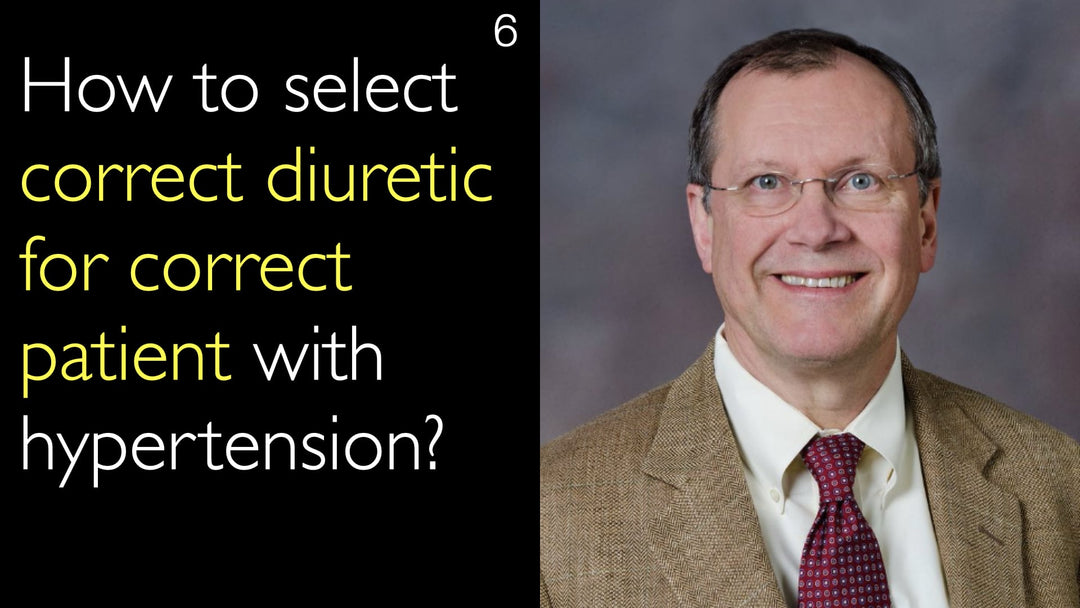Le Dr Mark Pepys, MD, expert de renom en immunologie et en recherche sur la protéine C-réactive, clarifie le rôle réel de la CRP dans les maladies cardiaques. Il souligne que la CRP n’est pas un facteur de risque causal des événements cardiovasculaires. Le Dr Pepys explique comment les premières études ont été égarées par l’utilisation d’une protéine impure, confondant corrélation et causalité. Il partage la découverte de son équipe : la CRP aggrave en réalité les lésions lors d’un infarctus du myocarde ou d’un accident vasculaire cérébral. Le Dr Mark Pepys, MD, aborde également le développement d’un composé thérapeutique conçu pour bloquer la CRP et réduire les dommages cardiaques.
Comprendre la protéine C-réactive : Marqueur de risque ou cause dans la maladie cardiaque ?
Aller à la section
- La CRP comme marqueur de risque, non comme cause
- Limites des premières études sur la CRP
- Preuves génétiques infirmant un rôle causal
- Le véritable rôle biologique de la CRP
- La CRP aggrave les lésions de l’infarctus
- Cible thérapeutique et développement médicamenteux
- Transcription intégrale
La CRP comme marqueur de risque, non comme cause
Le docteur Mark Pepys établit une distinction essentielle entre marqueur de risque et facteur de risque dans les maladies cardiovasculaires. Un facteur de risque, comme le cholestérol, participe directement au processus pathologique : réduire le cholestérol protège contre l’athérosclérose. En revanche, la protéine C-réactive n’est qu’un marqueur de risque modérément significatif. Le docteur Pepys souligne qu’il s’agit d’un enjeu scientifique sérieux, et non d’une simple question de sémantique. La confusion entre association et causalité a conduit à une mécompréhension généralisée du rôle de la CRP dans la santé cardiaque.
Limites des premières études sur la CRP
Le docteur Mark Pepys explique comment les premières études épidémiologiques ont produit des résultats trompeurs. Ces essais incluaient des milliers de personnes mais ne comptaient qu’un nombre très faible d’infarctus réels, ce qui a favorisé l’apparition d’anomalies statistiques suggérant une association très forte entre la CRP basale et les infarctus futurs. Lorsque la recherche s’est étendue à des centaines de milliers de participants dans des méta-analyses, l’association s’est révélée beaucoup plus faible. Le docteur Pepys note que des associations aussi modestes sont observées avec d’autres marqueurs inflammatoires comme une faible albumine ou une vitesse de sédimentation (VS) élevée, ce qui indique qu’il n’y a rien de spécifique à la CRP.
Une confusion supplémentaire est venue d’expériences in vitro défectueuses. La CRP d’origine commerciale était souvent impure et contaminée par du lipopolysaccharide bactérien, un puissant agent pro-inflammatoire. Lorsque cette CRP contaminée était appliquée sur des cellules, elle provoquait une forte réponse inflammatoire, que les chercheurs ont incorrectement attribuée à la CRP elle-même. Le docteur Anton Titov échange avec le docteur Pepys sur ces résultats, ce dernier soulignant l’importance de l’utilisation de réactifs purs en recherche médicale.
Preuves génétiques infirmant un rôle causal
La preuve la plus solide contre un rôle causal de la CRP dans les maladies cardiaques provient de l’épidémiologie génétique, en particulier de la randomisation mendélienne. Le docteur Mark Pepys décrit comment certains gènes contrôlent le taux basal de CRP d’un individu. Certaines personnes ont naturellement une CRP basse, autour de 0,1 mg/L, tandis que d’autres présentent un taux basal proche de 5 mg/L. Si la CRP était un facteur causal, les personnes porteuses de gènes associés à une CRP élevée auraient une incidence significativement plus élevée de maladies cardiovasculaires. Or, de vastes études génétiques ne montrent aucune relation entre ces gènes contrôlant la CRP et le risque d’infarctus ou d’accidents vasculaires cérébraux. Cela prouve de manière incontestable que la CRP ne cause pas d’événements cardiovasculaires.
Le véritable rôle biologique de la CRP
Le docteur Mark Pepys clarifie la fonction biologique réelle de la protéine C-réactive. La CRP est une protéine de liaison, étroitement apparentée à la composante sérique P amyloïde (SAP). Elle reconnaît et se lie aux résidus de phosphocholine exposés sur les membranes des cellules mortes ou endommagées. Cette liaison active le système du complément, une partie du système immunitaire chargée d’éliminer les débris cellulaires et les pathogènes. Dans ce rôle, la CRP agit comme un éboueur utile, aidant l’organisme à nettoyer après une lésion ou une mort cellulaire. Ce processus fait partie intégrante des mécanismes de défense et de réparation de l’organisme.
La CRP aggrave les lésions de l’infarctus
Malgré son rôle bénéfique dans l’élimination des débris, le docteur Mark Pepys et son équipe ont fait une découverte majeure en 1999. Dans le contexte d’un événement aigu comme un infarctus, l’activité de la CRP devient nocive. Durant un infarctus du myocarde, une artère coronaire obstruée provoque la mort des cellules musculaires cardiaques par manque d’oxygène. La CRP se lie à ces cellules mourantes et active le système du complément. Cette activation amplifie considérablement la réponse inflammatoire, augmentant la taille de l’infarctus et les lésions qui en résultent. L’équipe du docteur Pepys a validé ce mécanisme dans des modèles animaux, montrant que la perfusion de CRP humaine chez des rats avec des infarctus induits aggravait les lésions de manière dépendante du complément.
Cible thérapeutique et développement médicamenteux
Cette découverte a validé la CRP comme une cible thérapeutique prometteuse pour les affections aiguës. Le docteur Mark Pepys explique que son équipe s’est attelée à développer un médicament capable de bloquer la liaison de la CRP aux cellules endommagées. L’objectif était de réduire les lésions médiées par le complément durant un infarctus ou un accident vasculaire cérébral. Ils ont créé avec succès une famille de composés candidats très efficaces dans les modèles animaux. Ces médicaments, conçus pour une administration intraveineuse, étaient adaptés aux patients hospitalisés lors d’événements aigus.
Cependant, le parcours du développement médicamenteux est notoirement difficile. Le docteur Anton Titov et le docteur Pepys évoquent les immenses défis rencontrés. Les composés initiaux étaient extrêmement difficiles à purifier à l’échelle requise pour la fabrication pharmaceutique, ce qui a stoppé leur développement. Le docteur Pepys indique que son équipe travaille désormais activement à la conception de nouvelles molécules plus faciles à développer, capables de produire le même effet thérapeutique—bloquer la CRP pour limiter les lésions tissulaires—tout en étant stables et rentables.
Transcription intégrale
Dr. Anton Titov, MD : La CRP [Protéine C-Réactive] est-elle un « facteur de risque » pour la maladie cardiaque ?
Dr. Mark Pepys, MD : La Protéine C-Réactive est effectivement un marqueur de risque modérément significatif pour la maladie cardiovasculaire. Mais cette histoire a été grandement surévaluée. Les gens ont commencé à parler de la CRP comme d’un « facteur de risque ». Un « facteur de risque » est quelque chose qui contribue réellement à la maladie. Le cholestérol est un facteur de risque. Nous savons que le cholestérol cause l’athérosclérose. Si vous avez trop de cholestérol, vous développez une athérosclérose. Si vous baissez le cholestérol, vous vous protégez contre l’athérosclérose.
Encore une fois, il ne s’agit pas de jouer avec les mots. C’est une erreur scientifique sérieuse : la confusion entre association et causalité. Les gens ont mené des essais cliniques épidémiologiques qui semblaient importants car des milliers de personnes étaient impliquées. Mais le nombre d’événements, le nombre d’infarctus parmi eux, par exemple, était très faible.
Peu importe si vous avez 10 000 personnes dans un essai clinique. Si vous n’avez qu’une centaine d’infarctus, vous pouvez les diviser en quintiles selon leur CRP un an ou dix ans auparavant. Vous pouvez obtenir toutes sortes de résultats étranges.
Les résultats épidémiologiques initiaux suggéraient une association incroyablement élevée entre une CRP basale élevée et le risque d’infarctus ultérieur. Mais lorsque l’épidémiologie est passée à une échelle appropriée—des centaines de milliers de personnes testées, des méta-analyses ou de très grands essais cliniques—il s’est avéré que l’association était beaucoup plus faible. Elle est toujours là, mais elle est assez modeste.
Tout ce que cela signifie vraiment, ce n’est pas grand-chose. Vous trouvez la même association avec de nombreux autres marqueurs inflammatoires. Ce n’est rien de spécifique à la CRP. Vous trouvez une faible association avec une faible albumine ; quand la CRP monte, l’albumine baisse. La vitesse de sédimentation [VS], ou les cytokines, toutes sortes de choses comme ça.
Donc c’était une confusion complète, une méprise entre association et causalité. Cela s’est exacerbé parce que les gens ont fait des expériences in vitro avec de la CRP d’origine commerciale. La Protéine C-Réactive était impure. Elle était contaminée par du lipopolysaccharide bactérien, qui est très pro-inflammatoire. Ils ont mis cela sur des cellules et les cellules ont réagi vivement. Les chercheurs ont dit « c’est la CRP qui cause l’athérosclérose ! ».
Ils ont même fait des expériences in vivo où ils ont perfusé cette substance impure chez des personnes. Ils ont provoqué beaucoup d’inflammation. Le corps a une forte réponse aux polysaccharides bactériens. Oui, la CRP a été prétendue pro-inflammatoire. Il s’est avéré que la Protéine C-Réactive n’est pas pro-inflammatoire.
Finalement, nous étions très préoccupés par ces rapports. Nous n’avons pas pu les reproduire in vitro ou dans des modèles animaux. Nous avons fabriqué de la CRP humaine de qualité pharmaceutique à partir de sang de donneurs humains. C’était un processus très laborieux et coûteux. Nous avons perfusé de la Protéine C-Réactive chez des volontaires sains. Devinez ce qui leur est arrivé ? Absolument rien !
Nous avons montré que la CRP n’est pas pro-inflammatoire si vous êtes en bonne santé. Toute l’histoire de la CRP comme marqueur de risque pour l’athérosclérose et pour le risque cardiovasculaire est fausse. Cela s’est évaporé.
Le clou final dans le cercueil fut ce qu’on appelle « l’épidémiologie génétique » ou la randomisation mendélienne. Parfois vous trouvez les gènes qui codent pour différents niveaux de protéine C-réactive [CRP] au départ ou différentes réponses de phase aiguë. Il existe de tels gènes. Il existe divers polymorphismes dans la population humaine. Certaines personnes ont des gènes qui leur donnent une CRP basale basse, 0,1 mg par litre. D’autres personnes vivent avec une CRP basale de 5 mg par litre. Parfois ils ont une réponse de phase aiguë ; en conséquence, l’un monte plus que l’autre.
Maintenant imaginez que la CRP causait la maladie cardiovasculaire. Alors les personnes qui ont les gènes codant pour plus de CRP auraient plus de maladie cardiovasculaire. Les personnes avec des niveaux plus bas de Protéine C-Réactive auraient moins de maladie cardiovasculaire. Il s’avère qu’il n’y a aucune relation entre la Protéine C-Réactive et la maladie cardiaque. Les gènes qui contrôlent la production de CRP et si vous faites des infarctus ou des accidents vasculaires cérébraux—il n’y a aucune relation. Complètement « non ».
Peu importe ce que les gens ont trouvé dans les expériences in vitro. Ils peuvent argumenter sur les expériences, les perfusions, etc. Il est incontestable que la CRP ne cause pas d’infarctus et d’accidents vasculaires cérébraux.
C’est un côté de l’histoire. L’autre côté de l’histoire est que la CRP est une protéine de liaison. La CRP est en fait très proche du SAP, dont nous avons parlé concernant l’amylose. Le SAP se lie aux fibrilles amyloïdes. À quoi se lie la CRP ? La CRP se lie aux cellules mortes ou endommagées. Elle reconnaît les résidus de phosphocholine.
Ces résidus chimiques sont ubiquitaires dans les membranes plasmiques, les phospholipides. Ces résidus sont exposés lorsque les cellules sont malades, mourantes ou mortes. La CRP se lie aux cellules mortes et mourantes. La CRP humaine active également un système protéique dans le sang appelé le Système du Complément. C’est un système pro-inflammatoire et de défense de l’hôte. Il est utilisé par le corps pour se débarrasser des bactéries et pour nettoyer les débris.
Nous l’utilisons dans notre traitement de l’amyloïde pour éliminer les dépôts amyloïdes. L’anticorps active le complément ; c’est ce qui élimine les dépôts amyloïdes. Le corps utilise la CRP pour se lier aux cellules mortes afin d’activer le complément. Cela aide à se débarrasser des cellules mortes.
Mais nous avons montré d’abord en 1999—beaucoup de gens avaient « sous-entendu » cela, fait des « observations », « suggéré cela »—nous avons fait les premières expériences définitives. Nous avons montré que la CRP aggrave en réalité les lésions dans un infarctus par rapport à ce qu’elles seraient autrement.
Lors d’un infarctus du myocarde, votre artère coronaire est obstruée. Le sang artériel ne parvient plus à une partie du myocarde. Les cellules meurent par anoxie. Une portion de votre muscle cardiaque meurt. Si vous introduisez de la CRP humaine dans une telle expérience chez le rat, la CRP humaine active le complément du rat. Vous augmentez considérablement la taille de l’infarctus. Cela dépend du complément. Nous connaissons le mécanisme ; nous avons identifié toutes les molécules impliquées.
Dr. Anton Titov, MD : Cela valide la CRP comme cible thérapeutique.
Dr. Mark Pepys, MD : Car vous pouvez examiner toute personne décédée d’un infarctus. Vous trouverez toujours de la CRP et du complément dans et autour de la zone nécrosée. Le muscle mort est présent. La protéine C-réactive (CRP) est toujours là. Ce sont ces molécules qui aggravent la situation. Nous avons entrepris de développer un médicament qui empêcherait la liaison de la CRP sur place.
Nous avons démontré la même chose dans un modèle d’accident vasculaire cérébral (AVC) chez le rat. Nous pouvons aggraver les AVC des rats en ajoutant de la CRP humaine. Nous avons cherché à créer des molécules bloquant la liaison de la CRP aux cellules mortes et endommagées. De tels médicaments pourraient réduire les lésions lors d’un infarctus. Nous avons développé une molécule candidate prometteuse et une famille de composés.
Dr. Anton Titov, MD : Cela a très, très bien fonctionné dans le modèle animal.
Dr. Mark Pepys, MD : Mais ils se sont avérés non développables en tant que médicaments, du moins jusqu’à présent. Nous avons déjà évoqué le parcours cauchemardesque du développement pharmaceutique. C’est véritablement un chemin semé d’embûches. Rien de ce que fait l’humanité n’est aussi difficile, lent et coûteux que de tenter de mettre au point un nouveau médicament. Cela peut prendre des décennies et coûter des milliards de livres. C’est donc un parcours indiciblement ardu.
Ces molécules particulières semblaient très favorables, au moins pour une utilisation en perfusion. Elles ne pouvaient être administrées par voie orale mais par voie intraveineuse. Ceci est envisageable pour un patient hospitalisé pour un infarctus, un AVC, une brûlure – où la CRP contribue aussi aux lésions –, un traumatisme ou autres affections. Mais leur purification à l’échelle nécessaire au développement pharmaceutique s’est révélée très difficile.
Dr. Anton Titov, MD : Le développement de ces molécules a été arrêté.
Dr. Mark Pepys, MD : Nous tentons actuellement, avec beaucoup de difficultés, d’inventer d’autres molécules ayant le même effet. Il s’agira de solides stables, produits en grande quantité à un coût acceptable. Nous sommes pleinement engagés dans le développement de ces médicaments. Si quelqu’un souhaitait nous offrir quelques millions de livres pour soutenir ces efforts, cela serait accueilli avec une immense gratitude !