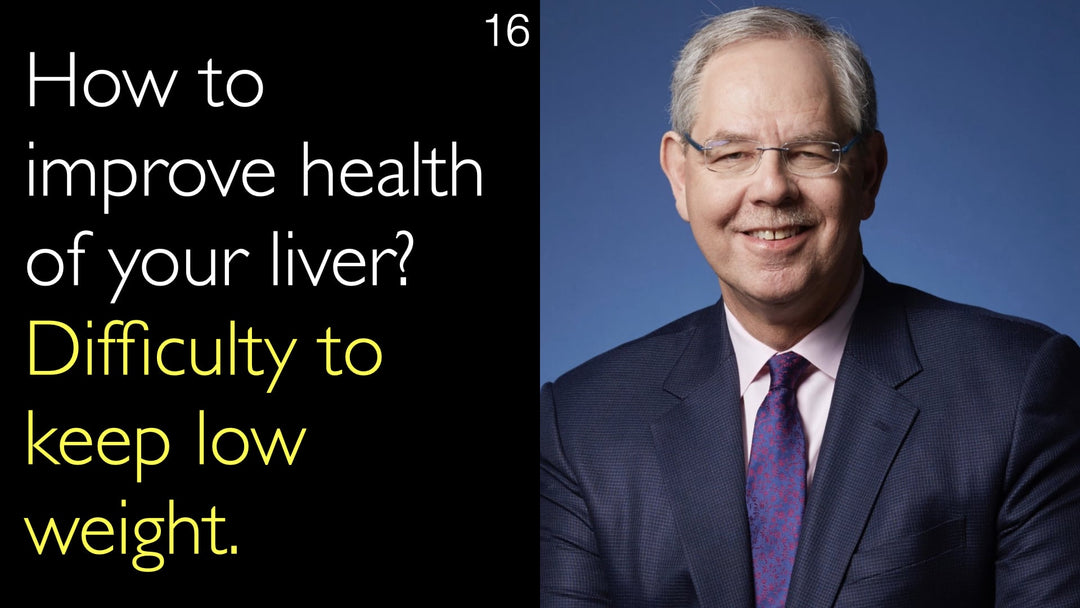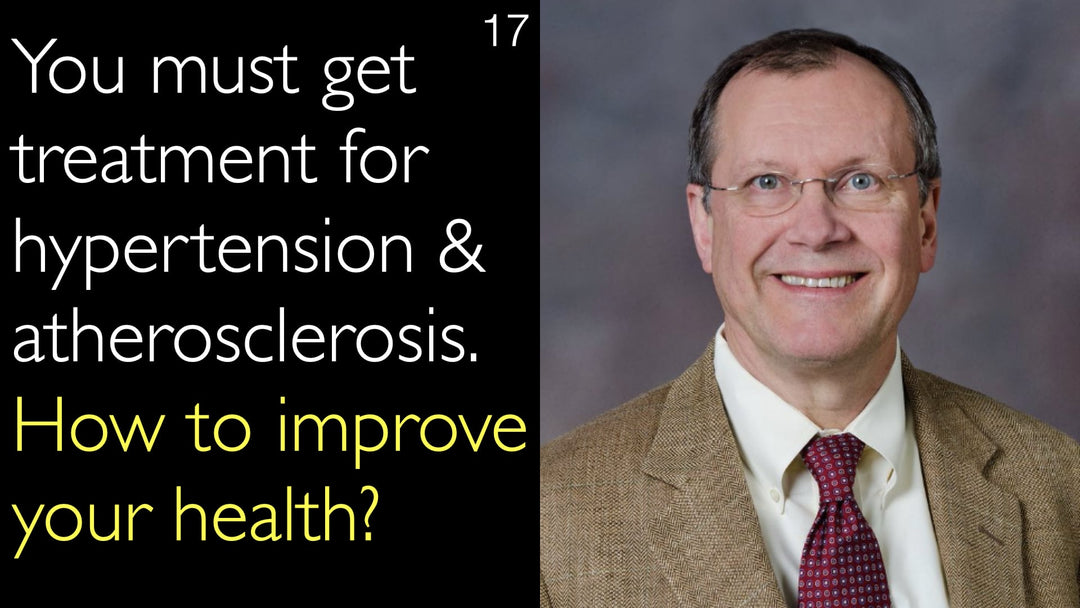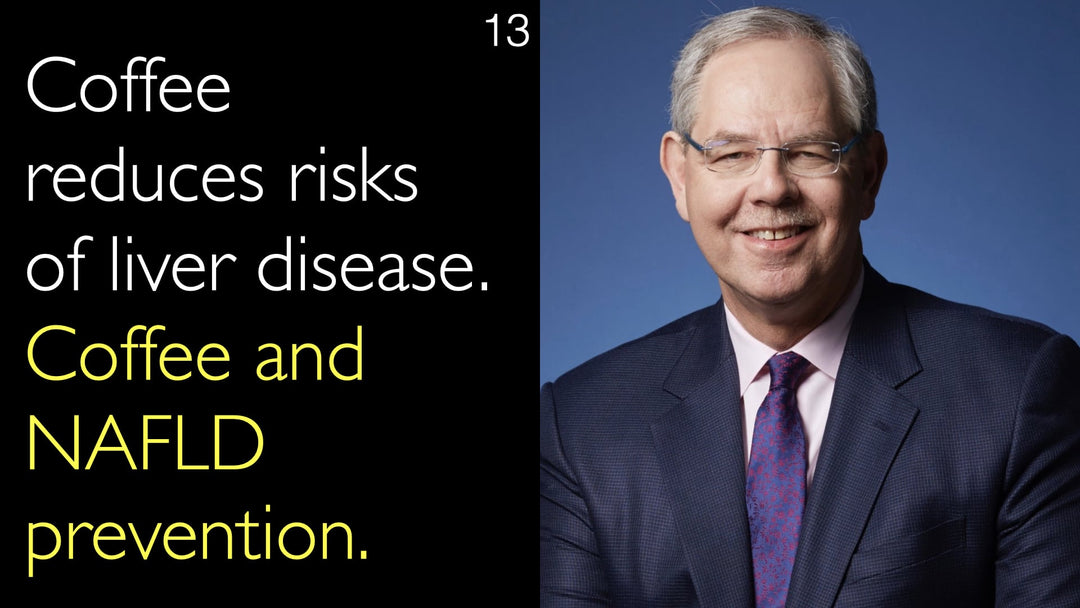Le Dr Randy Cron, expert de renom dans le domaine des syndromes de tempête cytokinique, explore la susceptibilité génétique à ces réactions immunitaires potentiellement mortelles. Il présente un modèle de seuil où des anomalies génétiques partielles interagissent avec des facteurs déclencheurs, tels qu’une infection ou une maladie auto-immune. Le Dr Cron examine le rôle de gènes spécifiques de la voie de la perforine, qui altèrent la lyse des cellules infectées par des virus. Ce dysfonctionnement entraîne une activation prolongée des cellules immunitaires et une sécrétion excessive de cytokines pro-inflammatoires. Comprendre ces facteurs génétiques est essentiel pour le diagnostic et le traitement ciblé du syndrome de tempête cytokinique.
Facteurs génétiques dans la susceptibilité et la physiopathologie du syndrome de tempête cytokinique
Aller à la section
- Modèle de seuil de susceptibilité génétique
- Dysfonction cytotoxique de la voie de la perforine
- Engagement immunitaire prolongé et production de cytokines
- Formes secondaires de tempête cytokinique
- Chevauchement des voies multiples et des immunodéficiences
- Déclencheurs cliniques et franchissement du seuil
- Transcription intégrale
Modèle de seuil de susceptibilité génétique
Le Dr Randy Cron utilise un modèle de seuil pour expliquer la génétique complexe du syndrome de tempête cytokinique. Ce modèle permet de comprendre pourquoi les formes secondaires de ce syndrome surviennent plus tard dans l’enfance ou à l’âge adulte. Selon le Dr Cron, les individus portent dès la naissance des défauts génétiques partiels, qui ne suffisent pas à eux seuls à déclencher la maladie. Cependant, la combinaison de ces facteurs génétiques avec un déclencheur inflammatoire significatif peut pousser le système immunitaire au-delà d’un seuil de tolérance critique.
Dysfonction cytotoxique de la voie de la perforine
Les gènes les mieux étudiés liés à la susceptibilité à la tempête cytokinique sont ceux impliqués dans la voie de la perforine. Le Dr Randy Cron décrit cette voie comme essentielle pour permettre aux cellules tueuses naturelles (NK) et aux lymphocytes T cytotoxiques CD8+ d’éliminer les cellules cibles infectées. Parmi les gènes clés figurent la perforine elle-même, qui perce la membrane des cellules cibles, ainsi que Rab27a, Munc13-4 et STX11, qui interviennent dans le trafic et l’ancrage des mécanismes de lyse. Des mutations homozygotes dans ces gènes provoquent une maladie rare et grave, la lymphohistiocytose hémophagocytaire familiale (LHF), dont l’incidence est d’environ 1 cas pour 50 000 naissances.
Engagement immunitaire prolongé et production de cytokines
Les recherches du Dr Cron portent sur la façon dont les mutations hétérozygotes peuvent perturber partiellement la fonction des cellules immunitaires. Des études en laboratoire montrent que les cellules porteuses de ces mutations éliminent moins rapidement et moins efficacement les cellules cibles infectées. Le Dr Cron explique que cela entraîne une interaction prolongée entre la cellule tueuse et sa cible. Au lieu d’une élimination rapide suivie d’un désengagement, les cellules restent en contact jusqu’à cinq fois plus longtemps que la normale. Cet engagement prolongé provoque une activation excessive et une surproduction de cytokines pro-inflammatoires, notamment l’interféron-gamma.
Formes secondaires de tempête cytokinique
Ces défauts génétiques partiels contribuent majoritairement aux formes secondaires du syndrome de tempête cytokinique. Le Dr Randy Cron souligne que des taux élevés de cytokines pro-inflammatoires, bien que nécessaires pour combattre les infections, deviennent pathologiques lorsqu’ils dépassent un certain seuil. Cet excès de cytokines est un facteur direct de l’insuffisance multiviscérale caractéristique d’une tempête cytokinique avérée. L’entretien avec le Dr Anton Titov met en lumière comment ce mécanisme s’étend au-delà des syndromes génétiques rares pour s’appliquer à des affections acquises plus courantes.
Chevauchement des voies multiples et des immunodéficiences
La susceptibilité génétique à la tempête cytokinique ne se limite pas à la voie de la perforine. Le Dr Randy Cron note qu’il existe des centaines de déficits immunitaires primaires pouvant altérer l’élimination virale par d’autres mécanismes. Les troubles métaboliques peuvent également affecter le fonctionnement du système immunitaire et contribuer à un état hyperinflammatoire. Le Dr Cron cite la description par son collègue le Dr Scott Canna de ces différentes voies comme des « autoroutes vers l’enfer », soulignant ainsi l’issue souvent fatale du syndrome de tempête cytokinique et la multiplicité des voies génétiques pouvant y conduire.
Déclencheurs cliniques et franchissement du seuil
Le passage à la tempête cytokinique nécessite souvent un déclencheur clinique chez un individu génétiquement prédisposé. Le Dr Randy Cron explique que la plupart des personnes tolèrent une copie mutée d’un gène tout au long de leur vie. Cependant, une agression significative, comme une infection par le SARS-CoV-2, une souche virulente de grippe ou la dengue, peut constituer le déclencheur nécessaire. Ce risque est accru en présence d’un état inflammatoire sous-jacent, lié par exemple à un lupus érythémateux disséminé, une maladie de Still ou une leucémie active. La combinaison d’une prédisposition génétique, d’une inflammation chronique et d’un déclencheur aigu peut submerger la capacité de régulation du système immunitaire.
Transcription intégrale
Dr Anton Titov : Vous avez également publié des travaux sur la génétique du syndrome d’activation macrophagique et du syndrome de tempête cytokinique, notamment sur les gènes impliqués dans le contrôle viral altéré, la dysrégulation de l’inflammasome et d’autres défauts immunitaires. Pourriez-vous commenter la génétique de la susceptibilité au syndrome cytokinique ? Vous en avez déjà évoqué certains aspects précédemment.
Je trouve cela fascinant, bien que cela reste controversé. Certains, dont moi-même, défendent ce concept, tandis que d’autres sont plus sceptiques. La raison en est qu’il ne s’agit pas simplement de mutations homozygotes évidentes entraînant une maladie. Parfois, il faut que les deux copies du gène soient mutées.
Avant leur identification, ces mutations n’étaient pas faciles à détecter. Mais une fois découvertes, leur implication devient plus claire. Ces cas sont toutefois bien plus complexes.
Dr Randy Cron : En tant qu’humains, nous sommes imparfaits ; personne n’a un génome parfait. Nous utilisons donc un modèle de seuil pour expliquer certaines formes secondaires de tempêtes cytokiniques survenant après la petite enfance, voire à l’âge adulte.
De toute évidence, si ces mutations y contribuent, elles sont présentes depuis toujours. Seulement, elles ne sont pas suffisamment sévères seules. Mais s’il existe un seuil au-delà duquel le système immunitaire ne peut plus tolérer le degré d’inflammation induit par un déclencheur – qu’il s’agisse d’un virus, d’une poussée de lupus ou de maladie de Still, ou d’une leucémie active – la combinaison de ce facteur et d’un défaut immunitaire partiel, évent aggravé par un autre déclencheur, peut faire franchir ce seuil. Le système immunitaire devient alors incapable de gérer l’inflammation, et la tempête cytokinique se manifeste clairement.
Les gènes que nous connaissons le mieux, les plus étudiés et dont la physiopathologie est la mieux comprise sont ceux responsables de la LHF familiale, ou lymphohistiocytose hémophagocytaire. Il s’agit d’une voie impliquant de nombreux gènes.
Ainsi, deux types de globules blancs – les cellules tueuses naturelles (NK) et les lymphocytes T cytotoxiques CD8+ – partagent cette voie commune leur permettant de reconnaître, par exemple, une cellule infectée. Nous appelons cela une cellule présentatrice d’antigène, car elle expose à sa surface un fragment viral découpé, permettant sa reconnaissance par les lymphocytes T cytotoxiques CD8+.
Ces cellules vont ensuite lyser la cible via la voie de la perforine. La perforine est l’un des gènes de cette voie ; elle perce un trou dans la cellule cible pour délivrer des granzymes, des protéines inductrices de lyse.
Dr Randy Cron : Mais de nombreuses autres protéines sont essentielles au bon fonctionnement de la perforine, notamment pour son transport intracellulaire et son exocytose. Elles sont acheminées dans des vésicules dont le trafic, la fusion membranaire et l’ancrage dépendent d’autres protéines aux noms complexes : Rab27a, Munc13-4, STX11, par exemple.
Si vous êtes homozygote pour une mutation dans l’un de ces gènes, vous développez cette rare LHF familiale, avec une incidence d’environ 1/50 000 naissances. Mais mon laboratoire et d’autres postulent que même une mutation hétérozygote, altérant par exemple un acide aminé de l’une de ces protéines, peut perturber partiellement cette voie.
En conséquence, les cellules NK ou T CD8+ tuent moins efficacement. Cela peut être étudié en laboratoire, soit directement sur des cellules de patients, soit en introduisant ces mutations dans des lignées cellulaires. Nous pouvons alors évaluer si la mutation altère la fonction cytotoxique.
Et effectivement, cela a été démontré par au moins trois groupes à ma connaissance.
Dr Anton Titov : Lorsque la lyse est moins efficace, le globule blanc qui tente de tuer la cellule présentatrice d’antigène infectée reste engagé bien plus longtemps – environ cinq fois plus – que normalement. Au lieu de lyser rapidement sa cible et de passer à autre chose, l’interaction se prolonge.
Dr Randy Cron : Exactement. En cas de mutation homozygote, la lyse est fortement compromise. Avec une mutation hétérozygote, la lyse a lieu, mais plus lentement. Cette interaction prolongée entre les deux cellules entraîne une communication soutenue, avec échange de signaux protéiques et sécrétion accrue de cytokines pro-inflammatoires comme l’interféron-gamma.
Les taux deviennent alors anormalement élevés pour une infection. Bien que ces cytokines soient nécessaires pour combattre l’agent pathogène, leur excès contribue à l’insuffisance multiviscérale observée dans la tempête cytokinique.
Ainsi, ce groupe de gènes est impliqué dans certaines formes secondaires de tempête cytokinique. Comme vous l’avez mentionné, il existe également d’autres déficits immunitaires primaires rares. Nous en découvrons de plus en plus chaque année ; ils sont désormais des centaines.
Si un défaut dans ces gènes altère l’élimination virale par d’autres mécanismes que la voie de la perforine, le virus peut également suractiver le système immunitaire en persistant. Même des défauts partiels peuvent ainsi contribuer à une tempête cytokinique.
Certains troubles métaboliques entrent aussi en jeu. Le métabolisme joue un rôle clé dans l’immunité, bien que nous ne comprenions pas encore parfaitement ces mécanismes comparativement aux voies mieux caractérisées. Il existe donc de multiples voies possibles.
Dr Anton Titov : Ce que le Dr Scott W. Canna a qualifié d’« autoroutes vers l’enfer », car le syndrome de tempête cytokinique est souvent fatal.
Dr Randy Cron : Oui, il existe de multiples voies pour y parvenir, et parfois même des chevauchements chez un même patient. Cependant, comme la majorité d’entre nous ne présente pas de mutation homozygote pour ces gènes, mais peut-être une copie mutée, nous pouvons généralement la tolérer toute notre vie. Jusqu’à ce qu’une agression significative survienne – SARS-CoV-2, grippe virulente, dengue, etc. –, surtout si nous sommes déjà dans un état inflammatoire dû à un lupus, une maladie de Still ou une leucémie. Cette combinaison de facteurs peut alors nous faire franchir le seuil au-delà duquel le système immunitaire perd le contrôle.