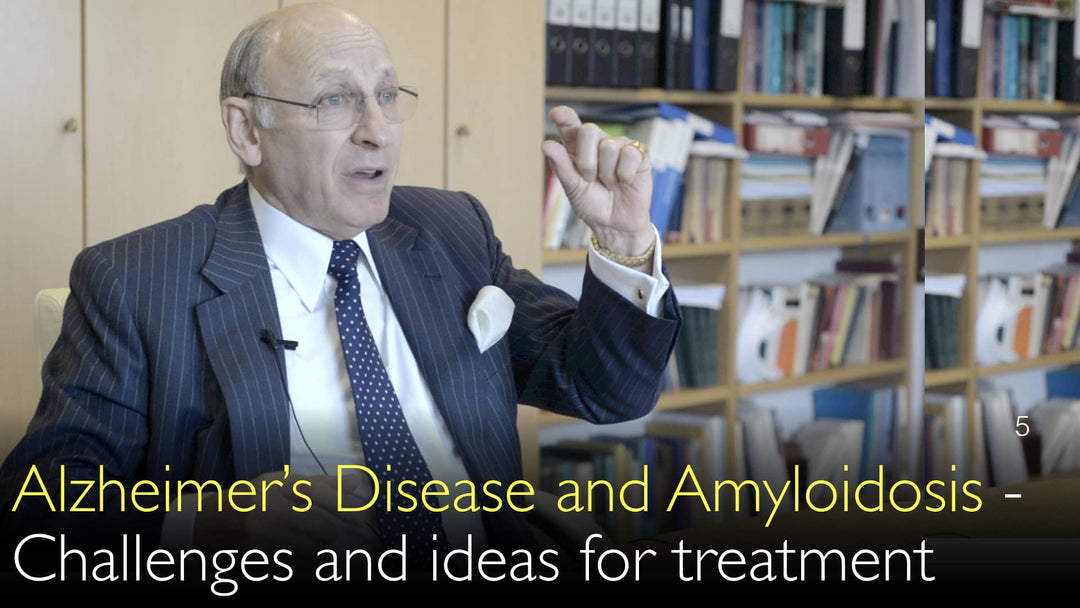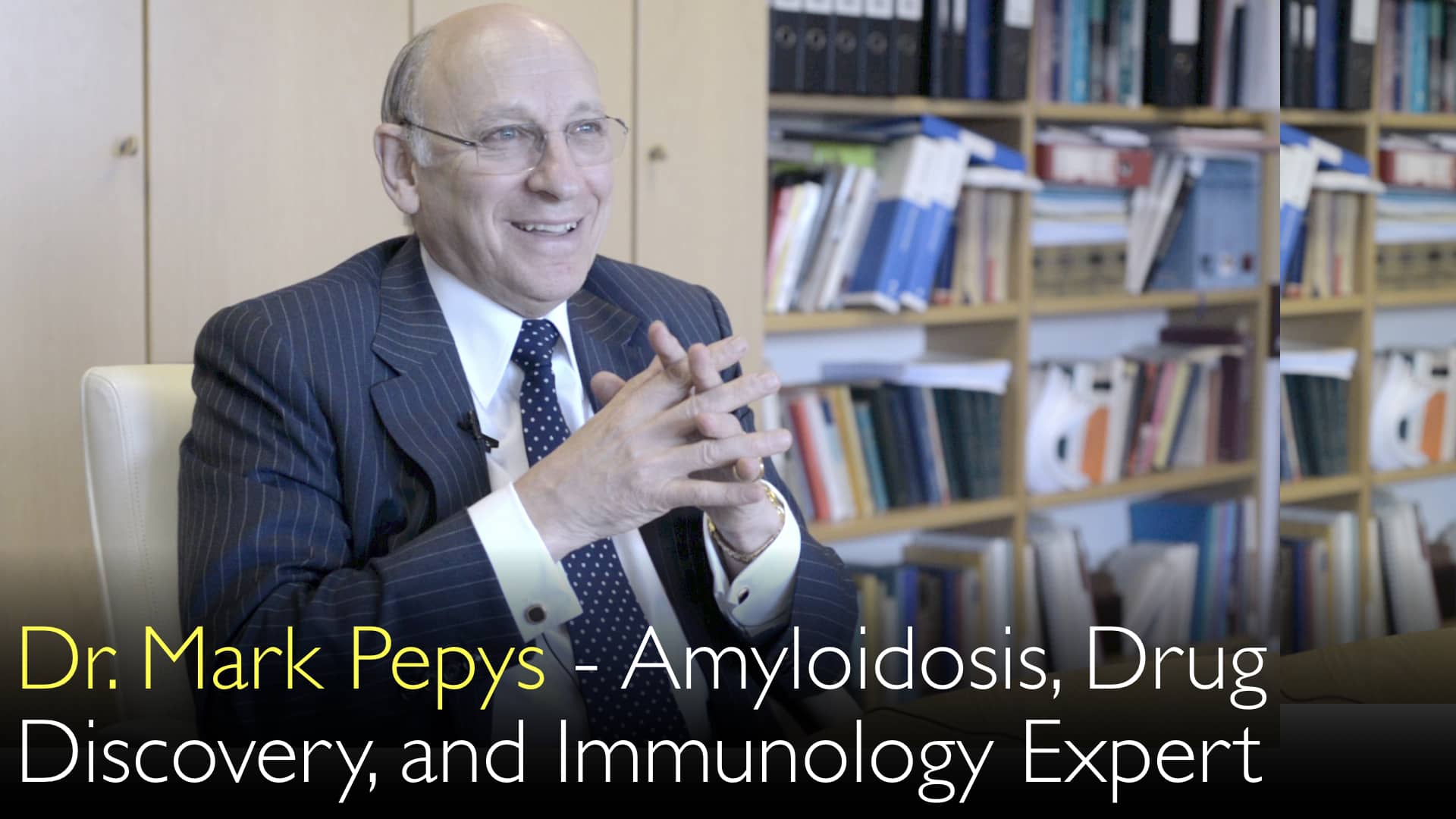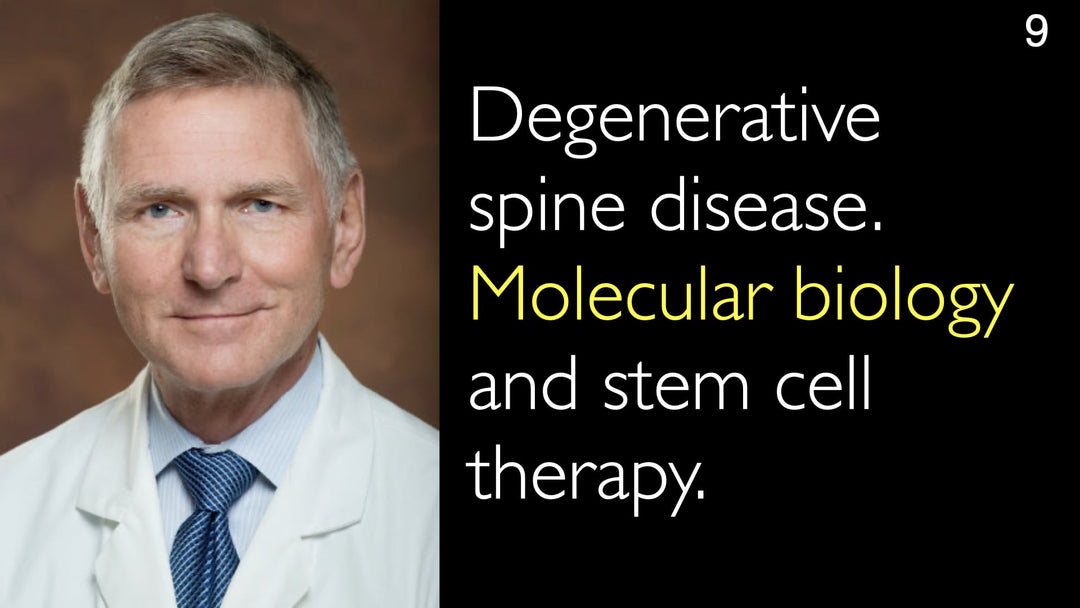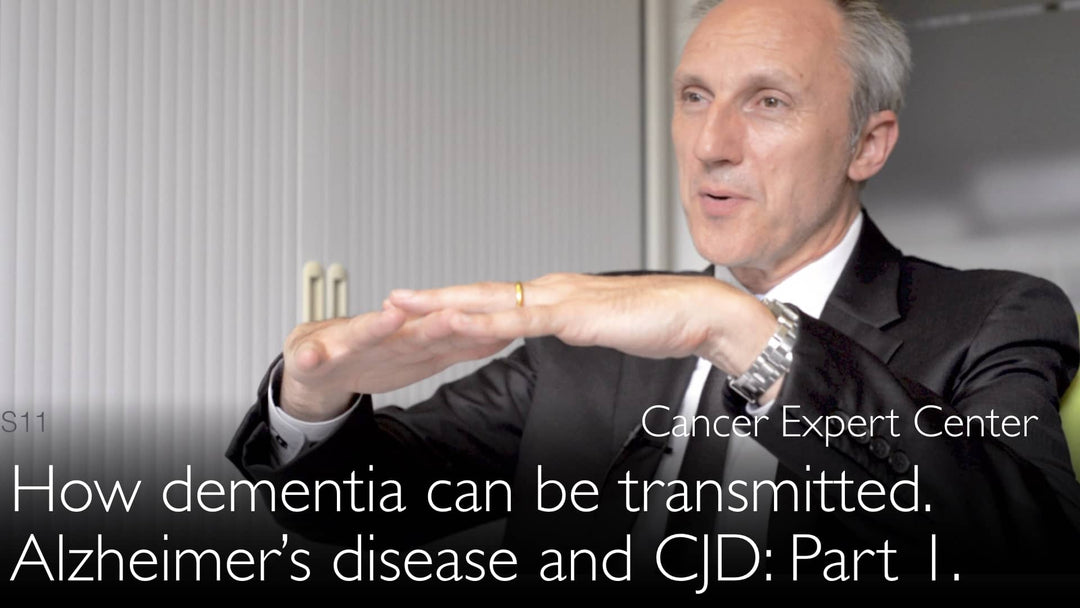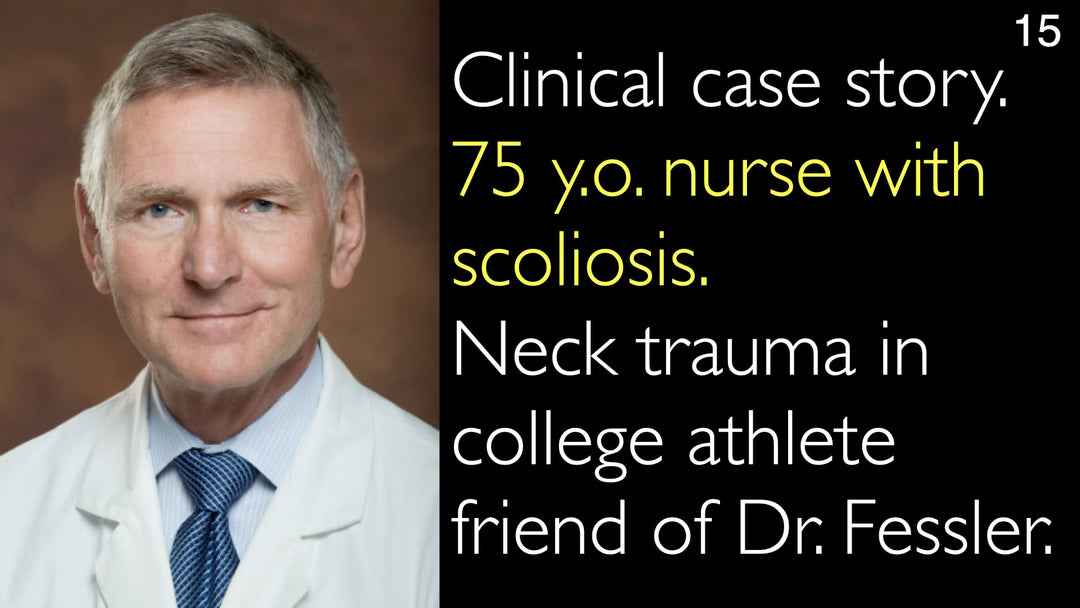Expert de premier plan dans le traitement de l’amyloïdose, le docteur Mark Pepys, MD, souligne les différences fondamentales entre l’amyloïdose systémique et la maladie d’Alzheimer. Il précise que la maladie d’Alzheimer se caractérise par de minuscules dépôts amyloïdes dans le cerveau, tandis que l’amyloïdose systémique entraîne des dépôts massifs dans les organes. Le docteur Mark Pepys, MD, explique pourquoi la confusion entre ces deux pathologies est cliniquement risquée. Il présente également son nouveau médicament, qui cible et élimine le composant sérique P de l’amyloïde (CSP) du cerveau. Un essai clinique en cours évaluera si cette approche peut freiner la progression de la maladie d’Alzheimer.
Comprendre l'amyloïde dans la maladie d’Alzheimer versus l’amylose systémique
Aller à la section
- Différences clés entre Alzheimer et amylose
- Importance d’un diagnostic précis
- Rôle de l’amyloïde dans la pathogenèse d’Alzheimer
- Nouvelle approche thérapeutique ciblant la SAP
- Essai clinique à venir pour Alzheimer
- Transcription intégrale
Différences clés entre Alzheimer et amylose
La maladie d’Alzheimer et l’amylose systémique sont deux entités fondamentalement distinctes. Le Dr Mark Pepys souligne que dans la maladie d’Alzheimer, les plaques amyloïdes sont microscopiques et situées dans la substance cérébrale. La charge amyloïde totale y est infime, de l’ordre de 100 milligrammes. En revanche, l’amylose systémique se caractérise par des dépôts amyloïdes massifs dans des organes comme le foie, pouvant atteindre jusqu’à 5 kilogrammes.
La localisation et la nature des dépôts diffèrent également de manière cruciale. Dans la maladie d’Alzheimer, l’amyloïde forme de minuscules plaques extracellulaires, accompagnées de dégénérescences neurofibrillaires intracellulaires. Dans l’amylose systémique, les dépôts surviennent dans les tissus organiques et les parois vasculaires, mais jamais dans le parenchyme cérébral. Le Dr Anton Titov et le Dr Mark Pepys expliquent pourquoi ces distinctions sont essentielles pour un diagnostic précis et une stratégie thérapeutique adaptée.
Importance d’un diagnostic précis
Une terminologie exacte est vitale pour une prise en charge efficace des patients. Le Dr Mark Pepys met en garde contre la confusion dangereuse entre les termes comme « amylose » appliqués à différentes maladies. Qualifier la maladie d’Alzheimer, de Parkinson ou de Huntington d’« amylose » entraîne une confusion clinique, car chaque pathologie a une physiopathologie distincte et nécessite des traitements spécifiques.
Cette précision est particulièrement critique dans l’amylose systémique. Confondre une amylose héréditaire avec une amylose AL peut conduire à administrer une chimiothérapie cytotoxique inutile et toxique. Le Dr Mark Pepys souligne que le diagnostic moléculaire est indispensable. Les décisions thérapeutiques doivent reposer sur l’identification précise du type de protéine amyloïde et de sa cause sous-jacente.
Rôle de l’amyloïde dans la pathogenèse d’Alzheimer
Le lien entre les dépôts amyloïdes et la neurodégénérescence dans la maladie d’Alzheimer reste mal élucidé. Le Dr Mark Pepys note que si les plaques bêta-amyloïdes sont une caractéristique pathologique de la maladie, leur rôle causal dans la mort neuronale n’est pas établi. La présence d’amyloïde est corrélée à la maladie, mais pourrait ne pas être directement responsable du déclin cognitif et des symptômes démentiels.
Les preuves génétiques suggèrent que la voie amyloïde est impliquée dans la pathogenèse. Des mutations dans la protéine précurseur de l’amyloïde ou les enzymes de clivage provoquent une forme héréditaire précoce de la maladie d’Alzheimer en augmentant la production de bêta-amyloïde. Cependant, le mécanisme exact de la mort neuronale demeure inconnu. Une incertitude similaire existe pour les dépôts amyloïdes dans le pancréas des diabétiques de type 2, qui pourraient être des sous-produits plutôt que des causes de la maladie.
Nouvelle approche thérapeutique ciblant la SAP
Le Dr Mark Pepys a développé une nouvelle approche thérapeutique ciblant la composante sérique P de l’amyloïde (SAP). Cette protéine sanguine normale se lie à tous les dépôts amyloïdes, y compris ceux présents dans le cerveau des patients atteints d’Alzheimer. Son médicament élimine complètement la SAP du sang, et par conséquent du cerveau et du liquide céphalo-rachidien.
La recherche révèle deux mécanismes prometteurs. Premièrement, retirer la SAP des dépôts amyloïdes pourrait favoriser l’élimination de ces structures pathologiques du cerveau. Deuxièmement, des preuves émergentes indiquent que la SAP est directement toxique pour les neurones, provoquant une mort cellulaire par apoptose. Une étude préliminaire chez cinq patients a confirmé que le médicament élimine efficacement la SAP du liquide céphalo-rachidien. Les modèles animaux montrent qu’il retire la SAP des dépôts amyloïdes cérébraux.
Essai clinique à venir pour Alzheimer
Un essai clinique majeur va tester cette thérapie ciblant la SAP dans la maladie d’Alzheimer. Financé par le National Institute for Health Research du Royaume-Uni, l’étude inclura 100 patients dans un essai contrôlé contre placebo en double insu d’une durée de trois ans. Cette recherche vise à déterminer si l’élimination de la SAP peut influencer la progression de la maladie et diverses mesures cliniques.
Le Dr Mark Pepys explique que si les approches antérieures par anticorps ciblant la bêta-amyloïde ont largement échoué, sa méthode adopte une stratégie différente. En ciblant la SAP plutôt que l’amyloïde directement, le traitement pourrait surmonter les limitations précédentes. S’il s’avère efficace, cette thérapie pourrait stopper la progression d’Alzheimer à un stade précoce, apportant un bénéfice significatif même sans inverser les lésions neuronales existantes.
Transcription intégrale
Dr. Anton Titov, MD: En quoi la maladie d’Alzheimer et l’amylose diffèrent-elles ? Qu’ont-elles en commun ?
Dr. Mark Pepys, MD: La maladie d’Alzheimer est très différente de l’amylose systémique. Dans la maladie d’Alzheimer, il y a des dépôts amyloïdes dans la substance cérébrale, ce qui n’arrive jamais dans l’amylose systémique. Dans celle-ci, l’amyloïde peut se déposer dans les membranes entourant le cerveau ou dans les vaisseaux sanguins qui l’irriguent, mais jamais dans la substance cérébrale elle-même.
Dans la maladie d’Alzheimer, les dépôts amyloïdes sont microscopiques. La charge totale d’amyloïde dans le cerveau ne représente que quelques milligrammes, peut-être 100 milligrammes. C’est absolument infime ! Chez les patients cliniquement atteints, la quantité d’amyloïde est très faible. Il s’agit de minuscules plaques, que les neuropathologistes appellent ainsi, auxquelles s’ajoutent d’autres structures protéiques anormales, les dégénérescences neurofibrillaires. Bien que similaires dans leur repliement, elles ne sont pas de l’amyloïde bona fide. Ce sont des marqueurs neuropathologiques, mais en quantité très faible.
En comparaison, dans le foie d’un patient atteint d’amylose systémique, on peut trouver jusqu’à 5 kilogrammes d’amyloïde. La différence est colossale.
5 kilogrammes contre quelques milligrammes ? Exactement. Je ne qualifie pas la maladie d’Alzheimer d’« amylose ». En médecine, il est crucial de nommer correctement les maladies.
Les neuroscientifiques, biochimistes et biophysiciens travaillant dans ce domaine, sans être cliniciens, utilisent parfois les termes de manière approximative. C’est un domaine controversé. En tant que clinicien, la terminologie a une importance capitale : un mot spécifique correspond à un diagnostic et à un traitement. Utiliser le même mot pour une maladie différente, nécessitant un traitement complètement différent, est un désastre.
Malheureusement, une tendance actuelle, influencée par les scientifiques fondamentaux, consiste à appeler Alzheimer, Parkinson ou Huntington des « amyloses » en raison de similitudes moléculaires dans le repliement des protéines. Mais ce ne sont pas des amyloses. Dans la maladie de Huntington, la substance anormale est dans le noyau ; dans Parkinson, dans le cytoplasme ; dans Alzheimer, à l’extérieur des cellules. Ces environnements sont totalement différents. Il est crucial de ne pas les confondre, car cette confusion est dangereuse.
Même au sein de l’amylose systémique, une erreur est possible. Poser à tort un diagnostic d’amylose AL peut conduire à une chimiothérapie cytotoxique inappropriée, potentiellement mortelle, alors que d’autres patients ayant une amylose génétique n’en ont pas besoin. Une telle erreur est catastrophique.
Dr. Anton Titov, MD: En tant que cliniciens, nous sommes très sensibles à l’usage correct des termes. Cela souligne l’importance d’un diagnostic précis et complet, pas seulement général comme « amylose » ou « cancer de tel organe ». Le diagnostic doit être moléculaire.
Dr. Mark Pepys, MD: Absolument ! Car cela change radicalement la prise en charge ! Le problème est qu’aujourd’hui, on est allé au niveau moléculaire : on dit que ces maladies sont caractérisées par des protéines mal repliées qui s’agrègent. Certes, c’est le cas, mais dans la maladie d’Alzheimer, on ignore si les plaques amyloïdes ont un lien avec la neurodégénérescence.
Dr. Anton Titov, MD: Qu’est-ce qui provoque la démence dans la maladie d’Alzheimer ? Qu’est-ce qui entraîne la perte cognitive ? C’est la mort des neurones. Personne ne sait avec certitude ce qui cause cette mort. La présence d’amyloïde est une association pathologique intéressante, corrélée à la maladie, mais cela ne signifie pas qu’elle en est la cause.
Dr. Mark Pepys, MD: Nous savons que la protéine formant les fibrilles amyloïdes dans la maladie d’Alzheimer est la bêta-amyloïde, issue du clivage d’une protéine précurseur à la surface des neurones. Ce fragment s’agrège et forme des dépôts. Nous savons que cette voie est impliquée dans la pathogenèse, car des mutations dans cette protéine ou ses enzymes de clivage augmentent la production de bêta-amyloïde et causent une forme héréditaire précoce. Mais le mécanisme exact de la mort neuronale reste inconnu.
Je ne considère donc pas que la maladie d’Alzheimer ou d’autres maladies résultent simplement d’un dépôt amyloïde. Dans le diabète de type 2, il y a aussi de l’amyloïde dans le pancréas, mais nous ignorons si ces dépôts locaux causent la maladie ou sont des sous-produits.
Dr. Anton Titov, MD: Revenons à vos propositions de traitement pour la maladie d’Alzheimer.
Dr. Mark Pepys, MD: Initialement, je voulais éliminer les dépôts amyloïdes cérébraux en retirant la SAP (protéine sérique amyloïde P) à l’aide de notre médicament à petite molécule. Je pense toujours que c’est une bonne idée. Nous sommes sur le point de lancer un essai clinique pour tester cette thérapie.
Le raisonnement était : si on fait disparaître l’amyloïde, la maladie pourrait cesser de progresser, ou les patients s’améliorer—bien qu’il soit improbable de restaurer des neurones perdus. On pourrait au moins stopper la progression à un stade précoce, ce qui aurait un impact dramatique. Un tel traitement permettrait aussi de tester l’hypothèse : les dépôts amyloïdes sont-ils nocifs ? Mais jusqu’ici, personne n’a réussi.
Dr. Anton Titov, MD: Il y a eu des tentatives d’utiliser des anticorps contre la bêta-amyloïde, avec des milliards dépensés en essais cliniques.
Dr. Mark Pepys, MD: Ils n’ont pas encore réussi. Récemment, quelques résultats semblaient prometteurs pour des patients traités précocement, mais c’est loin d’être prouvé. La plupart ont échoué par manque d’efficacité ou toxicité. Ma méthode est différente.
Notre médicament élimine complètement la SAP du sang. Comme elle est produite uniquement dans le foie, et qu’elle est présente à faible concentration dans le cerveau, la retirer du sang l’élimine aussi du cerveau. Une étude préliminaire sur 5 patients a confirmé son élimination totale du liquide céphalo-rachidien après trois mois de traitement. Des expériences animales sur un modèle d’Alzheimer montrent qu’il retire la SAP des dépôts amyloïdes cérébraux. Les preuves biochimiques sont solides.
Entre-temps, d’autres laboratoires ont montré que la SAP humaine est toxique pour les neurones en culture, provoquant une mort par apoptose. Initialement sceptique—pourquoi une protéine sanguine normale tuerait-elle les neurones ?—nous avons reproduit ces observations avec de la SAP hautement purifiée. Elle se lie aux neurones, pénètre dans les cellules et le noyau, et cause leur mort. Les mécanismes moléculaires restent à élucider, mais l’effet est reproductible.
Voici donc une deuxième justification : la SAP contribue peut-être à la formation et persistance des plaques, et elle est nocive pour le cerveau. Dans la maladie d’Alzheimer, les plaques et dégénérescences sont recouvertes de SAP, dont la quantité est anormalement élevée. Débarrassons-nous-en !
Notre essai clinique, financé par le National Institute for Health Research au Royaume-Uni, portera sur 100 patients dans un essai randomisé en double insu contre placebo sur trois ans. Nous verrons son impact sur divers paramètres de la maladie. C’est ce que nous faisons.