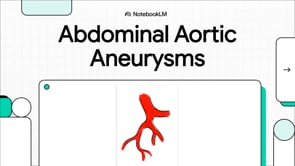Cette revue complète examine le dépistage du cancer de la prostate par le test PSA. Elle montre que si le dépistage peut prévenir environ 1,3 décès par cancer pour 1000 hommes sur 13 ans, il comporte aussi des risques significatifs, notamment des biopsies inutiles, un surdiagnostic et des effets secondaires liés aux traitements. Les données indiquent que la surveillance active est une option valable pour les cancers de faible risque, tandis que les traitements définitifs comme la chirurgie et la radiothérapie exposent à des risques d’incontinence urinaire, de dysfonction érectile et de troubles intestinaux. L’article souligne que les décisions de dépistage doivent reposer sur une prise de décision partagée approfondie entre patients et médecins, en tenant compte des facteurs de risque individuels et des préférences personnelles.
Comprendre le dépistage du cancer de la prostate : bénéfices, risques et prise de décision
Table des matières
- Le problème clinique : impact du cancer de la prostate
- Historique et limites du dosage du PSA
- Principaux résultats des études majeures
- Risques potentiels du dépistage
- Prise en charge après un dépistage positif
- Processus de décision partagée
- Recommandations actuelles de dépistage
- Conseils cliniques
- Limites et incertitudes des études
- Sources d'information
Le problème clinique : impact du cancer de la prostate
Le cancer de la prostate est actuellement le cancer le plus fréquemment diagnostiqué (hors cancers cutanés non mélanomes) et la deuxième cause de décès par cancer chez les hommes aux États-Unis. Pour la seule année 2022, environ 268 500 hommes ont reçu ce diagnostic et près de 34 500 en sont décédés.
Cette maladie touche principalement les hommes âgés, avec un pic d’incidence autour de 70 ans et une mortalité la plus élevée chez les octogénaires. On observe d’importantes disparités raciales : les hommes noirs non hispaniques présentent une incidence 1,7 fois plus élevée et une mortalité 2,1 fois supérieure à celles des hommes blancs non hispaniques. Les hommes hispaniques et asiatiques affichent des taux d’incidence et de mortalité inférieurs à ceux des hommes blancs et noirs non hispaniques.
Lorsqu’il est détecté précocement, alors qu’il est encore localisé (confiné à la prostate), le cancer de la prostate présente un excellent taux de survie à 10 ans d’environ 95 %. En revanche, en cas de métastases, le taux de survie à 5 ans chute considérablement, à environ 35 %.
Historique et limites du dosage du PSA
L’antigène spécifique de la prostate (PSA) est une protéine produite par les cellules prostatiques normales et cancéreuses. La FDA a approuvé le dosage du PSA en 1986 pour le suivi des patients déjà diagnostiqués, puis en 1994 comme outil de dépistage chez les hommes de 50 ans et plus, en complément du toucher rectal.
Il est à noter que cette approbation est intervenue sans preuve que la détection précoce améliore le pronostic des patients. L’adoption généralisée du dépistage par PSA à la fin des années 1980 a entraîné une forte hausse de l’incidence du cancer de la prostate tout au long des années 1990, les taux commençant à diminuer vers 2009.
Sur la même période, la mortalité par cancer de la prostate a chuté d’environ 50 % par rapport à son pic du début des années 1990 et s’est depuis stabilisée. Les recherches suggèrent qu’un peu moins de la moitié de cette réduction est attribuable au dépistage, le reste étant dû aux progrès thérapeutiques.
Principaux résultats des études majeures
Plusieurs essais randomisés contrôlés majeurs ont évalué l’efficacité du dépistage par PSA :
L’étude européenne randomisée sur le dépistage du cancer de la prostate (ERSPC) a suivi 162 388 hommes âgés de 55 à 69 ans pendant 16 ans. Les hommes du groupe dépisté ont bénéficié de tests PSA tous les 4 ans, avec un seuil de biopsie fixé à 3,0 ng/mL. L’étude a montré :
- 90 % de diagnostics en plus dans le groupe dépisté à 9 ans, et 41 % de plus à 16 ans
- Un ratio de mortalité par cancer de la prostate de 0,80 (IC 95 %, 0,72 à 0,90) à 16 ans
- Soit 1,76 décès évités pour 1000 hommes dépistés
- 570 hommes à inviter au dépistage pour prévenir un décès
L’essai randomisé en grappes britannique sur le dépistage par PSA (CAP) a inclus 419 582 hommes de 55 à 69 ans. Seulement 36 % des hommes du groupe intervention ont effectué le test PSA unique proposé. Au bout de 10 ans :
- 19 % de diagnostics supplémentaires dans le groupe dépisté (ratio de taux 1,19)
- Aucune différence significative de mortalité
- Taux de mortalité de 0,30 pour 1000 personnes-années dans le groupe intervention contre 0,31 dans le groupe témoin
L’essai américain Prostate, Lung, Colorectal and Ovarian (PLCO) a porté sur 76 683 hommes de 55 à 74 ans. Il n’a montré qu’un bénéfice limité, probablement en raison de la réalisation de tests PSA en dehors de l’étude dans le groupe témoin.
Sur la base de ces essais, on estime que le dépistage de 1000 hommes américains de 55 à 69 ans pourrait prévenir un décès par cancer de la prostate chez 1,3 homme sur les 13 années suivant le dépistage initial.
Risques potentiels du dépistage
Le dépistage par PSA comporte plusieurs risques significatifs à prendre en compte :
Résultats faux positifs : Le risque cumulé sur plusieurs cycles de dépistage est estimé entre 10 et 15 %. Environ 5 % des dépistages entraînent des faux positifs conduisant à des biopsies inutiles.
Complications de la biopsie : Les biopsies prostatiques présentent des risques incluant :
- Infection (5-7 % des patients, nécessitant une hospitalisation dans 1-3 % des cas)
- Saignement rectal nécessitant une intervention (environ 2,5 %)
- Présence de sang dans les urines (hématurie, moins de 1 %)
- Obstruction ou rétention urinaire
- Dysfonction érectile temporaire
- Inconfort pendant la procédure
Surdiagnostic : Il survient lorsque le dépistage détecte des cancers qui n’auraient jamais causé de symptômes ou de décès. On estime que 23 à 42 % des cancers détectés par dépistage entre 1985 et 2000 étaient surdiagnostiqués.
Effets secondaires du traitement : Pour les hommes traités, les complications potentielles incluent :
- Prostatectomie radicale : Risques accrus de dysfonction érectile et d’incontinence urinaire
- Radiothérapie : Troubles intestinaux et dysfonction érectile possibles
- Dans l’essai ProtecT, la radiothérapie altérait davantage la fonction intestinale que la surveillance active
Prise en charge après un dépistage positif
Lorsqu’un test PSA révèle un taux élevé (généralement au-dessus de 4,0 ng/mL aux États-Unis), plusieurs options s’offrent au patient :
Premières étapes :
- Répéter le test PSA pour confirmer le résultat et écarter une erreur de laboratoire
- Rechercher des causes temporaires d’élévation (prostatite, hypertrophie bénigne, éjaculation récente ou exercice intense)
- Les antibiotiques ne sont pas recommandés en l’absence de symptômes infectieux
Outils d’évaluation complémentaire : Avant une biopsie, plusieurs tests peuvent affiner l’évaluation du risque :
- Cinétique du PSA (évolution dans le temps)
- Tests sanguins : Prostate Health Index, test 4Kscore
- Tests urinaires : test PCA3
- Modèle Stockholm-3 (combinaison de plusieurs facteurs)
Procédures de biopsie :
- Approche standard : biopsie systématique échoguidée à 12 carottes
- Approche récente : IRM multiparamétrique suivie d’une biopsie ciblée des zones suspectes
- Les biopsies guidées par IRM améliorent la détection des cancers cliniquement significatifs et réduisent les erreurs de classification
- Le système PI-RADS classe les lésions de 1 à 5 ; un score ≥ 3 conduit généralement à une biopsie
Processus de décision partagée
La décision partagée est essentielle pour le dépistage du cancer de la prostate. Elle implique une discussion ouverte entre le patient et son médecin sur :
Bénéfices du dépistage :
- Réduction potentielle de la mortalité
- Détection précoce des cancers agressifs
- Tranquillité d’esprit en cas de résultat négatif
Risques du dépistage :
- Faux positifs entraînant des procédures inutiles
- Complications de la biopsie
- Surdiagnostic et surtraitement
- Effets secondaires des traitements (incontinence, dysfonction érectile)
Facteurs spécifiques au patient :
- Âge et espérance de vie
- Antécédents familiaux
- Origine ethnique (risque accru pour les hommes noirs)
- Valeurs et préférences personnelles
- Acceptation de l’incertitude versus l’intervention
Les aides à la décision—outils facilitant la compréhension des bénéfices et risques—peuvent améliorer les connaissances et réduire l’indécision. Elles améliorent modérément la compréhension des patients sans changer significativement leur choix final.
Recommandations actuelles de dépistage
Les organisations professionnelles proposent des recommandations variables :
U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF) :
- Préconise une décision individualisée pour les hommes de 55-69 ans
- Souligne un bénéfice potentiel faible face à des risques significatifs
- Déconseille le dépistage systématique après 70 ans
American Cancer Society :
- Recommande d’aborder le dépistage à 50 ans pour les hommes à risque moyen
- Suggère une discussion plus précoce (45 ans) pour les hommes à haut risque (noirs, antécédents familiaux)
- Discussion dès 40 ans pour les risques très élevés (multiples cas familiaux précoces)
American Urological Association :
- Préconise la décision partagée pour les 55-69 ans
- Dépistage sélectif pour les 40-54 ans à risque élevé
- Contre le dépistage systématique après 70 ans ou si espérance de vie < 10-15 ans
Toutes les recommandations soulignent que le dépistage ne doit pas être réalisé sans discussion préalable des bénéfices et risques.
Conseils cliniques
Pour un homme de 60 ans envisageant un dépistage, nous recommandons :
1. S’engager dans une décision partagée : Échangez avec votre médecin sur vos facteurs de risque, valeurs et préférences. Abordez les bénéfices et risques potentiels.
2. Utiliser des aides à la décision : Demandez des documents éducatifs ou des outils spécifiques au dépistage du cancer de la prostate pour mieux appréhender les compromis.
3. Considérer les facteurs de risque personnels : Tenez compte de votre origine ethnique, antécédents familiaux et état de santé. Les hommes noirs ou avec des antécédents familiaux peuvent bénéficier de discussions plus précoces ou fréquentes.
4. Comprendre le parcours : Un test positif n’est qu’une première étape pouvant mener à des tests répétés, une biopsie et des décisions thérapeutiques complexes.
5. Connaître toutes les options : La surveillance active (suivi sans traitement immédiat) est une approche valable pour les cancers à faible risque.
6. Considérer l’espérance de vie : Les hommes avec moins de 10-15 ans d’espérance de vie bénéficient peu du dépistage mais peuvent encore en subir les préjudices.
Limites et incertitudes des études
Plusieurs incertitudes persistent concernant le dépistage du cancer de la prostate :
Questions sur la surveillance active : Bien que sûre pour les cancers de faible risque, des interrogations subsistent sur :
- Quels patients à risque intermédiaire (grade 2) peuvent différer le traitement en sécurité
- Les stratégies optimales de suivi sous surveillance active
- Les meilleurs biomarqueurs pour guider les décisions
- Les déclencheurs appropriés pour initier un traitement
Personnalisation du dépistage : On ignore si l’adaptation selon l’origine ethnique, le risque génétique ou d’autres facteurs améliore les résultats.
Mise en œuvre de l’IRM : Des doutes persistent sur la sécurité de renoncer aux biopsies standard chez les hommes avec PSA élevé mais IRM normale, surtout sans antécédent de biopsie.
Résultats à long terme : Davantage de recherches sont nécessaires sur les résultats au-delà de 15-20 ans des décisions de dépistage et des traitements.
Sources d'information
Titre original de l'article : Screening for Prostate Cancer
Auteurs : Paul F. Pinsky, Ph.D., et Howard Parnes, M.D.
Publication : The New England Journal of Medicine, 13 avril 2023
DOI : 10.1056/NEJMcp2209151
Cet article destiné aux patients s’appuie sur une recherche évaluée par des pairs publiée dans The New England Journal of Medicine. Il conserve toutes les données originales, conclusions et recommandations cliniques tout en rendant l’information accessible à un public éduqué.