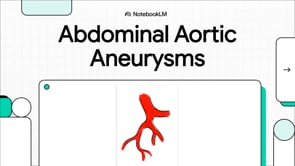Cette étude de cas porte sur un homme de 41 ans, épileptique depuis 15 ans, ayant développé des symptômes psychotiques sévères lors de son hospitalisation. Son cas illustre la relation complexe entre les crises et les manifestations psychiatriques, notamment la façon dont des grappes de crises peuvent déclencher une psychose post-critique, caractérisée par des comportements dangereux tels que l’agressivité, la paranoïa et les hallucinations. L’équipe médicale a posé le diagnostic de psychose post-critique, survenant après un retour à un état mental normal suite à des grappes de crises, une condition qui touche environ 7,8 % des patients dans les unités de monitoring de l’épilepsie.
Comprendre la psychose post-critique : un cas complexe de symptômes psychiatriques liés aux crises
Table des matières
- Contexte et introduction
- Présentation du cas : un homme de 41 ans présentant des crises et une agitation
- Antécédents médicaux et symptômes initiaux
- Déroulement hospitalier et progression des symptômes
- Examens diagnostiques et résultats d'imagerie
- Diagnostic différentiel : exploration des causes possibles
- Principales observations et diagnostic final
- Implications cliniques pour les patients épileptiques
- Facteurs de risque de psychose post-critique
- Approches thérapeutiques et prise en charge
- Limites et considérations
- Recommandations pour les patients et les familles
- Informations sur la source
Contexte et introduction
Ce cas du Massachusetts General Hospital illustre la relation complexe entre l'épilepsie et les symptômes psychiatriques. Environ 7,8 % des patients admis en unité de monitoring épileptique présentent une psychose post-critique, affection où des symptômes psychotiques surviennent après les crises. Les patients épileptiques ont un risque de psychose huit fois supérieur à celui de la population générale, ce qui en fait un enjeu majeur pour les patients et les soignants.
La relation bidirectionnelle signifie que les personnes souffrant de troubles psychotiques chroniques ont également un risque deux à trois fois plus élevé de développer une épilepsie. Ce cas montre comment l'activité critique peut influencer directement les symptômes psychiatriques et souligne l'importance d'une prise en charge à la fois neurologique et psychiatrique pour les patients atteints d'épilepsie pharmacorésistante.
Présentation du cas : un homme de 41 ans présentant des crises et une agitation
Un homme de 41 ans a été admis en unité de monitoring épileptique (UME) du Massachusetts General Hospital en raison d'une augmentation de la fréquence de ses crises. Le patient présentait une activité critique possible depuis l'âge de 4 ans, lorsque sa mère avait remarqué des épisodes de regard fixe et de perte de conscience. À 19 ans, il a été impliqué dans un accident de voiture unique (véhicule renversé), sans souvenir des événements ni consultation médicale ultérieure.
Environ 15 ans avant cette admission, il a reçu un diagnostic formel d'épilepsie, lorsqu'il a commencé à présenter des épisodes de regard fixe vers la gauche avec perte de conscience. Ces crises étaient précédées d'une « mauvaise sensation » épigastrique et suivies de confusion, d'agitation ou de somnolence. Son électroencéphalogramme (EEG) initial montrait des pointes bitemporales, et l'imagerie par résonance magnétique (IRM) révélait une asymétrie possible des cornes temporales.
Antécédents médicaux et symptômes initiaux
Les crises focales du patient survenaient hebdomadairement et ont évolué vers des crises tonico-cloniques généralisées. Pendant 15 ans, il a été traité par divers antiépileptiques à doses ajustées, avec environ une crise mensuelle malgré le traitement.
Au cours des trois mois précédant l'admission, la fréquence des crises est passée à trois par mois malgré l'observance de son traitement, qui comprenait :
- Carbamazépine
- Lévétiracétam
- Topiramate
Quatre semaines avant l'admission, il a présenté cinq crises en deux semaines. Deux semaines avant, des collègues ont observé des secousses de ses bras et jambes, ce qui a conduit les secours à le transporter aux urgences d'un autre hôpital. Il a reçu une prescription de diazépam pour l'insomnie et est rentré chez lui.
Déroulement hospitalier et progression des symptômes
Le lendemain de sa sortie, son neurologue l'a repéré titubant au bord de la route. Le patient se comportait de manière erratique et ne répondait pas aux questions. Les forces de l'ordre ont été appelées ; il a tenté de fuir avant d'être maîtrisé et conduit aux urgences.
Après la résolution de son état confusionnel, il a été orienté vers l'UME pour évaluation. Le jour de l'admission, il a signalé un stress professionnel et un sommeil inadéquat, mais une bonne observance médicamenteuse. Il décrivait un « flou » mnésique de quelques jours après chaque crise, tout en maintenant son activité professionnelle.
Lors de l'entretien d'admission, il a évoqué la sensation que « quelque chose d'étrange allait se produire », une vision floue et des mouvements non rythmiques des cuisses, tout en restant conscient—symptômes atypiques de ses crises habituelles.
Examens diagnostiques et résultats d'imagerie
L'IRM cérébrale initiale a montré une diminution du volume de l'hippocampe gauche et du gyrus parahippocampique, avec hyperintensité du signal. Une dilatation ex vacuo de la corne temporale gauche était présente, probablement secondaire à une perte de volume. La TEP intercritique a révélé une légère hypométabolisme du lobe temporal médian gauche.
Pendant l'hospitalisation, l'EEG continu a enregistré cinq crises avec regard fixe et mouvements subtils des jambes durant jusqu'à 3 minutes. La plupart des événements critiques provenaient du foyer temporal gauche, un du temporal droit, indiquant des foyers critiques indépendants bilatéraux.
Entre les crises, le patient a présenté des changements comportementaux sévères : tentatives d'arracher les électrodes EEG, coups et morsures envers le personnel, nécessitant intervention de sécurité et médication. Il a ensuite exprimé des idées paranoïaques (croyance que le personnel voulait le tuer) et des hallucinations auditives (bruit de clavier).
Diagnostic différentiel : exploration des causes possibles
L'équipe a envisagé plusieurs explications aux changements comportementaux :
- Agitation post-critique : Plus fréquente dans les crises temporolimbiques, survenant typiquement juste après les crises sans intervalle lucide
- État de mal épileptique non convulsif : Activité critique continue sans convulsions, écarté par l'EEG continu
- Crises non épileptiques : Crises d'origine psychologique, mais le patient présentait des crises épileptiques objectivées à l'EEG
- Psychose intercritique : Psychose survenant entre les crises sans lien direct
- Psychose ictale : Psychose comme manifestation directe des crises, généralement brève (20 secondes à 3 minutes)
- Psychose post-critique : Psychose suivant les crises après retour à un état mental normal
- Normalisation forcée : Normalisation paradoxale de l'EEG avec apparition de symptômes psychiatriques lors du contrôle des crises
Principales observations et diagnostic final
L'équipe a retenu le diagnostic de psychose post-critique sur la base de plusieurs éléments :
La psychose est apparue 16 heures après un retour à un état mental normal suite à une série de cinq crises focales avec altération de la conscience. Le patient présentait des foyers critiques indépendants bilatéraux (temporaux gauche et droit), documentés par l'EEG. Son épilepsie évoluait depuis au moins 15 ans (voire 22 ou 37 ans en incluant les symptômes précoces), ce qui correspond à la chronologie typique de la psychose post-critique.
Il présentait des symptômes caractéristiques : hallucinations auditives, paranoïa, agressivité et discours incohérent. Le diagnostic DSM-5-TR était « trouble psychotique dû à une autre affection médicale (épilepsie) avec idées délirantes ».
L'équipe a également évoqué une possible « poriomanie »—délire post-critique spécifique avec errance et amnésie—sur la base de son comportement erratique au bord de la route avant l'admission.
Implications cliniques pour les patients épileptiques
Ce cas met en lumière plusieurs implications importantes :
Les symptômes psychiatriques peuvent être une conséquence directe de l'activité critique, et non une affection distincte. Les crises groupées (multiples en peu de temps) augmentent significativement le risque de psychose post-critique. Les ajustements médicamenteux, surtout les changements rapides d'antiépileptiques, peuvent aggraver les symptômes psychiatriques par normalisation forcée.
Les patients avec des foyers critiques bilatéraux ont un risque plus élevé de complications psychiatriques. La psychose apparaît typiquement après de nombreuses années d'épilepsie.
Facteurs de risque de psychose post-critique
Plusieurs facteurs augmentent le risque :
- Épilepsie pharmacorésistante
- Crises groupées (au moins trois en 24 heures)
- Sexe masculin (plus fréquent chez les hommes)
- Durée des crises dépassant 10 ans
- Présence d'une aura critique
- Foyers critiques indépendants bilatéraux
- Antécédents de psychose post-critique
- Antécédents familiaux de psychose (absent ici)
Ce patient présentait tous ces facteurs sauf les antécédents familiaux, le rendant particulièrement vulnérable.
Approches thérapeutiques et prise en charge
L'équipe a utilisé plusieurs stratégies :
Ajustement des antiépileptiques : diminution puis augmentation de la carbamazépine, arrêt et reprise du lévétiracétam, transition vers le lacosamide IV. Pour l'agitation aiguë : antipsychotiques (halopéridol, rispéridone) et benzodiazépines (lorazépam).
Pour les symptômes autonomes (tension artérielle à 160/100 mm Hg, pouls à 120/min) : labétalol. Mesures de sécurité : contentions temporaires à deux et quatre points pendant les phases d'agitation extrême.
La prise en charge de la psychose post-critique nécessite à la fois le contrôle des crises et la gestion des symptômes psychiatriques.
Limites et considérations
Cette étude présente plusieurs limites :
En tant que cas unique, les résultats ne sont pas généralisables. Le caractère rétrospective peut entraîner des lacunes ou des biais de mémoire. Les changements complexes de médicaments rendent difficile l'évaluation d'effets spécifiques.
La possibilité de crises non épileptiques associées n'a pu être écartée (environ 20 % des épilepsies pharmacorésistantes en présentent). L'histoire ancienne d'activité critique depuis l'enfance complique l'établissement d'une chronologie précise.
Recommandations pour les patients et les familles
Les patients et leurs proches doivent :
- Surveiller les changements comportementaux après les crises, surtout si groupées
- Signaler rapidement tout nouveau symptôme psychiatrique (paranoïa, hallucinations, agressivité)
- Comprendre que les ajustements médicamenteux peuvent temporairement aggraver les symptômes psychiatriques
- Maintenir une communication entre neurologie et psychiatrie
- Prévoir des mesures de sécurité pour l'agitation ou la confusion post-critiques
- Tenir un agenda détaillé des crises et des comportements
- Rechercher une prise en charge globale, neurologique et psychiatrique
Les familles doivent noter que la psychose post-critique survient généralement après un retour à un état mental normal, et non immédiatement après les crises. Cet intervalle lucide peut durer de quelques heures à plusieurs jours.
Informations sur la source
Titre original : Cas 37-2024 : Un homme de 41 ans présentant des crises et de l'agitation
Auteurs : Sheldon Benjamin, M.D., Lara Basovic, M.D., Javier M. Romero, M.D., Alice D. Lam, M.D., Ph.D., et Caitlin Adams, M.D.
Publication : The New England Journal of Medicine, 28 novembre 2024, Volume 391, Numéro 21, Pages 2036-2046
DOI : 10.1056/NEJMcpc2402500
Cet article vulgarisé s'appuie sur une recherche évaluée par les pairs issue des dossiers de cas du Massachusetts General Hospital publiés dans The New England Journal of Medicine.