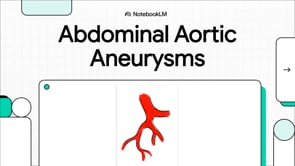Ce cas concerne un lutteur universitaire de 20 ans ayant développé une éruption pustuleuse généralisée après un contact étroit avec une personne présentant des symptômes similaires. Malgré un traitement antibiotique initial, ses lésions ont progressé sur plusieurs jours, l’amenant à se présenter aux urgences en pleine épidémie mondiale de monkeypox. Des examens approfondis ont révélé une infection par le virus de l’herpès simplex de type 1 (VHS-1), responsable d’un herpès du gladiateur — affection fréquente chez les lutteurs — et non une infection par le monkeypox, initialement suspectée en raison de la similarité des manifestations cliniques.
Comprendre l'herpès du gladiateur : étude de cas d'une infection cutanée chez un lutteur
Table des matières
- Présentation du cas : le lutteur de 20 ans
- Antécédents médicaux et résultats de l'examen
- Résultats des examens biologiques
- Causes possibles : diagnostic différentiel
- Impression clinique du médecin
- Considérations sur le contrôle des infections
- Tests diagnostiques et approche thérapeutique
- Diagnostic final et discussion
- Implications pour les patients
- Sources d'information
Présentation du cas : le lutteur de 20 ans
Un lutteur universitaire de 20 ans s’est présenté aux urgences pour une éruption pustuleuse étendue évoluant depuis plusieurs jours. Les lésions sont d’abord apparues sur l’avant-bras gauche trois jours plus tôt, accompagnées de picotements lors des douches. Athlète universitaire, il a d’abord consulté son entraîneur, qui l’a orienté vers le service de santé de son établissement.
Le lendemain, l’éruption s’était étendue au bras droit. Les soignants ont prescrit du triméthoprime-sulfaméthoxazole par voie orale et de la mupirocine en application locale. Malgré ce traitement, de nouvelles lésions sont apparues sur le thorax, le visage et les oreilles dans les jours suivants.
N’ayant pas pu obtenir rapidement un rendez-vous en dermatologie après orientation par son médecin traitant, le patient s’est rendu aux urgences. Il décrivait des démangeaisons importantes et une extension persistante des lésions sous antibiothérapie. Il signalait également un contact rapproché, quelques jours avant le début des symptômes, avec une personne présentant une éruption similaire.
Antécédents médicaux et résultats de l'examen
Le patient avait des antécédents d’herpès buccal, de rhinite allergique, de tendinose rotulienne et d’amygdalectomie. Trois ans auparavant, il avait été traité pour une infection à Staphylococcus aureus sensible à la méticilline au bras droit par antibiotiques locaux. Son traitement actuel comprenait le triméthoprime-sulfaméthoxazole prescrit, de la loratadine et de l’albutérol en inhalation à la demande.
Il était vacciné contre le SARS-CoV-2 (deux doses) mais n’avait pas reçu le vaccin contre le mpox, n’étant pas identifié comme personne à risque. Sexuellement actif avec des partenaires féminines, il déclarait vapoter, mais ne consommait ni alcool, ni tabac, ni substances illicites. Il résidait en cité universitaire et pratiquait la lutte en compétition.
À l’examen, les constantes vitales étaient normales : température 36,2 °C, fréquence cardiaque 88 battements/min, tension artérielle 129/74 mm Hg, fréquence respiratoire 18 cycles/min et saturation en oxygène à 98 % en air ambiant. Son poids était de 77 kg, avec une morphologie musclée.
L’examen cutané révélait des dizaines de lésions vésiculopustuleuses groupées et surélevées, sur fond érythémateux, à différents stades évolutifs. Certaines étaient pustuleuses, d’autres ombiliquées (avec dépression centrale), d’autres encore croûteuses ou escarrifiées. Certaines zones présentaient une confluence des lésions.
Les lésions étaient réparties sur plusieurs régions :
- Les creux poplités (face interne des coudes)
- Les joues
- Le torse et le dos
- L’aisselle gauche
- La partie inférieure droite de l’abdomen
- Les mollets
- L’occiput (arrière du crâne)
- La région rétro-auriculaire
On observait également un érythème dans les plis cutanés. Le reste de l’examen physique était sans particularité.
Résultats des examens biologiques
Les analyses sanguines montraient des taux normaux d’électrolytes, de glucose, d’albumine, de globuline, d’enzymes hépatiques (ALAT, ASAT) et de bilirubine. La fonction rénale était également normale. Autres résultats :
Hémogramme :
- Hémoglobine : 15,3 g/dL (normale : 13,5–17,5)
- Hématocrite : 46,8 % (normale : 41,0–53,0)
- Leucocytes : 4 650/μL (normale : 4 500–11 000)
- Neutrophiles : 2 390/μL (normale : 1 800–8 100)
- Lymphocytes : 1 150/μL (normale : 1 200–5 200)
- Monocytes : 740/μL (normale : 200–1 400)
- Éosinophiles : 210/μL (normale : 0–1 000)
- Granulocytes immatures : 1,5 % (normale : 0–0,9), incluant métamyélocytes, myélocytes et promyélocytes
- Plaquettes : 198 000/μL (normale : 150 000–400 000)
Les tests SARS-CoV-2 et VIH 1/2 étaient négatifs. La présence de granulocytes immatures a motivé la réalisation d’une numération formule manuelle.
Causes possibles : diagnostic différentiel
Plusieurs étiologies ont été envisagées pour cette éruption vésiculopustuleuse, classées en causes non infectieuses et infectieuses.
Causes non infectieuses :
- Maladies auto-immunes (sarcoïdose, dermatoses perforantes, porphyrie)
- Hémopathies malignes (leucémies cutanées)
- Réactions médicamenteuses (notamment aux sulfamides)
- Érythème polymorphe
- Dermatoses neutrophiliques (syndrome de Sweet)
- Pityriasis rosé vésiculaire
- Eczema vaccinatum
Causes infectieuses :
- Infections virales : herpèsvirus (VHS-1, VHS-2, VZV), poxvirus (molluscum, mpox), parvovirus, entérovirus, rougeole, VIH
- Infections bactériennes : folliculite à staphylocoque ou pseudomonas, rickettsioses, anthrax, mycobactéries non tuberculeuses, syphilis, typhus des broussailles
- Infections fongiques : cryptococcose, histoplasmose, talaromycose
- Infestations parasitaires : gale nodulaire
L’absence de fièvre et de signes systémiques écartait de nombreuses infections sévères. Les antécédents de lutte et le contact avec une personne présentant une éruption similaire orientaient vers une transmission cutanée. La progression centripète (des membres vers le tronc) et l’évolution asynchrone des lésions ont aidé à affiner le diagnostic.
Impression clinique du médecin
Bien que l’herpès du gladiateur (infection à VHS chez les lutteurs) ait été suspecté d’emblée, l’étendue des lésions était préoccupante. Dans le contexte d’épidémie mondiale de mpox, même les patients sans facteurs de risque typiques pouvaient être infectés.
L’entraîneur a signalé que plusieurs coéquipiers avaient présenté des éruptions similaires, résolues sous triméthoprime-sulfaméthoxazole. Cette information, cruciale, était aussi alarmante car l’équipe devait participer à une compétition pendant la période d’attente des résultats.
Le dépistage du mpox, complexe en raison de contraintes logistiques, a été accéléré grâce à une collaboration avec le Département de santé publique du Massachusetts et le programme hospitalier dédié aux pathogènes spéciaux.
Considérations sur le contrôle des infections
Devant la suspicion de mpox, des mesures strictes de contrôle infectieux ont été mises en place. Un outil d’aide à la décision électronique a confirmé la nécessité d’une évaluation approfondie.
Protocoles appliqués :
- Isolement en chambre individuelle avec sanitaires dédiés
- Équipement de protection : blouse, gants, protection oculaire, masque N95
- Démarche « identifier-isoler-informer » pour les maladies émergentes
- Signalement aux autorités sanitaires
L’outil d’aide à la décision, utilisé durant l’épidémie de mpox, affichait une valeur prédictive positive de 35 % et une valeur prédictive négative de 99 % sur 668 utilisations analysées.
Tests diagnostiques et approche thérapeutique
En attendant les résultats, le patient a reçu :
- Du técovirimat dans le cadre d’un protocole d’accès élargi (suspicion de mpox)
- Du valaciclovir (suspicion d’infection herpétique)
Le laboratoire de santé publique du Massachusetts a réalisé en priorité des tests de amplification des acides nucléiques pour les orthopoxvirus non varioliques (dont le mpox). Le patient a été autorisé à rentrer à domicile avec consigne d’isolement jusqu’aux résultats.
Les coéquipiers en déplacement ne présentaient aucun symptôme évocateur de mpox. Les résultats ont finalement montré :
- Négatif pour les orthopoxvirus non varioliques (mpox)
- Négatif pour le VHS-2
- Négatif pour le VZV
- Positif pour le VHS-1
Le diagnostic d’infection à VHS-1 a été confirmé. Le técovirimat a été arrêté et le valaciclovir poursuivi.
Diagnostic final et discussion
Le diagnostic final était un herpès du gladiateur dû au VHS-1. Décrit initialement en 1964 chez des lutteurs, cette affection est bien documentée dans les sports de contact (lutte, rugby — parfois appelé « herpès du rugbyman »).
Une épidémie notable a touché 60 lutteurs dans un camp du Minnesota en 1989. La transmission se fait par contact cutané direct ou avec des surfaces contaminées (tapis). La pratique de la lutte favorise les contacts prolongés, propices à la dissémination.
L’auto-inoculation explique la présence de lésions d’âges différents. Celles-ci siègent typiquement sur les zones exposées au contact adverse : visage, cou, avant-bras.
Traitement recommandé :
- Infection primaire : valaciclovir 2 fois/jour pendant 10–14 jours
- Récidive : valaciclovir 2 fois/jour pendant 5–7 jours
Implications pour les patients
Ce cas souligne plusieurs enseignements pour les patients, notamment les athlètes de sports de contact :
Pour les lutteurs et sportifs :
- L’herpès du gladiateur est un risque connu dans les sports avec contact cutané
- Un diagnostic et un traitement précoces limitent la transmission
- Les lésions apparaissent sur les zones de contact
- Signaler sa pratique sportive en cas de consultation pour problème cutané
Aspects infectieux :
- Des symptômes similaires peuvent correspondre à des diagnostics différents
- Une anamnèse détaillée (expositions, activités) est essentielle
- Les contextes épidémiques influencent la prise en charge
- L’isolement peut être nécessaire en attente de résultats
Conseils généraux :
- Signaler tout cas similaire dans l’entourage
- Suivre intégralement les traitements prescrits
- Respecter les mesures d’isolement en cas d’infection transmissible
- Discuter de la vaccination en fonction des expositions
Sources d'information
Titre original : Case 16-2024: A 20-Year-Old Man with a Pustular Rash
Auteurs : Demetre C. Daskalakis, Howard M. Heller, Erica S. Shenoy, Katherine Hsu
Publication : The New England Journal of Medicine, 30 mai 2024
DOI : 10.1056/NEJMcpc2312737
Cet article vulgarisé s’appuie sur une étude évaluée par les pairs issue des dossiers du Massachusetts General Hospital.