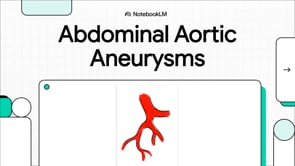Cette analyse exhaustive, portant sur 79 patients atteints de sclérose en plaques secondaire progressive active (SEP-SP) traités par autogreffe de cellules souches hématopoïétiques (ACSH) et comparés à 1 975 patients sous thérapies modifiant la maladie standards, a montré que l’ACSH ralentissait significativement la progression du handicap. Les receveurs de greffe présentaient un risque de détérioration confirmée du handicap réduit de 50 %, avec 61,7 % des patients sans progression à 5 ans, contre 46,3 % sous autres traitements. Plus remarquable encore, 34,7 % des patients sous ACSH ont bénéficié d’une amélioration soutenue du handicap à 3 ans, contre seulement 4,6 % sous thérapies conventionnelles, ce qui traduit une différence spectaculaire dans le potentiel de récupération neurologique.
La greffe de cellules souches : des bénéfices significatifs pour les patients atteints de SEP progressive secondaire active
Table des matières
- Introduction : Comprendre la SEP progressive secondaire et ses défis thérapeutiques
- Méthodes de l’étude : Conception et déroulement de la recherche
- Principaux résultats : Données détaillées et analyses statistiques
- Implications cliniques : Portée pour les patients
- Limites de l’étude : Ce que la recherche n’a pas pu établir
- Recommandations : Conseils pratiques à l’intention des patients
- Information sur la source
Introduction : Comprendre la SEP progressive secondaire et ses défus thérapeutiques
La sclérose en plaques progressive secondaire (SEP-PS) correspond à une phase évolutive de la maladie où les patients voient leur handicap neurologique s’aggraver progressivement, indépendamment de poussées identifiables. Cette accumulation d’incapacités affecte profondément la qualité de vie et le fonctionnement au quotidien. Si les mécanismes exacts de cette progression ne sont pas entièrement élucidés, des données récentes suggèrent une inflammation compartimentalisée au sein du système nerveux central (cerveau et moelle épinière) qui continue d’alimenter les lésions nerveuses, même en l’absence de poussées visibles.
Les traitements de fond disponibles (thérapies modifiant l’évolution de la maladie) n’ont montré que des bénéfices modestes chez les patients atteints de SEP-PS. Dans les essais cliniques récents, même les médicaments les plus efficaces n’ont eu qu’un impact limité, retardant la progression du handicap d’environ 19 jours par an seulement. Cette efficacité modeste souligne le besoin urgent d’approches thérapeutiques plus performantes pour cette population.
La greffe autologue de cellules souches hématopoïétiques (GCSH) s’est imposée comme une stratégie prometteuse pour les formes agressives de SEP. Cette procédure consiste à prélever les cellules souches du patient, à administrer une chimiothérapie intensive pour « réinitialiser » le système immunitaire, puis à réinjecter les cellules souches afin de reconstruire un système immunitaire exempt des anomalies auto-immunes responsables de la maladie.
Méthodes de l’étude : Conception et déroulement de la recherche
Cette étude multicentrique italienne a comparé l’évolution de 79 patients atteints de SEP-PS active ayant bénéficié d’une GCSH entre 1997 et 2019 avec celle de 1 975 patients traités par d’autres thérapies modifiant l’évolution de la maladie, issus du Registre Italien de la Sclérose en Plaques. Des méthodes statistiques avancées ont été employées pour assurer des comparaisons équitables entre ces groupes, bien qu’il ne s’agisse pas d’un essai randomisé.
Les patients étaient inclus s’ils avaient initié un traitement après le diagnostic de SEP-PS, présentaient des scores EDSS (Expanded Disability Status Scale) initiaux documentés et avaient au moins une visite de suivi. Le groupe témoin comprenait des patients sous diverses thérapies : interférons bêta (24 %), azathioprine (13 %), acétate de glatiramère (13 %), mitoxantrone (11 %), fingolimod (9 %), natalizumab (7 %), méthotrexate (6 %), tériflunomide (6 %), cyclophosphamide (6 %), diméthyl fumarate (4 %) et alemtuzumab (1 %).
La procédure de transplantation impliquait une mobilisation des cellules souches par cyclophosphamide associé au filgrastim. La majorité des patients (64 sur 79) ont reçu le conditionnement BEAM (carmustine, cytarabine, étoposide et melphalan) associé à la globuline antithymocyte (GAT), tandis que d’autres ont bénéficié de protocoles différents selon leur profil et les décisions médicales.
Deux approches statistiques ont été utilisées pour minimiser les biais de sélection : l’appariement par score de propension (création de groupes comparables basés sur les caractéristiques des patients) et la pondération par recouvrement (inclusion de tous les patients avec ajustement des différences). Ces méthodes ont pris en compte l’âge, le sexe, le handicap initial, les traitements antérieurs, le taux de poussées, la durée de la maladie et l’année de début du traitement.
Principaux résultats : Données détaillées et analyses statistiques
L’étude a révélé des différences marquées entre les approches thérapeutiques sur plusieurs indicateurs d’évolution. Les résultats les plus significatifs incluent :
Progression du handicap
Le délai jusqu’à la progression confirmée du handicap (PCD) était significativement plus long chez les patients traités par GCSH. Le hazard ratio était de 0,50 (IC 95 % : 0,31-0,81 ; p=0,005), indiquant une réduction de 50 % du risque d’aggravation du handicap par rapport aux autres thérapies.
À 3 ans post-traitement, 71,9 % des patients sous GCSH restaient exempts de progression du handicap (IC 95 % : 58,5-81,5 %), contre seulement 58,1 % sous autres thérapies (IC 95 % : 50,3-64,9 %). À 5 ans, l’écart se creusait davantage : 61,7 % des greffés sans progression (IC 95 % : 47,5-73,1 %) contre 46,3 % sous thérapies conventionnelles (IC 95 % : 37,4-54,5 %).
Amélioration du handicap
L’amélioration significative du handicap observée chez les patients sous GCSH constitue peut-être la découverte la plus remarquable. Le taux d’amélioration était 4,21 fois plus élevé chez les receveurs de greffe (HR=4,21 ; IC 95 % : 2,42-7,33 ; p<0,001).
À 1 an post-traitement, 30,2 % des patients sous GCSH avaient présenté une amélioration mesurable du handicap (IC 95 % : 20,6-42,8 %), contre seulement 3,4 % sous autres thérapies (IC 95 % : 1,6-7,0 %). À 3 ans, 38,8 % des greffés maintenaient une amélioration (IC 95 % : 28,0-51,9 %), contre 7,8 % sous thérapies conventionnelles (IC 95 % : 4,6-12,7 %).
Taux annuel de poussées
Les taux de poussées étaient considérablement plus bas chez les patients sous GCSH. Durant les deux premières années de suivi, le taux annuel de poussées (TAP) était de 0,024 (IC 95 % : 0-0,051) dans le groupe greffe, contre 0,32 (IC 95 % : 0,24-0,39) dans le groupe autres thérapies. Cela représente une réduction de 92,5 % du risque de poussée (RR=0,075 ; IC 95 % : 0,023-0,24 ; p<0,001).
Sur l’ensemble du suivi, le TAP restait significativement plus bas chez les patients sous GCSH à 0,020 (IC 95 % : 0,006-0,034), contre 0,45 (IC 95 % : 0,36-0,55) dans le groupe témoin, soit une réduction de 95,6 % du risque de poussée (RR=0,044 ; IC 95 % : 0,021-0,091 ; p<0,001).
Évolution du handicap
L’analyse longitudinale des scores EDSS a montré des trajectoires nettement différentes entre les groupes. Les patients sous GCSH présentaient une stabilité du handicap, avec une variation annuelle estimée de l’EDSS de -0,013 point par an (IC 95 % : -0,087 à 0,061), signifiant l’absence de progression significative. En revanche, les patients sous autres thérapies montraient une progression nette, avec une variation annuelle de +0,157 point par an (IC 95 % : 0,117-0,196). La différence entre ces trajectoires était hautement significative (p<0,001).
Implications cliniques : Portée pour les patients
Ces résultats ont des implications majeures pour le traitement de la SEP progressive secondaire active. L’étude apporte la preuve la plus solide à ce jour que la GCSH peut modifier significativement l’histoire naturelle de la SEP-PS, non seulement en ralentissant la progression du handicap, mais aussi en permettant une amélioration neurologique chez une proportion substantielle de patients.
Pour les patients atteints de SEP-PS active qui continuent à présenter des poussées ou une activité à l’IRM malgré les traitements conventionnels, la GCSH représente une option potentiellement transformative. La réduction drastique des taux de poussées (plus de 90 %) et l’amélioration significative du handicap observée chez plus d’un tiers des patients suggèrent qu’une intervention précoce par GCSH chez des candidats appropriés pourrait prévenir les lésions neurologiques irréversibles.
La stabilité des scores de handicap dans le temps chez les receveurs de greffe, comparée à la progression régulière sous autres thérapies, indique que la GCSH pourrait offrir un contrôle à long terme de la maladie dépassant ce qui est réalisable avec les médicaments actuels. Ce point est particulièrement important pour les patients SEP-PS, qui connaissent typiquement un déclin graduel malgré le traitement.
Il est à noter que sept patients (8,9 %) du groupe transplantation ont nécessité des thérapies supplémentaires après la GCSH, initiées en médiane 2,2 ans post-greffe. Cela suggère que, bien que la GCSH procure des bénéfices robustes et durables pour la majorité des patients, certains pourraient encore requérir un traitement additionnel, soulignant l’importance d’une surveillance continue même après la transplantation.
Limites de l’étude : Ce que la recherche n’a pas pu établir
Si ces résultats sont convaincants, plusieurs limites doivent être prises en compte. Il ne s’agissait pas d’un essai randomisé contrôlé, mais d’une étude observationnelle comparant des patients sous différents traitements. Malgré des méthodes statistiques sophistiquées pour minimiser les biais de sélection, des facteurs non mesurés pourraient encore influencer les résultats.
La population étudiée était relativement petite (79 patients sous GCSH), et le traitement a été réalisé dans 14 centres différents, avec certaines variations dans les protocoles. Bien que la majorité des patients aient reçu le régime BEAM+GAT, d’autres conditionnements ont été utilisés, ce qui pourrait affecter l’évolution.
Les données IRM n’étaient pas disponibles pour la plupart des patients du groupe témoin, limitant la capacité à ajuster pleinement l’activité IRM dans les analyses. Ce point est important car l’activité IRM peut influencer à la fois les décisions thérapeutiques et l’évolution.
La durée de suivi variait entre les patients, et les données à très long terme (au-delà de 10 ans) ne sont pas encore disponibles. De plus, l’étude s’est concentrée sur les patients avec SEP-PS « active » (ceux avec des poussées récentes ou une activité IRM), donc les résultats pourraient ne pas s’appliquer aux patients avec SEP-PS non active.
Enfin, comme dans toute étude observationnelle, des facteurs confusionnels non mesurés pourraient avoir influencé à la fois la sélection du traitement et l’évolution, sans être pleinement pris en compte par les méthodes statistiques.
Recommandations : Conseils pratiques à l’intention des patients
Sur la base de ces résultats, les patients atteints de sclérose en plaques progressive secondaire active devraient considérer les éléments suivants :
- Discutez de la GCSH avec votre neurologue si vous présentez une SEP-PS active avec poussées persistantes ou activité IRM malgré les traitements conventionnels. Cette option peut être particulièrement pertinente pour les patients plus jeunes avec une maladie agressive.
- Consultez dans un centre spécialisé en SEP ayant une expérience à la fois de la prise en charge de la maladie et de la transplantation de cellules souches, pour déterminer si vous êtes un candidat approprié.
- Comprenez les risques et bénéfices – Bien que la GCSH montre une efficacité impressionnante, elle comporte des risques significatifs (infections, infertilité, autres complications) qui doivent être soigneusement pondérés face aux bénéfices potentiels.
- Envisagez le timing avec attention – Une intervention précoce durant la phase active de la SEP-PS pourrait offrir la meilleure opportunité de prévenir l’accumulation irréversible de handicap.
- Maintenez des attentes réalistes – Bien que de nombreux patients bénéficient significativement, les résultats varient, et certains pourraient encore nécessiter des thérapies additionnelles après la transplantation.
- Participez à une surveillance continue – Un suivi régulier est essentiel même après une transplantation réussie, pour détecter toute réactivation potentielle de la maladie ou complications tardives.
Cette recherche représente une avancée importante dans le traitement de la sclérose en plaques progressive secondaire, offrant l’espoir d’une modification plus efficace de la maladie au-delà des thérapies conventionnelles. Comme toujours, les décisions thérapeutiques doivent être prises collaborativement entre les patients et leurs équipes soignantes, en fonction des circonstances individuelles, des préférences et de la tolérance au risque.
Information sur la source
Titre original de l’article : Transplantation de cellules souches hématopoïétiques chez les personnes atteintes de sclérose en plaques progressive secondaire active
Auteurs : Giacomo Boffa, MD ; Alessio Signori, PhD ; Luca Massacesi, MD ; Alice Mariottini, MD, PhD ; Elvira Sbragia, MD ; Salvatore Cottone, MD ; Maria Pia Amato, MD ; Claudio Gasperini, MD, PhD ; Lucia Moiola, MD, PhD ; Stefano Meletti, MD, PhD ; Anna Maria Repice, MD ; Vincenzo Brescia Morra, MD ; Giuseppe Salemi, MD ; Francesco Patti, MD ; Massimo Filippi, MD ; Giovanna De Luca, MD ; Giacomo Lus, MD ; Mauro Zaffaroni, MD ; Patrizia Sola, MD, PhD ; Antonella Conte, MD, PhD ; Riccardo Nistri, MD ; Umberto Aguglia, MD ; Franco Granella, MD ; Simonetta Galgani, MD ; Luisa Maria Caniatti, MD ; Alessandra Lugaresi, MD, PhD ; Silvia Romano, MD, PhD ; Pietro Iaffaldano, MD ; Eleonora Cocco, MD ; Riccardo Saccardi, MD ; Emanuele Angelucci, MD ; Maria Trojano, MD ; Giovanni Luigi Mancardi, MD ; Maria Pia Sormani, PhD ; et Matilde Inglese, MD, PhD
Publication : Neurology 2023;100:e1109-e1122. doi:10.1212/WNL.0000000000206750
Note : Cet article vulgarisé s’appuie sur une recherche évaluée par des pairs menée par le Groupe d’étude italien sur la greffe de moelle osseuse et la sclérose en plaques (BMT-MS) et le Registre italien de la sclérose en plaques, incluant 79 patients traités par autogreffe de cellules souches hématopoïétiques (ACSH) et 1 975 patients traités par d’autres thérapies modifiant l’évolution de la maladie.