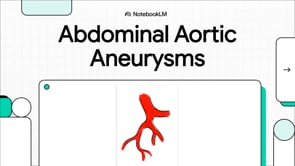Cette analyse exhaustive de la sécurité du traitement par ocrelizumab dans la sclérose en plaques a porté sur 5 680 patients suivis jusqu’à 7 ans, représentant 18 218 patients-années d’exposition. L’étude a montré que l’ocrelizumab conserve un profil de sécurité cohérent sur cette période prolongée, avec des taux d’infection (76,2 pour 100 patients-années) et d’événements indésirables graves (7,3 pour 100 patients-années) demeurant stables par rapport aux phases d’essais antérieures. Il est à noter que les taux d’infections graves (2,01 pour 100 patients-années) et de tumeurs malignes (0,46 pour 100 patients-années) restent dans les fourchettes attendues pour la population atteinte de SEP, confirmant ainsi la sécurité à long terme de ce traitement.
Sécurité à long terme de l’ocrelizumab dans la sclérose en plaques : données de suivi sur 7 ans
Table des matières
- Introduction : pertinence de cette recherche
- Méthodologie de l’étude et population de patients
- Profil de sécurité global
- Analyse détaillée des risques spécifiques
- Modifications biologiques et surveillance
- Expérience en vie réelle et données post-commercialisation
- Conclusions et implications cliniques
- Limites de l’étude
- Recommandations aux patients
- Informations sur la source
Introduction : pertinence de cette recherche
L’ocrelizumab (OCR) représente une option thérapeutique majeure pour la sclérose en plaques récurrente-rémittente (SEP-RR) et la sclérose en plaques primaire progressive (SEP-PP). Ce médicament agit en ciblant sélectivement certaines cellules B, tout en préservant leur capacité de régénération et l’immunité humorale existante. Il constitue ainsi une avancée significative dans la prise en charge de la SEP.
Si des études antérieures à court terme avaient établi son efficacité et son profil de sécurité initial, les données exhaustives au-delà de quelques années restaient limitées. Cette recherche répond à une question cruciale pour les patients et les cliniciens : quel est le risque d’un traitement prolongé par ocrelizumab sur plusieurs années ?
Pour les patients sous ocrelizumab ou l’envisageant, la connaissance du profil de sécurité à long terme est essentielle pour une décision thérapeutique éclairée. Cette étude propose l’analyse la plus complète à ce jour, avec un suivi allant jusqu’à 7 ans de traitement continu.
Méthodologie de l’étude et population de patients
Cette analyse regroupe les données de sécurité de 11 essais cliniques, incluant les phases contrôlées initiales et les extensions en ouvert où tous les participants recevaient de l’ocrelizumab. Les chercheurs ont intégré les données de 5 680 patients atteints de sclérose en plaques ayant reçu au moins une dose du médicament.
La population comprenait 4 376 personnes avec une SEP-RR et 1 304 avec une SEP-PP. L’âge médian au début du traitement était de 38 ans pour la SEP-RR et 47 ans pour la SEP-PP, avec des âges variant de 18 à 66 ans. Cela reflète un éventail représentatif des patients rencontrés en pratique clinique.
L’exposition totale à l’ocrelizumab s’élève à 18 218 patients-années, offrant un volume substantiel de données pour l’évaluation des risques. Plus de 50 % des patients ont reçu au moins 5 doses, et 28 % au moins 10 doses, témoignant d’une exposition prolongée.
Pour compléter, les chercheurs ont inclus des données post-commercialisation jusqu’en juillet 2020, période durant laquelle environ 174 508 patients avaient initié un traitement par ocrelizumab dans le monde, dont 167 684 après son approbation, représentant 249 971 patients-années d’expérience en vie réelle.
Profil de sécurité global
L’analyse exhaustive révèle que l’ocrelizumab maintient un profil de sécurité cohérent sur les 7 années d’observation. Le taux global d’événements indésirables était de 248 pour 100 patients-années (IC 95 % : 246–251), demeurant stable par rapport aux phases antérieures des essais.
Les événements indésirables graves survenaient à un taux de 7,3 pour 100 patients-années (IC 95 % : 7,0–7,7), également conforme aux observations précédentes. Le taux d’arrêt du traitement pour effets indésirables était de 3,19 % (181/5 680 patients) sur jusqu’à 7 ans, inférieur aux comparateurs durant les phases contrôlées (3,35 % sous placebo et 6,17 % sous interféron bêta-1a sur jusqu’à 3 ans).
Les motifs les plus fréquents d’arrêt incluaient :
- Tumeurs malignes (40 cas, arrêt obligatoire)
- Réactions liées à la perfusion (33 cas, survenant surtout lors de la première administration)
- Infections (27 cas, majoritairement non graves)
Les décès étaient rares, avec 26 cas rapportés (11 en SEP-RR, 15 en SEP-PP) sur 5 680 patients et 18 218 patients-années, soit un taux de 0,14 pour 100 patients-années (IC 95 % : 0,09–0,21). Les causes principales étaient les suicides (7 cas), les infections (4 cas), les tumeurs malignes (4 cas) et les événements cardiaques (3 cas).
Analyse détaillée des risques spécifiques
Réactions liées à la perfusion : Elles restaient parmi les effets indésirables les plus fréquents, avec un taux de 25,9 pour 100 patients-années (IC 95 % : 25,1–26,6) dans l’ensemble de la population. Notamment, ce taux diminuait avec les perfusions ultérieures, indiquant une prédominance lors des premières administrations.
Infections : Le taux global d’infections était de 76,2 pour 100 patients-années (IC 95 % : 74,9–77,4), les plus courantes étant :
- Infections urinaires (12,4 pour 100 patients-années)
- Rhinopharyngites (rhume, 13,4 pour 100 patients-années)
- Infections des voies respiratoires supérieures (9,7 pour 100 patients-années)
- Bronchites (3,2 pour 100 patients-années)
- Grippes (3,7 pour 100 patients-années)
Infections graves : Survenant à un taux de 2,01 pour 100 patients-années (IC 95 % : 1,81–2,23), les plus fréquentes étaient :
- Infections urinaires (0,30 pour 100 patients-années)
- Pneumonies (0,30 pour 100 patients-années)
- Cellulites (infections cutanées, 0,14 pour 100 patients-années)
Les infections graves à herpès virus étaient rares (0,03 pour 100 patients-années), et aucun cas de réactivation de l’hépatite B, cryptococcose, aspergillose, listériose, toxoplasmose ou infection à cytomégalovirus n’a été rapporté.
Tumeurs malignes : Le taux global était de 0,46 pour 100 patients-années (IC 95 % : 0,37–0,57). Ce chiffre reste cohérent avec les données épidémiologiques des populations SEP, suggérant que l’ocrelizumab n’augmente pas significativement le risque de cancer au-delà du risque attendu.
Modifications biologiques et surveillance
L’étude a suivi de près les paramètres biologiques pour évaluer l’impact de l’ocrelizumab sur le sang au fil du temps :
Numérations lymphocytaires : Le traitement a entraîné une baisse d’environ 15 % des lymphocytes totaux entre le baseline et la semaine 12, probablement due à la déplétion attendue des cellules B. Ces niveaux se sont ensuite stabilisés.
Cellules T : La cytométrie en flux a montré une diminution ≤6 % des cellules T CD3+ à la semaine 2, principalement due à une réduction des cellules T CD8+ plutôt que CD4+. Ces taux sont revenus progressivement aux valeurs initiales durant les extensions.
Neutrophiles : La plupart des patients maintenaient des taux normaux. La proportion avec neutropénie marquée (numération <1,5 × 10⁹/L) était de 4,4 % sous ocrelizumab contre 18,2 % sous interféron bêta-1a dans les essais SEP-RR.
Immunoglobulines : Des modifications notables des taux d’anticorps ont été observées :
- Les IgM ont diminué en moyenne de 55,8 % (baisse moyenne de 0,78 g/L)
- Les IgG ont baissé à un rythme moyen de 0,33 g/L par an (2,99 % par an)
- Les IgA ont présenté une diminution graduelle similaire
Malgré ces réductions, la proportion de patients avec des taux d’immunoglobulines sous la normale restait faible (7,7 % pour les IgG à la semaine 312 dans la population OPERA).
Expérience en vie réelle et données post-commercialisation
En date de juillet 2020, les données post-commercialisation de quelque 174 508 patients ayant initié un traitement par ocrelizumab dans le monde concordent avec les résultats des essais cliniques. Le taux de mortalité en vie réelle était légèrement plus élevé à 0,28 pour 100 patients-années (IC 95 % : 0,26–0,31) par rapport aux essais, ce qui est attendu compte tenu de la population moins sélectionnée en pratique courante.
Concernant la leucoencéphalopathie multifocale progressive (LEMP), infection cérébrale grave associée à certains immunosuppresseurs, aucun cas n’a été rapporté dans les essais cliniques jusqu’en juillet 2020. En revanche, 9 cas confirmés ont été signalés en dehors des essais, dont 8 étaient considérés comme des séquelles de traitements immunosuppresseurs antérieurs.
Cela suggère un faible risque de LEMP sous ocrelizumab, particulièrement chez les patients naïfs de thérapies hautement immunosuppressives.
Conclusions et implications cliniques
Cette analyse de sécurité sur 7 ans apporte des données rassurantes pour les patients sous ocrelizumab ou l’envisageant. Elle démontre qu’un traitement continu pendant jusqu’à 7 ans dans les essais, complété par plus de 3 ans d’usage en vie réelle, maintient un profil de sécurité favorable et gérable.
Aucun nouveau signal de sécurité n’est apparu avec la durée de traitement, ce qui est particulièrement important pour une maladie chronique comme la SEP nécessitant un traitement au long cours. Les taux d’infections graves et de tumeurs malignes restent conformes aux attentes pour la population SEP, indiquant que l’ocrelizumab n’augmente pas significativement ces risques.
La baisse graduelle des immunoglobulines justifie une surveillance continue, mais sa signification clinique nécessite des investigations supplémentaires, car elle ne s’est pas accompagnée d’une augmentation correspondante des infections graves.
Limites de l’étude
Malgré son ampleur, cette étude présente plusieurs limites. L’utilisation de données d’extension en ouvert et de contrôles historiques relève d’une preuve de classe III, moins robuste que celle d’essais randomisés contrôlés.
La population des essais peut ne pas refléter intégralement celle rencontrée en pratique, les essais excluant souvent les patients avec comorbidités ou maladie avancée. Les données post-commercialisation aident à pallier cette limite mais posent des défis de cohérence et d’exhaustivité.
Enfin, bien que 7 ans constituent un suivi substantiel, des données à plus long terme sont nécessaires pour évaluer la sécurité sur des décennies, notamment pour les patients jeunes traités pendant de nombreuses années.
Recommandations aux patients
Sur la base de cette analyse, les patients sous ocrelizumab peuvent être rassurés quant à son profil de sécurité à long terme. Plusieurs recommandations importantes émergent :
- Poursuivre la surveillance régulière : Des bilans sanguins réguliers pour suivre les lymphocytes, neutrophiles et immunoglobulines restent essentiels tout au long du traitement.
- Signaler rapidement les infections : Les patients doivent signaler sans délai tout signe infectieux à leur médecin, compte tenu du risque modéré d’infections graves.
- Respecter la prémédication avant perfusion : La baisse des réactions perfusionnelles avec le temps justifie de maintenir le schéma standard de prémédication avant chaque administration.
- Maintenir les dépistages oncologiques de routine : Le taux de cancers étant conforme à celui attendu dans la SEP, les dépistages adaptés à l’âge restent indiqués, indépendamment du traitement.
- Discuter des préoccupations avec votre neurologue : Toute inquiétude concernant le traitement à long terme doit être abordée avec l’équipe soignante pour équilibrer bénéfices et risques.
Cette recherche confirme que l’ocrelizumab demeure une option thérapeutique majeure pour la SEP récurrente et progressive, avec un profil de sécurité à long terme constant.
Informations sur la source
Titre original de l’article : Safety of Ocrelizumab in Patients With Relapsing and Primary Progressive Multiple Sclerosis
Auteurs : Stephen L. Hauser, MD, Ludwig Kappos, MD, Xavier Montalban, MD, PhD, MBA, Licinio Craveiro, MD, PhD, Cathy Chognot, PhD, Richard Hughes, MD, Harold Koendgen, MD, PhD, Noemi Pasquarelli, PhD, MSc, Ashish Pradhan, MD, Kalpesh Prajapati, MSc, MPhil, et Jerry S. Wolinsky, MD
Publication : Neurology 2021;97:e1546–e1559. doi:10.1212/WNL.0000000000012700
Note : Cet article vulgarisé s’appuie sur une recherche évaluée par des pairs et vise à restituer fidèlement les résultats de l’étude originale tout en les rendant accessibles au grand public.