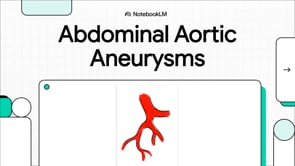Cette étude de suivi sur 10 ans de l’ocrelizumab (Ocrevus) dans la sclérose en plaques récurrente-rémittente confirme un profil de sécurité à long terme excellent et une efficacité durable. Les patients ont maintenu une faible activité de la maladie, avec des taux annuels de poussée inférieurs à 0,2 et une progression minime du handicap sur l’ensemble de la décennie d’observation. Il est à noter qu’aucun nouveau signal de sécurité n’est apparu, et aucun rebond de la maladie n’a été observé, y compris après des interruptions de traitement allant jusqu’à près de deux ans dans certains cas.
L’ocrelizumab démontre des bénéfices durables sur plus de 10 ans dans la sclérose en plaques récurrente-rémittente
Table des matières
- Introduction : l’importance de cette étude
- Méthodologie : déroulement de l’étude
- Sécurité : effets indésirables et risques
- Efficacité : performance de l’ocrelizumab
- Suivi des lymphocytes B : évolution immunitaire
- Implications cliniques : ce que cela signifie pour les patients
- Limites : ce que l’étude ne montre pas
- Recommandations : conseils pratiques
- Source
Introduction : l’importance de cette étude
La sclérose en plaques est une maladie chronique qui exige des stratégies thérapeutiques sur le long terme. L’ocrelizumab (commercialisé sous le nom d’Ocrevus) est approuvé pour les formes récurrentes et primairement progressives de la SEP. Cet anticorps monoclonal cible les lymphocytes B exprimant CD20, des cellules immunitaires impliquées dans l’inflammation caractéristique de la maladie.
Si des études antérieures avaient déjà démontré son efficacité à court terme, cette recherche présente le suivi le plus long jamais réalisé — plus de dix ans, de 2008 à 2020. Comprendre la sécurité et l’efficacité au long cours est essentiel, car les personnes atteintes de SEP peuvent avoir besoin d’un traitement pendant des décennies. Patients et médecins doivent savoir à quoi s’attendre avec une thérapie prolongée.
L’étude s’intéresse notamment aux conséquences de l’interruption du traitement, une situation courante en pratique clinique. Elle renseigne aussi sur le délai de reprise de l’activité de la SEP après l’arrêt du médicament et sur l’existence éventuelle d’un rebond — une aggravation de la maladie au-delà de son niveau initial.
Méthodologie : déroulement de l’étude
Cette étude internationale a inclus 220 participants atteints de SEP récurrente-rémittente, recrutés dans 79 centres répartis dans 20 pays. Pour être éligibles, les patients devaient avoir entre 18 et 55 ans, un diagnostic confirmé de SEP RR, au moins deux poussées dans les trois années précédentes (dont une dans l’année écoulée), et un score EDSS compris entre 1 et 6.
L’étude s’est déroulée en quatre phases sur plus de dix ans. La période initiale de traitement de 96 semaines a réparti les patients en quatre groupes : ocrelizumab 2000 mg, ocrelizumab 600 mg, placebo, ou interféron bêta-1a. Après le premier cycle de 24 semaines, tous ont reçu de l’ocrelizumab pour les trois cycles suivants.
Après cette phase, les participants sont entrés dans une période sans traitement, comprenant une phase évaluée (surveillance toutes les 12 semaines jusqu’à normalisation des lymphocytes B) et une phase non évaluée. Finalement, 103 patients ont intégré la phase d’extension en ouvert, recevant tous de l’ocrelizumab 600 mg toutes les 24 semaines.
Les critères d’évaluation comprenaient :
- Activité à l’IRM (lésions rehaussées par le gadolinium et nouvelles lésions T2)
- Taux annuel de poussées
- Progression du handicap mesurée par l’EDSS
- Surveillance des événements indésirables et effets secondaires graves
- Numération des lymphocytes B et marqueurs immunitaires
Sécurité : effets indésirables et risques
Les données recueillies sur plus de dix ans sont rassurantes pour les patients envisageant un traitement prolongé par ocrelizumab. Les effets indésirables les plus fréquents étaient les réactions liées à la perfusion, les infections, les céphalées et les dorsalgies.
Pendant la phase initiale, les taux d’événements indésirables ajustés à l’exposition étaient comparables entre les groupes. Le taux global était de 401,1 pour 100 patients-années sous ocrelizumab contre 375,3 sous interféron. Les événements graves survenaient à un taux de 24,6 pour 100 patients-années avec l’ocrelizumab, contre 33,8 avec l’interféron.
Les réactions de perfusion étaient plus fréquentes lors de la première administration (25 à 35 % des patients), mais devenaient rares après la quatrième. Aucun cas de leucoencéphalopathie multifocale progressive (LEMP) n’a été rapporté.
Les taux d’infection étaient légèrement plus élevés pendant les phases de traitement, comme attendu avec une thérapie immunomodulatrice. Les infections graves sont restées peu fréquentes (1,5 à 5,5 événements pour 100 patients-années sous ocrelizumab).
Deux décès sont survenus durant l’étude. L’un pendant la période sans traitement, suite à un syndrome de réponse inflammatoire systémique chez un patient précédemment traité par ocrelizumab. L’autre dans le groupe interféron pendant la phase initiale.
Efficacité : performance de l’ocrelizumab
Les résultats montrent un contrôle remarquable de l’activité de la SEP sur le long terme. Pendant la phase d’extension (suivi médian de 6,5 ans), les patients ont maintenu un excellent contrôle de la maladie.
Le taux annuel de poussées est resté très bas, à 0,15, ce qui correspond en moyenne à une poussée tous les 6-7 ans sous traitement.
La progression du handicap était également bien maîtrisée. Le pourcentage de patients avec une progression confirmée (maintenue sur 24 semaines) est resté faible tout au long de l’étude, y compris pendant la période sans traitement.
L’IRM a montré un contrôle exceptionnel de la maladie. Le nombre de lésions rehaussées par le gadolinium (indiquant une inflammation active) était réduit de 89 à 96 % par rapport au placebo pendant la phase initiale. Cette suppression a été maintenue durant l’extension.
Fait important, à l’arrêt du traitement, aucun rebond de la maladie n’a été observé. Les premiers signes d’activité à l’IRM sont réapparus 24 semaines après la dernière dose, et seulement 16,3 % des patients ont présenté une activité IRM pendant la période sans traitement évaluée.
Suivi des lymphocytes B : évolution immunitaire
L’ocrelizumab agit en éliminant les lymphocytes B CD20+, et cette étude renseigne sur la durée de cet effet et la vitesse de reconstitution après l’arrêt.
Les lymphocytes B CD19+ ont diminué rapidement après l’initiation du traitement et sont restés majoritairement indétectables pendant les phases sous traitement. Ils se sont reconstitués progressivement pendant la période sans traitement.
La reconstitution était plus lente chez les patients initialement sous ocrelizumab que sous placebo ou interféron. Le temps médian pour atteindre 80 cellules/µL était plus long dans les groupes ocrelizumab.
Au début de la phase d’extension, la numération médiane des lymphocytes B CD19+ était de 204,0 cellules/µL (intervalle : 6,0–646,0), indiquant une reconstitution substantielle. Les lymphocytes B mémoire (CD19+ CD38lo CD27+) se sont aussi reconstitués, mais dans une moindre mesure (médiane de 5,0 cellules/µL).
Lors de la reprise de l’ocrelizumab, les numérations lymphocytaires B sont de nouveau descendues sous le seuil de détection, confirmant l’effet durable du traitement sur ses cellules cibles.
Implications cliniques : ce que cela signifie pour les patients
Cette étude à long terme apporte des informations précieuses pour les patients sous ocrelizumab ou l’envisageant. Les données montrent que le médicament conserve son efficacité pendant de nombreuses années sans perte de bénéfice.
Pour ceux qui doivent interrompre temporairement le traitement (grossesse, chirurgie, etc.), les résultats sont rassurants : la maladie ne reprend pas immédiatement et aucun rebond n’a été observé.
Le profil de sécurité est resté stable dans le temps, sans nouveaux risques identifiés avec l’usage prolongé. Les effets indésirables les plus fréquents (réactions de perfusion) diminuent après les premières administrations.
Le suivi des lymphocytes B aide à comprendre les mécanismes immunitaires : leur lente reconstitution explique pourquoi la protection persiste plusieurs mois après la dernière perfusion.
Limites : ce que l’étude ne montre pas
Malgré sa valeur, cette présente certaines limites. La phase d’extension en ouvert n’était ni randomisée ni contrôlée ; tous les participants recevaient de l’ocrelizumab, ce qui empêche toute comparaison avec d’autres traitements ou l’absence de traitement.
Le nombre de patients a diminué au fil du temps, comme souvent dans les études longues. Seuls 103 des 220 patients initiaux sont entrés dans l’extension, et 86 étaient encore sous traitement au point final. Cette attrition peut limiter la représentativité des résultats.
La population était relativement homogène (SEP RR active au départ) ; les conclusions peuvent ne pas s’appliquer aux formes moins actives ou à d’autres sous-types.
Les comparaisons statistiques n’étaient pas prévues pour détecter des différences entre groupes ; les écarts numériques non testés doivent être interprétés avec prudence.
Recommandations : conseils pratiques
Sur la base de ces résultats, les patients sous ocrelizumab ou l’envisageant devraient :
- Discuter d’un plan de traitement à long terme avec leur neurologue, cette étude confirmant la sécurité et l’efficacité prolongées de l’ocrelizumab.
- Savoir que les réactions de perfusion sont plus fréquentes lors de la première administration et diminuent ensuite.
- Comprendre qu’en cas d’interruption, la protection peut persister plusieurs mois grâce à la lente reconstitution des lymphocytes B.
- Maintenir une surveillance régulière selon les recommandations de l’équipe soignante, incluant bilans sanguins et vigilance face aux infections.
- Signaler tout nouveau symptôme, notamment infectieux, comme avec toute thérapie immunomodulatrice.
Cette recherche confirme que l’ocrelizumab représente une option thérapeutique à long terme pour la SEP RR, avec des bénéfices durables et un profil de sécurité stable. Les décisions doivent toutefois être prises individuellement, en concertation avec le professionnel de santé.
Source
Titre de l’article : Ocrelizumab exposure in relapsing–remitting multiple sclerosis: 10-year analysis of the phase 2 randomized clinical trial and its extension
Auteurs : Ludwig Kappos, Anthony Traboulsee, David K. B. Li, Amit Bar-Or, Frederik Barkhof, Xavier Montalban, David Leppert, Anna Baldinotti, Hans-Martin Schneble, Harold Koendgen, Annette Sauter, Qing Wang, Stephen L. Hauser
Publication : Journal of Neurology (2023) 271:642–657
Note : Cet article à destination des patients s’appuie sur une recherche évaluée par des pairs initialement publiée dans le Journal of Neurology. Il vise à rendre accessibles les résultats scientifiques tout en conservant l’intégralité des données et informations essentielles de l’étude originale.