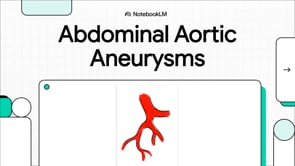Cette étude de cinq ans démontre que l'ocrelizumab offre des bénéfices durables aux patients atteints de sclérose en plaques récurrente. Les patients ayant débuté le traitement plus tôt ont présenté une progression du handicap réduite de 31 % et une quasi-élimination des lésions cérébrales, comparés à ceux passés d’un interféron. Le traitement a conservé un profil de sécurité favorable, sans nouveau signal détecté lors d’une utilisation prolongée.
Cinq années de traitement par ocrelizumab dans la sclérose en plaques récurrente : bénéfices à long terme et profil de sécurité
Table des matières
- Introduction : pertinence de cette recherche
- Conception et méthodologie de l'étude
- Caractéristiques et participation des patients
- Résultats cliniques : taux de poussées et handicap
- Résultats IRM : activité lésionnelle cérébrale et évolution volumétrique
- Profil de sécurité sur 5 ans
- Implications pour les patients
- Limites de l'étude
- Recommandations pour les patients
- Informations sur la source
Introduction : pertinence de cette recherche
La sclérose en plaques (SEP) est une maladie neurologique chronique dans laquelle le système immunitaire attaque la gaine protectrice des fibres nerveuses. La forme récurrente (SEP-R) se caractérise par des poussées de symptômes suivies de phases de rémission. L'ocrelizumab est un traitement ciblé qui élimine spécifiquement les lymphocytes B, des cellules immunitaires impliquées dans la progression de la SEP.
Cette étude a suivi des patients pendant cinq ans pour évaluer les bénéfices à long terme et la sécurité du traitement par ocrelizumab. Elle a comparé les patients ayant débuté l'ocrelizumab précocement à ceux ayant changé après deux ans d'un traitement par interféron. Comprendre les résultats à long terme est crucial pour les patients qui doivent choisir un traitement susceptible d'influencer leur qualité de vie pour les années à venir.
Conception et méthodologie de l'étude
L'étude a combiné les données de deux essais cliniques de phase III identiques, OPERA I et OPERA II. Il s'agissait d'études randomisées en double aveugle, ce qui signifie que ni les patients ni les chercheurs ne connaissaient l'attribution thérapeutique durant la phase initiale. Après la période contrôlée de 2 ans, les patients sont entrés dans une extension en ouvert de 3 ans où tous ont reçu de l'ocrelizumab.
Les patients ont reçu soit de l'ocrelizumab (perfusions de 600 mg toutes les 24 semaines) soit de l'interféron bêta-1a (44 μg trois fois par semaine) durant les deux premières années. Ceux passant de l'interféron à l'ocrelizumab au début de la phase d'extension ont reçu leur première dose sous forme de deux perfusions de 300 mg à deux semaines d'intervalle. Les chercheurs ont suivi plusieurs critères, notamment :
- Taux annuel de poussées
- Progression du handicap confirmée sur 24 semaines
- Amélioration du handicap confirmée sur 24 semaines
- Activité IRM cérébrale (nouvelles lésions et lésions rehaussées)
- Évolution du volume cérébral
- Mesures de sécurité et événements indésirables
L'étude a inclus initialement 1 656 patients, dont 1 325 ont poursuivi dans la phase d'extension. La date de point pour cette analyse était le 5 février 2018, fournissant jusqu'à 5 ans de données de suivi.
Caractéristiques et participation des patients
Les participants étaient bien équilibrés entre les groupes de traitement. L'âge moyen était d'environ 37 ans, avec environ 66 % de femmes. Le score moyen à l'échelle EDSS (Expanded Disability Status Scale) était de 2,8 au départ, indiquant un handicap léger à modéré.
Sur les 827 patients initialement traités par ocrelizumab, 702 (84,9 %) sont entrés dans la phase d'extension et 623 (75,3 %) ont terminé la 5e année. Sur les 829 patients initialement traités par interféron bêta-1a, 623 (75,2 %) sont entrés dans la phase d'extension et 551 (66,5 %) ont terminé la 5e année. Globalement, 88,6 % des patients entrés en extension ont complété la 5e année, représentant 71 % de la population initialement incluse.
Les patients ont reçu en moyenne 7,3 à 7,4 doses d'ocrelizumab durant la phase d'extension, sans différence significative entre ceux poursuivant l'ocrelizumab et ceux passant de l'interféron.
Résultats cliniques : taux de poussées et handicap
Les patients ayant continué l'ocrelizumab ont maintenu des taux de poussées bas tout au long des 5 années. Le taux annuel de poussées est resté constamment faible :
- Année 1 : 0,14 poussées par an
- Année 2 : 0,13 poussées par an
- Année 3 : 0,10 poussées par an
- Année 4 : 0,08 poussées par an
- Année 5 : 0,07 poussées par an
Les patients passant de l'interféron à l'ocrelizumab ont présenté une réduction significative de 52 % du taux de poussées (de 0,20 en année 2 à 0,10 en année 3), maintenue aux années 4 et 5 (0,08 et 0,07 respectivement). Durant la phase d'extension, aucune différence de taux de poussées n'a été observée entre les deux groupes.
La proportion cumulative de patients avec une progression du handicap confirmée à 24 semaines était significativement plus faible dans le groupe ocrelizumab continu à plusieurs moments :
- Année 2 : 7,7 % vs 12,0 % (p=0,005)
- Année 3 : 10,1 % vs 15,6 % (p=0,002)
- Année 4 : 13,9 % vs 18,1 % (p=0,03)
- Année 5 : 16,1 % vs 21,3 % (p=0,014)
Cela représente une réduction relative de 31 % de la progression du handicap à la 5e année pour les patients ayant débuté l'ocrelizumab plus tôt. Le hazard ratio pour la progression durant la phase initiale était de 0,60 (IC 95 % 0,43-0,84, p=0,003), indiquant un risque de progression réduit de 40 % avec l'ocrelizumab.
Concernant l'amélioration du handicap, les patients sous ocrelizumab continu ont montré des taux d'amélioration numériquement plus élevés à tous les moments, atteignant une significativité statistique à la 5e année (25,8 % vs 20,6 %, p=0,046).
Résultats IRM : activité lésionnelle cérébrale et évolution volumétrique
Les résultats IRM ont montré des différences marquées dans l'activité maladie. Les patients sous ocrelizumab continu ont maintenu une suppression quasi-complète des nouvelles lésions cérébrales sur les 5 années :
Lésions prenant le gadolinium (indiquant une inflammation active) : - Année 2 : 0,017 lésions par examen - Année 3 : 0,005 lésions par examen - Année 4 : 0,017 lésions par examen - Année 5 : 0,006 lésions par examen
Nouvelles lésions T2 ou lésions T2 augmentant de taille (indiquant une nouvelle activité maladie) : - Année 2 : 0,063 lésions par examen - Année 3 : 0,091 lésions par examen - Année 4 : 0,080 lésions par examen - Année 5 : 0,031 lésions par examen
Les patients passant de l'interféron à l'ocrelizumab ont montré une suppression presque complète de l'activité IRM après le changement : - Les lésions prenant le gadolinium sont passées de 0,491 en année 2 à 0,007 en année 3 - Les nouvelles lésions T2 sont passées de 2,583 en année 2 à 0,371 en année 3
L'évolution du volume cérébral a montré des bénéfices significatifs pour le traitement continu par ocrelizumab. À la 5e année, les patients traités continuellement par ocrelizumab ont présenté une perte de volume cérébral significativement moindre comparés à ceux passant de l'interféron : - Volume cérébral total : -1,87 % vs -2,15 % (p<0,01) - Volume de matière grise : -2,02 % vs -2,25 % (p<0,01) - Volume de matière blanche : -1,33 % vs -1,62 % (p<0,01)
La proportion de patients avec aucune évidence d'activité maladie (NEDA - aucune poussée, progression du handicap, ou nouvelle lésion IRM) était significativement plus élevée dans le groupe ocrelizumab continu, à la fois durant la phase initiale (48,5 % vs 27,8 %, p<0,001) et sur l'ensemble des 5 années (35,7 % vs 19,0 %, p<0,001).
Profil de sécurité sur 5 ans
L'analyse de sécurité a inclus tous les patients traités par ocrelizumab sur les 5 années. L'incidence globale des événements indésirables était cohérente avec les rapports précédents, et aucun nouveau signal de sécurité n'est apparu avec le traitement prolongé.
Les événements indésirables les plus fréquents incluaient : - Infections des voies respiratoires supérieures : 47,0 événements pour 100 patients-années - Infections urinaires : 16,7 événements pour 100 patients-années - Rhinopharyngites : 15,5 événements pour 100 patients-années - Céphalées : 14,5 événements pour 100 patients-années
Les événements indésirables graves sont survenus à un taux de 10,2 événements pour 100 patients-années. Les événements graves les plus fréquents étaient : - Infections : 2,6 événements pour 100 patients-années - Troubles du système nerveux : 1,4 événements pour 100 patients-années - Néoplasmes : 0,8 événements pour 100 patients-années
Douze décès sont survenus durant l'étude (0,5 événements pour 100 patients-années), aucun n'étant considéré comme lié à l'ocrelizumab par les investigateurs. L'incidence des infections graves était de 2,6 événements pour 100 patients-années, et l'incidence des tumeurs malignes de 0,8 événements pour 100 patients-années.
Implications pour les patients
Cette étude de 5 ans apporte des preuves solides qu'un traitement précoce et continu par ocrelizumab procure des bénéfices durables aux patients atteints de SEP récurrente. Les données montrent que débuter l'ocrelizumab plus tôt conduit à de meilleurs résultats à long terme comparé à un début par interféron avec changement ultérieur.
Les patients ayant débuté l'ocrelizumab plus tôt ont présenté significativement moins de progression du handicap sur 5 ans (16,1 % vs 21,3 %), représentant une réduction relative de 31 %. Ils ont également maintenu une suppression quasi-complète des nouvelles lésions cérébrales et présenté une moindre perte de volume cérébral, ce qui est important puisque l'atrophie cérébrale est corrélée au handicap à long terme dans la SEP.
Le profil de sécurité est resté constant sur 5 ans, sans nouvelle préoccupation de sécurité émergente. Ceci est particulièrement important pour les patients envisageant des options de traitement à long terme.
Limites de l'étude
Bien que cette étude fournisse des données long terme précieuses, elle présente plusieurs limites. L'étude est classée comme preuve de Classe III car la randomisation initiale a été divulguée après l'entrée des patients en extension, ce qui pourrait potentiellement introduire un biais.
La phase d'extension était en ouvert, signifiant que patients et médecins savaient qu'ils recevaient de l'ocrelizumab, ce qui pourrait influencer le signalement des résultats. De plus, les patients ayant arrêté le traitement n'ont pas été inclus dans les analyses ultérieures, ce qui pourrait affecter les résultats si ceux ayant arrêté avaient eu des évolutions différentes.
L'étude a comparé l'ocrelizumab à l'interféron bêta-1a, qui n'est pas le traitement le plus puissant disponible aujourd'hui. Des comparaisons avec d'autres thérapies hautement efficaces seraient précieuses pour de futures recherches.
Recommandations pour les patients
Sur la base de cette recherche, les patients atteints de SEP récurrente devraient considérer :
- Discuter un traitement précoce par thérapies hautement efficaces comme l'ocrelizumab avec leur neurologue, car une intervention plus précoce semble procurer de meilleurs résultats à long terme
- Comprendre les bénéfices à long terme d'un traitement continu, incluant une réduction de la progression du handicap et moins de nouvelles lésions cérébrales
- Être informés du profil de sécurité et surveiller les infections sous traitement
- Maintenir un suivi régulier avec leur équipe soignante pour surveiller la réponse au traitement et tout effet secondaire potentiel
- Envisager de participer à des essais cliniques pour aider à faire progresser la compréhension des traitements long terme de la SEP
Les patients devraient avoir des discussions ouvertes avec leurs professionnels de santé concernant les options thérapeutiques, en considérant à la fois les bénéfices potentiels et les risques des différents traitements.
Informations sur la source
Titre original de l'article : Five years of ocrelizumab in relapsing multiple sclerosis: OPERA studies open-label extension
Auteurs : Stephen L. Hauser, MD, Ludwig Kappos, MD, Douglas L. Arnold, MD, Amit Bar-Or, MD, Bruno Brochet, MD, Robert T. Naismith, MD, Anthony Traboulsee, MD, Jerry S. Wolinsky, MD, Shibeshih Belachew, MD, PhD, Harold Koendgen, MD, PhD, Victoria Levesque, PhD, Marianna Manfrini, MD, Fabian Model, PhD, Stanislas Hubeaux, MSc, Lahar Mehta, MD, et Xavier Montalban, MD, PhD
Publication : Neurology 2020;95:e1854-e1867. doi:10.1212/WNL.0000000000010376
Identifiants d'essai clinique : NCT01247324/NCT01412333
Cet article destiné aux patients s'appuie sur une recherche évaluée par des pairs publiée dans Neurology, la revue officielle de l'American Academy of Neurology.