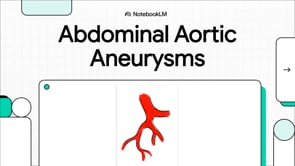Cette étude comparative a évalué deux thérapies de déplétion des lymphocytes B dans le traitement de la sclérose en plaques récurrente-rémittente (SEP-RR). Elle a montré que le rituximab était moins efficace que l’ocrelizumab pour prévenir les poussées. Les patients sous rituximab ont présenté un taux de poussées presque deux fois plus élevé (0,20 contre 0,09 pour le taux annualisé) et un risque de poussée 2,1 fois supérieur à celui des patients sous ocrelizumab. En revanche, les deux traitements ont démontré une efficacité comparable pour freiner la progression du handicap. Ces résultats soulignent l’importance d’un dialogue personnalisé avec votre neurologue pour choisir la meilleure option thérapeutique.
Rituximab et ocrelizumab dans la sclérose en plaques récurrente-rémittente : ce que les patients doivent savoir
Table des matières
- Introduction : Comprendre les thérapies ciblant les lymphocytes B dans la SEP
- Méthodologie de l’étude
- Profil des patients
- Principaux résultats : poussées et évolution du handicap
- Observance thérapeutique et arrêts de traitement
- Implications cliniques pour les patients
- Limites de l’étude
- Conseils aux patients
- Source
Introduction : Comprendre les thérapies ciblant les lymphocytes B dans la SEP
La sclérose en plaques (SEP) est une maladie auto-immune dans laquelle le système immunitaire attaque la gaine protectrice des nerfs. Les traitements qui ciblent les lymphocytes B représentent une avancée majeure, car ils agissent spécifiquement sur les cellules immunitaires impliquées dans la maladie. L’ocrelizumab (Ocrevus) a été le premier médicament anti-lymphocytes B approuvé pour la SEP récurrente-rémittente (SEP-RR), après avoir démontré une réduction de 46 % des poussées et de 40 % de la progression du handicap par rapport à l’interféron dans les essais cliniques.
Le rituximab (Rituxan), bien qu’approuvé pour d’autres affections comme certains cancers et la polyarthrite rhumatoïde, est souvent utilisé hors AMM dans la SEP. Bien que ces deux médicaments ciblent la même protéine (CD20) à la surface des lymphocytes B, ils présentent des différences notables. L’ocrelizumab est un anticorps « humanisé », conçu pour réduire le risque de réactions immunitaires, tandis que le rituximab est « chimérique » et comporte des éléments murins.
Cette étude répond à une question cruciale pour les patients et les cliniciens : le rituximab est-il aussi efficace que l’ocrelizumab pour contrôler la SEP ? La réponse a des implications importantes pour le choix thérapeutique, la prise en charge financière et le devenir des patients.
Méthodologie de l’étude
Les chercheurs ont mené une vaste étude observationnelle à partir de deux registres majeurs de SEP : le registre international MSBase et le registre danois de la sclérose en plaques. La période d’étude s’étendait de janvier 2015 à mars 2021 et incluait les patients traités par ocrelizumab ou rituximab.
Pour garantir des comparaisons équitables, les chercheurs ont apparié les patients selon des caractéristiques similaires à l’aide de méthodes statistiques avancées :
- Au moins 6 mois de traitement et de suivi
- Bilan initial détaillé incluant le score de handicap (échelle EDSS)
- Antécédents de poussées et de traitements antérieurs
- Résultats d’IRM, dont la charge lésionnelle
- Âge, sexe et ancienneté de la maladie
L’objectif principal était de vérifier si le rituximab était « non inférieur » à l’ocrelizumab — c’est-à-dire au moins aussi efficace. Les chercheurs ont défini une marge : si le taux de poussées sous rituximab ne dépassait pas 1,63 fois celui sous ocrelizumab, il serait considéré comme non inférieur.
Les protocoles reflétaient la pratique courante : l’ocrelizumab était généralement administré à raison de 300 mg à deux semaines d’intervalle, puis 600 mg tous les six mois. Le rituximab était le plus souvent donné à raison de 1000 mg à deux semaines d’intervalle, puis 500 à 1000 mg tous les six mois, bien que les dosages aient varié selon les centres.
Profil des patients
Sur 6 027 patients initialement traités par l’un des deux médicaments, 1 613 répondaient aux critères d’inclusion. La population étudiée présentait les caractéristiques suivantes :
- Âge moyen : 42,0 ans (±10,8 ans)
- Répartition par sexe : 68 % de femmes (1 089), 32 % d’hommes (524)
- Origine : 898 patients du registre MSBase, 715 du registre danois
Après appariement, l’analyse finale portait sur 710 patients sous ocrelizumab et 186 sous rituximab. Avant appariement, les patients sous rituximab avaient tendance à présenter une maladie plus sévère :
- Score EDSS plus élevé (moyenne 3,5 vs 3,0)
- Davantage de poussées dans l’année précédente (0,7 vs 0,5)
- Plus d’IRM actives (41 % vs 32 % avec prise de contraste)
- Plus de traitements antérieurs (médiane 2,0 dans les deux groupes, mais avec des distributions différentes)
L’appariement a permis de corriger ces différences, formant des groupes comparables avec un suivi moyen de 1,4 an (±0,7 an).
Principaux résultats : poussées et évolution du handicap
L’étude a mis en évidence des différences significatives dans la prévention des poussées :
Taux annuel de poussées (TAP) : Les patients sous rituximab ont eu presque deux fois plus de poussées : • TAP sous rituximab : 0,20 (±0,49) • TAP sous ocrelizumab : 0,09 (±0,28) • La différence était statistiquement significative (p < 0,001)
Comparaison du risque de poussées : Le ratio de taux était de 1,8 (IC 95 % : 1,4–2,4), ce qui signifie que le risque de poussées était 1,8 fois plus élevé sous rituximab. La borne supérieure de l’intervalle de confiance (2,4) dépassant la marge de non-infériorité fixée à 1,63, le rituximab n’a pas été jugé non inférieur.
Risque cumulé de poussées : Le risque de poussées dans le temps était 2,1 fois plus élevé sous rituximab (Hazard Ratio : 2,1 ; IC 95 % : 1,5–3,0). Ainsi, à tout moment de l’étude, les patients sous rituximab avaient plus du double de risque de faire une poussée.
Évolution du handicap : Malgré la différence sur les poussées, les deux traitements ont montré une efficacité comparable pour prévenir la progression du handicap : • Aggravation du handicap : Hazard Ratio 1,51 (IC 95 % : 0,86–2,64) — non significatif • Amélioration du handicap : Hazard Ratio 0,80 (IC 95 % : 0,49–1,31) — non significatif
Cela suggère que, même s’il prévient moins bien les poussées, le rituximab protège aussi bien contre l’aggravation du handicap à long terme.
Observance thérapeutique et arrêts de traitement
L’étude a également examiné la durée des traitements :
Les patients étaient significativement plus nombreux à arrêter le rituximab que l’ocrelizumab (Hazard Ratio : 3,11 ; IC 95 % : 2,36–4,11). Le risque d’arrêt était donc plus de trois fois plus élevé sous rituximab.
Les motifs d’arrêt (documentés pour 66 % des arrêts sous ocrelizumab et 49 % sous rituximab) révélaient :
- Principales raisons d’arrêt du rituximab : décision du patient ou du clinicien (33 %) et autres raisons/inconnues (48 %)
- 69 % des patients ayant arrêté le rituximab sont passés à l’ocrelizumab
- Peu d’arrêts pour intolérance : 16 sous ocrelizumab, 9 sous rituximab
Le passage fréquent du rituximab à l’ocrelizumab reflète probablement l’approbation de ce dernier pendant la période d’étude, le rendant plus accessible et souvent préféré.
Implications cliniques pour les patients
Ces résultats ont des conséquences importantes pour les choix thérapeutiques :
Pour les patients qui envisagent un traitement anti-lymphocytes B, cette étude suggère que l’ocrelizumab pourrait mieux prévenir les poussées que le rituximab. Un taux de poussées presque doublé sous rituximab est une différence cliniquement pertinente, susceptible d’affecter la qualité de vie.
Néanmoins, la protection contre la progression du handicap étant similaire, les deux médicaments restent intéressants sur le long terme. Prévenir l’aggravation du handicap est en effet l’objectif principal du traitement de la SEP.
Le taux d’arrêt plus élevé sous rituximab peut s’expliquer par des facteurs variés : évolution de la couverture maladie, préférence des cliniciens après l’arrivée de l’ocrelizumab, ou perception d’une efficacité différente. La tolérance, elle, semble comparable.
Les patients devraient discuter de ces éléments avec leur neurologue, en tenant compte de leur situation personnelle, de leurs antécédents thérapeutiques et de leurs préférences. Le choix entre ces traitements dépend de l’efficacité, de la tolérance, du coût, de la prise en charge et des contraintes pratiques.
Limites de l’étude
Bien que cette étude apporte des données précieuses en vie réelle, plusieurs limites sont à considérer :
Il s’agit d’une étude observationnelle, et non d’un essai randomisé. Les traitements étaient choisis par les médecins, et non attribués au hasard. Malgré l’appariement statistique, des facteurs non mesurés ont pu influencer les résultats.
La durée moyenne de suivi (1,4 an) est relativement courte pour évaluer l’évolution de la SEP. Des données à plus long terme pourraient révéler des différences dans la progression du handicap ou la sécurité.
La posologie du rituximab variait selon les centres (500–1000 mg tous les 6 mois), contrairement à celle de l’ocrelizumab, plus standardisée. Cette variabilité a pu jouer un rôle, même si une analyse de sensibilité a confirmé les résultats principaux.
L’étude n’a pas pu comparer finement les effets indésirables, les registres contenant peu de données sur ce point. La sécurité reste pourtant un élément clé du choix thérapeutique.
Enfin, le passage fréquent du rituximab à l’ocrelizumab a pu biaiser certains résultats, notamment ceux concernant l’observance.
Conseils aux patients
Au vu de ces résultats, les patients atteints de SEP-RR peuvent tenir compte des éléments suivants :
- Discutez des options avec votre neurologue : Parlez des avantages et des limites de l’ocrelizumab et du rituximab dans votre cas.
- Priorisez la prévention des poussées : Si éviter les poussées est essentiel pour vous, l’ocrelizumab pourrait être préférable.
- Évaluez la protection contre le handicap : Les deux traitements protègent aussi bien contre l’aggravation du handicap, objectif central à long terme.
- Prenez en compte les aspects pratiques : Couverture maladie, coûts, disponibilité des perfusions et rythme des administrations peuvent influencer votre décision.
- Restez informé : Des essais comparant directement ces médicaments sont en cours ; leurs résultats apporteront peut-être des réponses plus définitives.
- Surveillez votre réponse au traitement : Quel que soit le choix, un suivi régulier par examen clinique et IRM est indispensable.
Rappelez-vous que le traitement doit être personnalisé en fonction de votre maladie, de vos antécédents, de votre mode de vie et de vos préférences. Cette étude est une pièce importante, mais non unique, du puzzle décisionnel.
Source
Titre de l’article : Rituximab vs Ocrelizumab in Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis
Auteurs : Izanne Roos, MBChB, PhD ; Stella Hughes, MD ; Gavin McDonnell, MD, PhD ; et al
Revue : JAMA Neurology
Date de publication : 12 juin 2023 (en ligne) ; août 2023 (imprimé)
Volume et numéro : Vol. 80, n° 8
Pages : 789–797
DOI : 10.1001/jamaneurol.2023.1625
Cet article de vulgarisation s’appuie sur une étude parue dans JAMA Neurology. Il en restitue les conclusions, statistiques et détails méthodologiques essentiels, dans un langage accessible aux patients et à leurs proches.