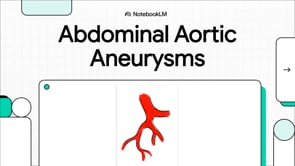Cette étude exhaustive a comparé en conditions réelles deux traitements majeurs de déplétion des lymphocytes B pour la sclérose en plaques (SEP) récurrente : l'ocrelizumab (OCR) et l'ofatumumab (OFA). Les chercheurs ont suivi 961 patients pendant jusqu'à 2,5 ans et ont constaté que l'OFA était aussi efficace que l'OCR pour prévenir les poussées, la progression du handicap et l'apparition de nouvelles lésions à l'IRM. Bien que les deux traitements aient démontré une efficacité globale similaire, des différences potentielles sont apparues chez les patients ayant changé de certaines thérapies antérieures, ce qui nécessite des investigations supplémentaires.
Comparaison de l'ocrelizumab et de l'ofatumumab dans la sclérose en plaques récurrente : guide complet pour les patients
Table des matières
- Introduction : pourquoi cette recherche est importante
- Méthodologie de l'étude : comment la recherche a été menée
- Principaux résultats : données détaillées avec tous les chiffres
- Implications cliniques : ce que cela signifie pour les patients
- Limites : ce que l'étude n'a pas pu démontrer
- Recommandations : conseils pratiques pour les patients
- Informations sur la source
Introduction : pourquoi cette recherche est importante
La sclérose en plaques est une maladie neurologique complexe dans laquelle le système immunitaire attaque par erreur la gaine protectrice des fibres nerveuses. Pour les patients atteints de formes récurrentes de SEP (SEP-R), les thérapies qui ciblent les lymphocytes B ont révolutionné la prise en charge en s’attaquant spécifiquement aux cellules immunitaires impliquées dans l’activation de la maladie.
Deux traitements majeurs de cette catégorie sont l’ocrelizumab (OCR) et l’ofatumumab (OFA), tous deux approuvés par les agences réglementaires pour la SEP-R. Bien qu’ils agissent tous deux en ciblant la protéine CD20 à la surface des lymphocytes B, ils présentent des différences notables. L’OCR est généralement administré par perfusion intraveineuse tous les six mois, tandis que l’OFA est injecté par voie sous-cutanée une fois par mois.
Bien que ces deux traitements aient fait preuve de leur efficacité dans des essais cliniques, aucune étude en vie réelle ne les avait comparés directement jusqu’à présent. Cette lacune laissait les patients et les médecins sans repères clairs quant à l’éventuelle supériorité de l’un par rapport à l’autre en pratique courante.
Cette étude multicentrique allemande a suivi 1 138 patients dans trois centres médicaux, offrant ainsi la première comparaison exhaustive de ces deux traitements majeurs de la SEP en conditions réelles. Elle apporte des informations précieuses aux patients qui envisagent leurs options thérapeutiques.
Méthodologie de l'étude : comment la recherche a été menée
Les chercheurs ont conçu une étude de cohorte prospective, suivant des patients de septembre 2021 à juin 2024. L’étude a été menée dans trois grands centres hospitaliers universitaires en Allemagne : Düsseldorf, Essen et Giessen.
Elle incluait des adultes atteints de sclérose en plaques récurrente répondant aux critères diagnostiques révisés de McDonald 2017. Tous les participants étaient éligibles à un traitement par OCR ou OFA selon les recommandations standards. Important : le choix entre les deux traitements résultait d’une décision partagée entre le patient et son médecin avant l’inclusion.
Plusieurs critères d’exclusion ont été appliqués pour garantir une comparaison fiable :
- Antécédent de traitement par toute thérapie ciblant les lymphocytes B
- Antécédent de traitement par alemtuzumab ou cladribine
- Patients présentant initialement une SEP progressive
Les chercheurs ont utilisé des méthodes statistiques avancées d’appariement par score de propension pour constituer des groupes comparables. Cette technique a permis de s’assurer que les patients sous OCR et OFA étaient similaires en termes d’âge, durée de la maladie, taux de poussées antérieur, niveau de handicap et autres facteurs susceptibles d’influencer les résultats.
L’analyse finale a porté sur 544 patients sous OCR et 417 sous OFA après appariement, soit 961 patients au total. Le suivi cumulé a représenté 18 873 mois-patients (environ 1 573 années-patients), fournissant des données substantielles pour l’analyse.
Les critères d’évaluation principaux étaient :
- Poussées cliniques (définies comme une aggravation des symptômes neurologiques durant au moins 24 heures)
- Nouvelles lésions ou lésions prenant le contraste à l’IRM (lésions en hypersignal T2)
- Aggravation confirmée du handicap à 6 mois (ACD)
- Progression indépendante des poussées (PIP)
- Aggravation liée aux poussées (AAP)
Les IRM ont été réalisées selon des protocoles standardisés internationaux et interprétées par des neuroradiologues expérimentés, en aveugle du traitement reçu.
Principaux résultats : données détaillées avec tous les chiffres
Les groupes appariés étaient bien équilibrés, avec un âge moyen de 35,4 ans et une durée moyenne de la maladie de 44,9 mois. La cohorte était majoritairement féminine (67,1 % dans le groupe OCR, 69,5 % dans le groupe OFA), ce qui reflète la distribution habituelle selon le sexe dans la SEP.
Les patients présentaient une maladie active avant traitement, avec en moyenne 0,76 poussées par an dans le groupe OCR et 0,92 dans le groupe OFA au cours de l’année précédente. L’IRM initiale montrait en moyenne 19,2 lésions T2 chez les patients sous OCR et 19,1 chez ceux sous OFA.
Concernant les traitements antérieurs :
- 30,9 % des patients sous OCR et 35,3 % sous OFA étaient naïfs de tout traitement
- 24,4 % des patients sous OCR et 15,1 % sous OFA avaient précédemment reçu du natalizumab
- 16,9 % des patients sous OCR et 17,5 % sous OFA avaient pris des modulateurs des récepteurs S1P
- Le reste avait reçu d’autres thérapies de fond
Résultats sur les poussées : Au cours de l’étude, 168 patients ont présenté des poussées cliniques – 101 patients (18,6 %) dans le groupe OCR et 67 (16,1 %) dans le groupe OFA. Le taux annuel de poussées a chuté considérablement, passant de 0,76 à 0,11 dans l’ensemble de la cohorte, confirmant l’efficacité des deux traitements pour réduire l’activité de la maladie.
Résultats IRM : Les chercheurs ont détecté 278 nouvelles lésions ou lésions actives en T2 chez 213 patients. Précisément, 126 patients sous OCR (23,2 %) ont développé 174 lésions, contre 87 patients sous OFA (20,9 %) avec 104 lésions. Les données IRM étaient très complètes, avec 97,2 % des examens programmés disponibles pour analyse dans les deux groupes.
Résultats sur le handicap : Au total, 147 patients (15,6 %) ont présenté une aggravation confirmée du handicap. Cela incluait 93 patients sous OCR (17,1 %) et 54 sous OFA (12,9 %). L’aggravation du handicap a été catégorisée comme suit :
- Aggravation liée aux poussées (AAP) : 80 patients au total (8,4 % OCR, 8,2 % OFA)
- Progression indépendante des poussées (PIP) : 67 patients au total (8,6 % OCR, 4,8 % OFA)
Analyse de non-infériorité : L’analyse principale a établi que l’OFA n’était pas inférieur à l’OCR pour tous les critères mesurés. En utilisant une marge de non-infériorité de 15 % (signifiant que l’OFA pouvait être jusqu’à 15 % moins efficace tout en restant considéré comme non inférieur), les chercheurs n’ont trouvé aucune différence significative entre les deux traitements.
Analyses de sous-groupes : En examinant les patients selon leurs traitements antérieurs, les chercheurs ont observé des résultats cohérents chez les patients naïfs de traitement et ceux changeant de thérapies de fond. Des différences potentielles sont toutefois apparues chez les patients passant de modulateurs des récepteurs S1P (comme le fingolimod) ou du natalizumab, bien que ces observations nécessitent une validation dans des études plus larges.
Parmi les patients précédemment traités par modulateurs S1P, 26,1 % de ceux passant à l’OCR et 17,8 % à l’OFA l’ont fait en raison d’une activité résiduelle de la maladie. Les autres ont changé à cause d’effets indésirables, incluant une lymphopénie (49 %), des infections (35 %), des réactions cutanées (8 %), une syncope (5 %) et une augmentation de la pression oculaire (3 %).
Implications cliniques : ce que cela signifie pour les patients
Cette étude apporte des preuves rassurantes : l’OCR et l’OFA sont tous deux des traitements très efficaces contre la sclérose en plaques récurrente. La conclusion selon laquelle l’OFA n’est pas inférieur à l’OCR signifie que patients et médecins peuvent choisir entre ces options en fonction des préférences individuelles et des contraintes pratiques, sans craindre une différence d’efficacité.
Pour les patients qui préfèrent des traitements moins fréquents et ne redoutent pas les perfusions intraveineuses, l’OCR administré tous les six mois peut être préférable. Pour ceux qui privilégient l’auto-administration à domicile et une posologie plus régulière, l’OFA sous-cutané mensuel constitue une excellente alternative. Les deux options offrent une protection comparable contre les poussées, la progression du handicap et l’apparition de nouvelles lésions à l’IRM.
La réduction spectaculaire du taux annuel de poussées, passant d’environ 0,84 avant traitement à 0,11 après, souligne la puissance des thérapies ciblant les lymphocytes B. Cela se traduit concrètement par une absence de poussées pour la majorité des patients sous traitement, améliorant significativement leur qualité de vie et réduisant le fardeau de la maladie.
Les résultats similaires observés chez les patients naïfs de traitement et ceux changeant de thérapies de fond suggèrent que l’OCR et l’OFA sont des choix adaptés, quel que soit l’historique thérapeutique. Ce point est particulièrement important pour les patients envisageant un renforcement thérapeutique après des traitements moins efficaces.
Les différences potentielles observées chez les patients passant de modulateurs S1P ou du natalizumab indiquent que les médecins devraient prendre en compte l’historique individuel lorsqu’ils choisissent entre ces traitements. Ces observations restent préliminaires et devront être confirmées par de futures études.
Globalement, cette recherche élargit les choix thérapeutiques et renforce la confiance des patients dans leurs décisions, sachant que les deux options offrent un excellent contrôle de la maladie en conditions réelles.
Limites : ce que l'étude n'a pas pu démontrer
Bien que cette étude fournisse des preuves précieuses en vie réelle, plusieurs limites doivent être prises en compte. Sa nature observationnelle implique que l’attribution des traitements n’était pas randomisée, même si des méthodes statistiques avancées ont été utilisées pour minimiser ce biais.
La période de suivi, bien que substantielle (jusqu’à 2,5 ans), pourrait être insuffisante pour détecter des différences dans les résultats à long terme ou des effets secondaires rares. La SEP étant une maladie chronique, un suivi prolongé est nécessaire pour comprendre le comportement de ces traitements sur plusieurs décennies.
L’étude ayant été menée dans des centres universitaires en Allemagne, sa généralisation à d’autres systèmes de santé ou populations de patients peut être limitée. Les protocoles de traitement, de suivi et les caractéristiques des patients peuvent varier selon les pays ou les contextes.
Bien que divers sous-groupes aient été inclus, certains – notamment ceux changeant de nouveaux modulateurs S1P comme l’ozanimod et le ponesimod – étaient de petite taille. Cela limite la portée des analyses de sous-groupes et souligne la nécessité d’études plus larges.
L’étude n’a pas évalué de manière exhaustive la sécurité et les effets secondaires, qui sont pourtant des éléments cruciaux dans le choix d’un traitement. Bien que généralement bien tolérés, ces traitements peuvent présenter des profils d’effets indésirables variables selon les patients.
Enfin, le design de non-infériorité permet d’établir que l’OFA n’est pas moins efficace que l’OCR dans une certaine mesure, mais ne prouve pas une équivalence parfaite. De petites différences, non détectables ici, pourraient exister.
Recommandations : conseils pratiques pour les patients
Sur la base de ces résultats, les patients atteints de SEP récurrente peuvent considérer les recommandations suivantes lorsqu’ils discutent de leurs options thérapeutiques avec leur médecin :
- Discutez des deux options avec votre neurologue. L’ocrelizumab (OCR) et l’ofatumumab (OFA) sont des traitements hautement efficaces ; le choix doit tenir compte de votre mode de vie, de vos préférences et de votre situation personnelle.
- Prenez en compte le mode d’administration. Si vous préférez des traitements espacés et que les perfusions en milieu médical ne vous dérangent pas, l’OCR peut convenir. Si vous privilégiez l’auto-administration à domicile et une fréquence plus régulière, l’OFA peut être préférable.
- Tenez compte de vos antécédents thérapeutiques. Bien que les deux traitements soient efficaces pour la majorité des patients, ceux qui changent de modulateurs S1P ou de natalizumab doivent discuter en détail avec leur médecin des différences potentielles observées dans cette étude.
- Surveillez votre réponse au traitement. Quel que soit le choix, un suivi régulier par évaluations cliniques et IRM reste essentiel pour s’assurer de l’efficacité du traitement.
- Signalez tout effet indésirable. Les deux traitements peuvent occasionner des effets secondaires, même s’ils sont généralement bien tolérés. Informez rapidement votre équipe soignante de toute inquiétude.
- Restez informé des avancées. Au fur et à mesure que de nouvelles études paraîtront, notamment avec des données à long terme et des analyses de sous-groupes plus fines, les recommandations pourront évoluer. Maintenez un dialogue ouvert avec votre médecin sur les dernières evidences.
N’oubliez pas que les décisions thérapeutiques doivent résulter d’un processus de décision partagée entre vous et votre médecin, prenant en compte l’ensemble des preuves disponibles, votre situation individuelle et vos préférences personnelles.
Informations sur la source
Titre de l'article original : Different Treatment Outcomes of Multiple Sclerosis Patients Receiving Ocrelizumab or Ofatumumab
Auteurs : Sven G. Meuth, Stephanie Wolff, Anna Mück, Alice Willison, Konstanze Kleinschnitz, Saskia Räuber, Marc Pawlitzki, Franz Felix Konen, Thomas Skripuletz, Matthias Grothe, Tobias Ruck, Hagen B. Huttner, Christoph Kleinschnitz, Tobias Bopp, Refik Pul, Bruce A. C. Cree, Hans-Peter Hartung, Kathrin Möllenhoff, Steffen Pfeuffer
Publication : Annals of Neurology, 2025;97:583–595
DOI : 10.1002/ana.27143
Cet article de vulgarisation s’appuie sur une recherche évaluée par les pairs et publiée dans une revue médicale de premier plan. Il vise à rendre accessibles aux patients des informations scientifiques complexes, tout en restant fidèle aux résultats et données essentielles de l’étude originale.