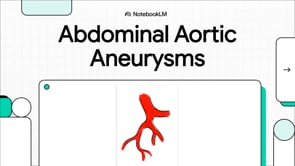Cette étude exhaustive a comparé l'efficacité de six traitements courants de la sclérose en plaques sur une période de cinq ans, en s'appuyant sur les données de 23 236 patients issus de 35 pays. Les chercheurs ont observé que le natalizumab réduisait le risque de poussée de 56 % et l'aggravation du handicap de 57 % par rapport à l'acétate de glatiramère, tandis que le fingolimod diminuait les poussées de 40 %. L'étude confirme que les thérapies à haute efficacité offrent une meilleure protection contre l'activité de la maladie, le natalizumab présentant les effets les plus significatifs sur les poussées et la progression du handicap.
Comparaison des traitements de la sclérose en plaques : quelles thérapies sont les plus efficaces sur 5 ans ?
Table des matières
- Pourquoi cette recherche est importante
- Méthodologie de l'étude
- Résultats détaillés de la comparaison des traitements
- Implications cliniques pour les patients
- Limites de l'étude
- Conseils pratiques pour les patients
- Informations sur la source
Pourquoi cette recherche est importante
La sclérose en plaques (SEP) est une maladie neurologique chronique dans laquelle le système immunitaire attaque la gaine protectrice des fibres nerveuses. Les traitements modificateurs de la maladie (TMM) visent à réduire les poussées (exacerbations des symptômes), ralentir la progression du handicap et retarder l'évolution vers des stades plus avancés. Face à la multiplicité des options thérapeutiques, patients et neurologues ont besoin de preuves claires sur l'efficacité à long terme des différents traitements.
Les essais cliniques randomisés comparent généralement un traitement à un placebo, mais rarement plusieurs traitements entre eux. Cette lacune dans nos connaissances concernant les thérapies les plus efficaces selon les profils de patients a motivé cette étude internationale, qui analyse des données en vie réelle provenant de milliers de patients suivis jusqu'à cinq ans.
L'équipe de recherche a utilisé des méthodes statistiques avancées pour simuler un essai randomisé multi-traitements. Six traitements courants ont été comparés : natalizumab (Tysabri), fingolimod (Gilenya), diméthyl fumarate (Tecfidera), tériflunomide (Aubagio), interféron bêta (diverses marques) et acétate de glatiramère (Copaxone), ainsi que l'absence de traitement.
Méthodologie de l'étude
Les chercheurs ont analysé les données de 23 236 patients atteints de SEP récurrente-rémittente ou de syndrome cliniquement isolé (forme précoce de SEP), issus de 74 centres médicaux dans 35 pays. Les données provenaient du registre MSBase, une base internationale qui suit les patients dans le temps. Le suivi moyen était de 2,8 ans à partir de la première consultation avec enregistrement du handicap.
L'étude a utilisé des techniques statistiques sophistiquées (modèles structurels marginaux) pour comparer les traitements en tenant compte des différences entre les groupes de patients. Cette approche a permis d'équilibrer les groupes sur des facteurs importants tels que :
- Âge, sexe et statut gestationnel
- Durée de la maladie et niveau de handicap
- Antécédents thérapeutiques
- Activité récente des poussées
- Résultats d'IRM (lorsque disponibles)
Les patients ont été analysés à partir de leur premier épisode de traitement enregistré et suivis jusqu'à changement de traitement, interruption ou fin de l'étude. Trois critères principaux ont été examinés : fréquence des poussées, aggravation confirmée du handicap (≥12 mois) et amélioration confirmée du handicap (≥12 mois).
Les méthodes statistiques ont créé des comparaisons pondérées posant la question : « Que se passerait-il si le même groupe de patients recevait différents traitements ? » Cette approche permet des comparaisons plus équitables entre des traitements généralement prescrits à différents types de patients en pratique clinique réelle.
Résultats détaillés de la comparaison des traitements
L'étude a produit deux types de comparaisons : les effets moyens du traitement (EMT) montrant le comportement des traitements chez tous les patients, et les effets moyens du traitement chez les traités (EMTT) pour les groupes de patients spécifiques qui les reçoivent typiquement.
Réduction des poussées
Comparé à l'acétate de glatiramère (traitement de référence), plusieurs thérapies ont montré une efficacité supérieure :
- Natalizumab : réduction de 56 % du risque de poussée (HR=0,44, IC 95 %=0,40 à 0,50)
- Fingolimod : réduction de 40 % du risque de poussée (HR=0,60, IC 95 %=0,54 à 0,66)
- Diméthyl fumarate : réduction de 22 % du risque de poussée (HR=0,78, IC 95 %=0,66 à 0,92)
- Tériflunomide : réduction de 11 % non significative (HR=0,89, IC 95 %=0,75 à 1,06)
- Interféron bêta : réduction de 5 % à la limite de la significativité (HR=0,95, IC 95 %=0,89 à 1,00)
- Aucun traitement : augmentation de 35 % du risque de poussée (HR=1,35, IC 95 %=1,27 à 1,44)
Aggravation du handicap
Pour prévenir l'aggravation confirmée du handicap (≥12 mois) :
- Natalizumab : réduction de 57 % du risque (HR=0,43, IC 95 %=0,32 à 0,56)
- Fingolimod : réduction de 15 % non significative (HR=0,85, IC 95 %=0,67 à 1,06)
- Diméthyl fumarate : réduction de 14 % non significative (HR=0,86, IC 95 %=0,51 à 1,47)
- Tériflunomide : réduction de 44 % (HR=0,56, IC 95 %=0,31 à 0,99)
- Interféron bêta : augmentation de 8 % du risque non significative (HR=1,08, IC 95 %=0,96 à 1,23)
- Aucun traitement : augmentation de 4 % du risque non significative (HR=1,04, IC 95 %=0,89 à 1,21)
Amélioration du handicap
Pour favoriser l'amélioration confirmée du handicap (≥12 mois) :
- Natalizumab : augmentation de 32 % de la probabilité (HR=1,32, IC 95 %=1,08 à 1,60)
- Fingolimod : augmentation de 18 % non significative (HR=1,18, IC 95 %=0,96 à 1,46)
- Diméthyl fumarate : augmentation de 15 % non significative (HR=1,15, IC 95 %=0,82 à 1,60)
- Tériflunomide : réduction de 30 % de la probabilité non significative (HR=0,70, IC 95 %=0,44 à 1,11)
- Interféron bêta : augmentation de 3 % non significative (HR=1,03, IC 95 %=0,91 à 1,18)
- Aucun traitement : réduction de 9 % de la probabilité non significative (HR=0,91, IC 95 %=0,78 à 1,05)
Les comparaisons par paires (modèles EMTT) ont confirmé la supériorité constante du natalizumab et du fingolimod pour la réduction des poussées et les critères d'évaluation du handicap. Ces résultats sont restés cohérents même en tenant compte des données d'IRM et avec différents traitements de référence.
Implications cliniques pour les patients
Cette étude démontre que tous les traitements de la SEP n'ont pas la même efficacité. Les thérapies à haute efficacité, notamment le natalizumab et le fingolimod, offrent des résultats significativement meilleurs pour réduire les poussées et prévenir la progression du handicap par rapport aux thérapies d'efficacité modérée.
Pour les patients atteints de SEP récurrente-rémittente active, initier ou changer vers des traitements à haute efficacité pourrait offrir une meilleure protection à long terme. La réduction de 56 % du risque de poussée avec le natalizumab et de 40 % avec le fingolimod représentent des bénéfices cliniques substantiels, susceptibles de se traduire par moins d'hospitalisations, moins d'arrêts de travail et une meilleure qualité de vie.
Les critères d'évaluation du handicap, reflet de la progression à long terme impactant le fonctionnement quotidien, sont particulièrement importants. La réduction de 57 % du risque d'aggravation avec le natalizumab et l'augmentation de 32 % de la probabilité d'amélioration suggèrent qu'il pourrait non seulement ralentir la maladie mais potentiellement permettre une certaine récupération fonctionnelle.
Ces résultats soutiennent le concept d'« escalade thérapeutique » – commencer par des thérapies à haute efficacité pour les patients avec une maladie active, plutôt qu'une approche séquentielle débutant par des traitements modérés. Cette stratégie pourrait aider à prévenir l'accumulation de handicap irréversible.
Limites de l'étude
Bien que précieuse, cette étude observationnelle présente plusieurs limites :
- Pas un essai randomisé : Les décisions de traitement étaient prises par les médecins et les patients, non par assignation aléatoire
- Biais de sélection : Les thérapies à haute efficacité sont souvent prescrites aux patients avec une maladie plus active, ce qui pourrait minorer leurs résultats
- Données d'IRM manquantes : De nombreux patients n'avaient pas d'informations IRM complètes, bien que les analyses de sensibilité aient montré des résultats similaires
- Effets secondaires non comparés : L'étude s'est concentrée sur l'efficacité, pas sur les profils de sécurité
- Traitements récents exclus : Certains traitements plus récents n'étaient pas largement utilisés pendant la période d'étude (2006-2019)
Les chercheurs ont noté que certains facteurs (niveaux de handicap pour le natalizumab, activité récente des poussées pour le fingolimod) étaient difficiles à équilibrer parfaitement. Bien qu'ajustées statistiquement, des différences résiduelles persistent.
Conseils pratiques pour les patients
Sur la base de ces résultats, les patients atteints de SEP devraient considérer les éléments suivants lors des discussions avec leur neurologue :
- Discutez des niveaux d'efficacité : Interrogez votre médecin sur l'efficacité relative des options, pas seulement sur leurs effets secondaires
- Considérez votre activité maladie
- Pensez à long terme : Les critères d'évaluation du handicap sur plusieurs années importent plus que la seule réduction à court terme des poussées
- Réévaluez régulièrement la réponse au traitement
- Équilibrez bénéfices et risques : Prenez en compte la surveillance requise, le mode d'administration et les effets secondaires potentiels
- Participez aux registres
Les décisions de traitement doivent être personnalisées selon vos caractéristiques maladie spécifiques, mode de vie, préférences et tolérance au risque. Cette étude fournit des preuves précieuses sur l'efficacité comparative, mais les réponses individuelles peuvent varier.
Informations sur la source
Titre original de l'article : Effectiveness of multiple disease-modifying therapies in relapsing-remitting multiple sclerosis: causal inference to emulate a multiarm randomised trial
Auteurs : Ibrahima Diouf, Charles B Malpas, Sifat Sharmin, Izanne Roos, Dana Horakova, Eva Kubala Havrdova, Francesco Patti, Vahid Shaygannejad, Serkan Ozakbas, Sara Eichau, Marco Onofrj, Alessandra Lugaresi, Raed Alroughani, Alexandre Prat, Pierre Duquette, Murat Terzi, Cavit Boz, Francois Grand'Maison, Patrizia Sola, Diana Ferraro, Pierre Grammond, Bassem Yamout, Ayse Altintas, Oliver Gerlach, Jeannette Lechner-Scott, Roberto Bergamaschi, Rana Karabudak, Gerardo Iuliano, Christopher McGuigan, Elisabetta Cartechini, Stella Hughes, Maria Jose Sa, Claudio Solaro, Ludwig Kappos, Suzanne Hodgkinson, Mark Slee, Franco Granella, Koen de Gans, Pamela A McCombe, Radek Ampapa, Anneke van der Walt, Helmut Butzkueven, José Luis Sánchez-Menoyo, Steve Vucic, Guy Laureys, Youssef Sidhom, Riadh Gouider, Tamara Castillo-Trivino, Orla Gray, Eduardo Aguera-Morales, Abdullah Al-Asmi, Cameron Shaw, Talal M Al-Harbi, Tunde Csepany, Angel P Sempere, Irene Treviño Frenk, Elizabeth A Stuart, Tomas Kalincik
Publication : Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, 2023;94:1004-1011
Note : Cet article destiné aux patients s'appuie sur une recherche évaluée par des pairs analysant les données de 23 236 patients issus de 35 pays, suivis pendant une durée allant jusqu'à 5 ans.