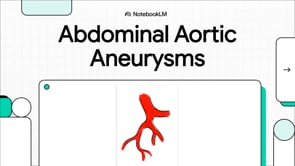Une femme de 22 ans, sans antécédents médicaux notables, a présenté une pathologie d’évolution fulgurante associant céphalées intenses, fièvre, défaillance respiratoire et manifestations neurologiques. Le bilan a mis en évidence des complications potentiellement mortelles, notamment une hémorragie intracrânienne, des accidents vasculaires cérébraux multiples, une atteinte valvulaire cardiaque et une implication pulmonaire. Après des investigations approfondies, le diagnostic retenu fut celui d’une endocardite bactérienne à Streptococcus mitis, d’évolution agressive, disséminée avec atteinte multiviscérale.
Une énigme médicale chez une jeune femme : de la céphalée à l’insuffisance multiviscérale
Table des matières
- Introduction : Apparition brutale des symptômes
- Présentation du cas : l’histoire de la patiente
- Évaluation initiale et déroulement hospitalier
- Transfert vers un centre spécialisé
- Détails des résultats d’imagerie
- Analyse des résultats biologiques
- Diagnostics différentiels : quelles hypothèses ?
- Diagnostic final et traitement
- Implications cliniques pour les patients
- Enseignements clés de ce cas
- Sources d’information
Introduction : Apparition brutale des symptômes
Ce cas concerne une femme de 22 ans, auparavant en bonne santé, qui a développé une maladie d’évolution rapide débutant par des symptômes apparemment bénins, mais évoluant rapidement vers une insuffisance multiviscérale mettant en jeu le pronostic vital. Son cas illustre la rapidité avec laquelle une infection bactérienne peut se disséminer dans l’organisme et provoquer des lésions multisystémiques, notamment cérébrales, cardiaques, pulmonaires et spléniques.
L’histoire de cette patiente souligne l’importance de reconnaître précocement les symptômes alarmants et de consulter rapidement. Son cas s’est avéré particulièrement complexe car elle présentait des symptômes touchant simultanément plusieurs systèmes organiques, obligeant les médecins à envisager divers diagnostics avant d’identifier la cause sous-jacente.
Présentation du cas : l’histoire de la patiente
Il s’agissait d’une femme de 22 ans travaillant dans le secteur de la santé, en excellente santé jusqu’à huit jours avant son hospitalisation. Ses symptômes ont débuté par des nausées et des douleurs musculaires (myalgies), qui ont évolué dans les deux jours suivants avec apparition de frissons, vomissements, douleurs cervicales et céphalées avec photophonie (sensibilité au bruit).
Elle s’est initialement présentée aux urgences, où les médecins ont noté une sécheresse des muqueuses mais aucun signe de méningite. Sa numération leucocytaire était élevée à 12 300 par microlitre (valeurs normales : 4 800–10 800), et sa numération plaquettaire était basse à 95 000 par microlitre (valeurs normales : 150 000–450 000). Elle a reçu une hydratation intraveineuse et un antalgique, puis est rentrée à domicile avec un diagnostic de syndrome viral présumé.
Évaluation initiale et déroulement hospitalier
Au cours de la semaine suivante, ses symptômes se sont significativement aggravés. Elle a développé une majoration des céphalées avec apparition d’une photophobie (sensibilité à la lumière), accompagnée d’un malaise général, d’une perte d’appétit, d’une toux sèche et d’une dyspnée d’effort minime. Deux jours avant son transfert vers l’hôpital spécialisé, sa mère a remarqué des épisodes de confusion avec discours incohérent et somnolence excessive.
Lors de son retour aux urgences, ses constantes vitales montraient une fièvre (38,0 °C), une tachycardie (106 battements par minute), une hypotension (100/55 mm Hg) et une polypnée (22 respirations par minute). Sa saturation en oxygène était de 97 % sous oxygénothérapie. Les médecins ont noté une photophobie, un léger érythème pharyngé et une sensibilité abdominale diffuse.
Le scanner cérébral sans injection a montré des signes d’hémorragie sous-arachnoïdienne (saignement autour du cerveau) et des modifications ischémiques diffuses des lobes pariétal et temporal. Les scanners thoracique, abdominal et pelvien ont révélé :
- Des opacités interstitielles pulmonaires diffuses
- De multiples opacités et nodules en périphérie pulmonaire
- Deux hypodensités périphériques spléniques
- Une légère adénomégalie rétropéritonéale
Transfert vers un centre spécialisé
La patiente a été admise en unité de soins intensifs et a débuté une antibiothérapie comprenant vancomycine, ceftriaxone, métronidazole et doxycycline. Malgré le traitement, sa fonction respiratoire s’est détériorée, nécessitant une augmentation du support oxygénatoire. Elle a alors été transférée au Massachusetts General Hospital pour une prise en charge spécialisée.
À son arrivée, elle était confuse et polypnéique. Ses antécédents comprenaient une dépression traitée par citalopram. Elle rapportait une consommation sociale de vin, l’utilisation de cigarette électronique et une consommation occasionnelle de cannabis, mais pas de tabagisme. Elle avait voyagé dans les Caraïbes plus d’un an auparavant, mais n’avait pas eu d’expositions récentes à des zones boisées, des animaux ou des insectes.
L’examen a révélé une détresse respiratoire avec utilisation des muscles accessoires. Elle n’était orientée qu’après stimulation et présentait une raideur méningée et une rigidité scapulaire. Les médecins ont ausculté des bruits respiratoires anormaux (râles et ronchi) et un souffle cardiaque holosystolique 3/6 maximal à l’apex et à l’aisselle gauche, irradiant vers le sternum. La pointe splénique était palpable, et elle présentait une petite zone de pétéchies sur le haut du thorax.
Détails des résultats d’imagerie
Les examens d’imagerie avancée ont révélé de multiples anomalies graves :
Scanner et IRM cérébraux : Ont montré une hémorragie sous-arachnoïdienne aiguë et de multiples infarctus corticaux aigus dans les deux hémisphères cérébraux. Plus précisément, il existait des hyperdensités curvilinéaires bilatérales dans les sillons corticaux évoquant un saignement, et des régions hypodenses focales dans le lobule pariétal supérieur gauche et le lobe temporal droit suggérant des accidents vasculaires cérébraux.
Scanner thoracique : A révélé un œdème interstitiel léger, des épanchements pleuraux bilatéraux, et des opacités nodulaires et des consolidations multifocales pérbronchovasculaires touchant tous les lobes pulmonaires. Certaines lésions étaient distribuées en périphérie sans cavitation.
Scanner abdominal : A montré plusieurs hypodensités spléniques correspondant vraisemblablement à des infarctus spléniques (zones de nécrose par obstruction vasculaire), avec une ascite légère et un œdème périportal modéré.
Une ponction lombaire réalisée après transfusion plaquettaire a montré une pression d’ouverture à 38 cm d’eau (élevée), avec un liquide céphalorachidien contenant : - Glucose : 41 mg/dL (bas, normale 50–75) - Protéines : 31 mg/dL (normale) - Globules rouges : 2400/μL (élevés, normale 0–5) - Globules blancs : 49/μL (élevés, normale 0–5) avec 76 % de neutrophiles
Analyse des résultats biologiques
Les examens biologiques ont montré de multiples anomalies évolutives :
Hémogramme : A montré une anémie progressive (hémoglobine passant de 12,5 à 8,9 g/dL), une hyperleucocytose persistante (pic à 20 210/μL avec 92 % de neutrophiles) et une thrombopénie sévère (plaquettes à 28 000/μL avant transfusion). Le frottis sanguin périphérique montrait une granulation toxique.
Biochimie : A révélé une hyponatrémie (133–136 mmol/L), une hypokaliémie (3,4 mmol/L), une urémie élevée (25 mg/dL), une créatinine normale, une hypocalcémie (7,7–8,0 mg/dL), une hypoprotidémie et hypoalbuminémie, une phosphatase alcaline élevée (169 U/L) et une hyperbilirubinémie (1,8 mg/dL).
Marqueurs cardiaques : Le NT-proBNP était considérablement élevé à 9130 pg/mL (normale <125), indiquant une souffrance cardiaque.
Marqueurs inflammatoires : Les D-Dimères étaient élevés à 1406 ng/mL (normale <500), le fibrinogène à 502 mg/dL (normale 150–400) et la ferritine à 258 μg/L (normale 10–200).
Diagnostics différentiels : quelles hypothèses ?
Les médecins ont envisagé plusieurs étiologies pour cette présentation complexe :
Causes infectieuses : L’association fièvre, souffle cardiaque, symptômes neurologiques et atteinte multiviscérale suggérait fortement un processus infectieux. Les diagnostics possibles incluaient : - Endocardite bactérienne (infection valvulaire cardiaque) - Maladies vectorielles à tiques (fièvre pourprée des montagnes Rocheuses, ehrlichiose, anaplasmose) - Infections virales (bien que les tests initiaux soient négatifs) - Infections bactériennes inhabituelles (leptospirose, brucellose)
Maladies auto-immunes : Compte tenu des antécédents familiaux de maladies auto-immunes (mère avec lupus cutané, grand-mère avec thyroïdite de Hashimoto), les médecins ont envisagé des causes auto-immunes comme une endocardite de Libman-Sacks liée au lupus ou un syndrome des antiphospholipides, bien que la recherche initiale d’anticorps antinucléaires soit négative.
Autres hypothèses : Un purpura thrombotique thrombocytopénique ou un syndrome hémolytique et urémique ont été envisagés mais semblaient moins probables compte tenu de l’absence de marqueurs biologiques caractéristiques.
La présence d’un souffle cardiaque, de symptômes neurologiques, d’une insuffisance respiratoire, d’anomalies spléniques et les résultats d’hémocultures ont finalement orienté vers une endocardite infectieuse avec embolies septiques (dissémination de l’infection par voie sanguine provoquant des obstructions dans divers organes).
Diagnostic final et traitement
Le diagnostic définitif a été établi par les hémocultures positives à Streptococcus mitis, une bactérie faisant partie de la flore buccale normale mais pouvant provoquer des infections graves lorsqu’elle pénètre dans la circulation sanguine.
L’échocardiographie transœsophagienne (échographie spécialisée par voie œsophagienne) a révélé la source : de multiples végétations (amas infectieux) sur la valve mitrale, avec plusieurs perforations du feuillet postérieur provoquant une régurgitation mitrale sévère (fuite). Ceci expliquait le souffle cardiaque et le mécanisme de dissémination bactérienne.
Le traitement a comporté : - La poursuite d’une antibiothérapie à large spectre - Une consultation chirurgicale pour une éventuelle réparation ou remplacement valvulaire - Des soins de support incluant une ventilation mécanique - La prise en charge des complications incluant crises convulsives et déficits neurologiques
L’infection à Streptococcus mitis s’est avérée particulièrement agressive car cette bactérie peut produire une toxine provoquant une inflammation généralisée et des lésions tissulaires diffuses.
Implications cliniques pour les patients
Ce cas offre plusieurs enseignements importants :
Reconnaître les symptômes graves : Ce qui a débuté comme des symptômes pseudo-grippaux apparemment bénins a rapidement évolué vers une maladie grave. Les patients doivent consulter rapidement en cas de :
- Céphalées sévères avec photophobie ou photophonie
- Fièvre persistante ou aggravée
- Confusion ou altération de l’état mental
- Dyspnée d’effort minime
- Ecchymoses inexpliquées ou pétéchies cutanées
Comprendre le risque d’endocardite : Bien que l’endocardite puisse toucher n’importe qui, elle est plus fréquente chez les personnes avec : - Antécédents de lésions valvulaires ou valves artificielles - Certaines cardiopathies congénitales - Antécédents de toxicomanie intraveineuse - Interventions dentaires ou médicales récentes pouvant introduire des bactéries dans la circulation
Importance de l’histoire médicale complète : La profession de santé de cette patiente aurait pu l’exposer à des pathogènes, bien que la source exacte de l’infection n’ait pas été identifiée.
Enseignements clés de ce cas
Ce cas complexe illustre plusieurs principes médicaux essentiels :
Évaluation multisystémique : Face à des symptômes touchant simultanément plusieurs systèmes organiques, les médecins doivent envisager des diagnostics pouvant expliquer l’ensemble des manifestations plutôt que de traiter chaque symptôme isolément.
Évolution rapide : Certaines infections bactériennes peuvent évoluer avec une rapidité alarmante de symptômes bénins vers une défaillance multiviscérale engageant le pronostic vital. La reconnaissance précoce et le traitement sont essentiels.
Défis diagnostiques : Ce cas a nécessité une coordination entre plusieurs spécialistes, notamment des infectiologues, des cardiologues, des neurologues et des médecins de soins intensifs, pour parvenir au diagnostic correct.
Complexité de la prise en charge : Le traitement de telles infections sévères requiert à la fois une antibiothérapie ciblée et des soins de support pour les diverses complications résultant de l’inflammation généralisée et des lésions organiques.
La patiente a finalement nécessité une hospitalisation prolongée avec support en soins intensifs, plusieurs antibiotiques, et aura probablement besoin d’un suivi à long terme pour ses complications neurologiques et cardiaques.
Source d’information
Titre original de l’article : Cas 38-2024 : Une femme de 22 ans présentant des céphalées, de la fièvre et une insuffisance respiratoire
Auteurs : Eleftherios Mylonakis, M.D., Ph.D., Eric W. Zhang, M.D., Philippe B. Bertrand, M.D., Ph.D., M. Edip Gurol, M.D., Virginia A. Triant, M.D., M.P.H., et Kristine M. Chaudet, M.D.
Publication : The New England Journal of Medicine, 5 décembre 2024 ; 391:2148–57
DOI : 10.1056/NEJMcpc2100279
Cet article vulgarisé est basé sur une recherche évaluée par les pairs provenant des Comptes rendus de cas du Massachusetts General Hospital.