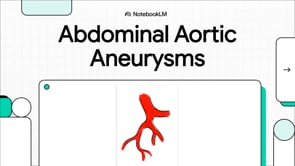Ce cas concerne une femme de 32 ans ayant présenté une douleur lombaire aiguë, de la fièvre et une gêne respiratoire, conduisant au diagnostic d’une néphropathie membraneuse liée au récepteur de la phospholipase A2, une pathologie rénale sévère. Son évolution illustre la façon dont cette maladie auto-immune peut entraîner une perte massive de protéines dans les urines, une hypoprotéinémie marquée et des thromboses potentiellement mortelles au niveau des veines rénales et pulmonaires, y compris chez de jeunes adultes sans antécédents. Le diagnostic a été confirmé par des tests sanguins spécifiques détectant les anticorps anti-PLA2R, évitant ainsi le recours immédiat à une biopsie rénale.
Le parcours d'une jeune femme atteinte de néphropathie et de thromboses : comprendre la néphropathie membraneuse
Table des matières
- Présentation du cas : l'histoire de la patiente
- Symptômes et constatations initiales
- Résultats de l'examen physique
- Résultats des examens biologiques
- Imagerie médicale
- Diagnostic différentiel
- Examens diagnostiques
- Prise en charge thérapeutique
- Implications cliniques pour les patients
- Limites de ce cas
- Recommandations aux patients
- Sources d'information
Présentation du cas : l'histoire de la patiente
Une femme de 32 ans s’est présentée à l’hôpital pour des douleurs lombaires gauches intenses, de la fièvre et une baisse de la saturation en oxygène. Ses symptômes ont débuté deux semaines plus tôt par des douleurs lombaires gauches aiguës et intermittentes, qui se sont nettement aggravées deux jours avant son admission, devenant constantes et accompagnées de nausées. La veille de son hospitalisation, elle a présenté plusieurs épisodes de vomissements.
Le matin de son admission, une toux sèche est apparue, avec une sensation de fièvre sans prise de température. Elle s’est d’abord rendue dans un centre de soins urgents, où sa température était de 38,1 °C, sa fréquence cardiaque de 113 battements par minute et sa saturation en oxygène de 95 % en air ambiant. Le centre a noté une sensibilité abdominale dans le quadrant inférieur gauche, mais aucune sensibilité lombaire.
Symptômes et constatations initiales
Ses premiers résultats biologiques ont révélé plusieurs anomalies préoccupantes. La numération leucocytaire était nettement élevée à 19 000 par microlitre (valeurs normales : 3 800–10 800), indiquant une réponse immunitaire ou infectieuse significative. Son taux d’albumine sérique était bas, à 2,8 g/dL (normal : 3,3–5,5 g/dL), suggérant une perte protéique.
L’analyse urinaire a montré des résultats inquiétants, avec du sang à 3+ et des protéines à 3+ (normalement absents). Sa saturation en oxygène est tombée à 89 % au centre de soins, nécessitant une oxygénothérapie à 3 litres par minute par sonde nasale pour maintenir une saturation à 94 %. Ces constatations ont motivé son transfert vers les urgences hospitalières.
Résultats de l'examen physique
Aux urgences, son état semblait plus grave. Sa température a atteint 39,6 °C, sa pression artérielle était à 102/58 mm Hg, sa fréquence cardiaque à 122 battements par minute et sa fréquence respiratoire à 28 cycles par minute. Elle nécessitait une oxygénothérapie continue.
L’examen physique a révélé une patiente inconfortable, avec des bruits pulmonaires anormaux comportant des crépitants inspiratoires et expiratoires bilatéraux. Une sensibilité à la palpation de l’abdomen inférieur gauche était présente. Notamment, aucun œdème des membres, ulcération buccale, alopécie ou éruption cutanée n’était observé, ce qui aidait à exclure certaines pathologies auto-immunes.
Résultats des examens biologiques
Le bilan biologique complet a fourni des informations diagnostiques cruciales. Sa numération leucocytaire restait élevée à 16 020 par microlitre, avec prédominance de neutrophiles (14 210 cellules). L’analyse urinaire montrait une persistance de sang 3+ et protéines 3+, avec plus de 100 hématies par champ (normal : 0–2) et 10–20 leucocytes par champ (normal : moins de 10).
Le rapport protéinurie/créatininurie était considérablement élevé à 3,5 (normal : <0,15), indiquant une perte protéique d’environ 3,5 grammes par jour dans les urines — caractéristique définissant le syndrome néphrotique. Les autres résultats significatifs incluaient :
- Protéine C-réactive (marqueur inflammatoire) : 199,9 mg/L (normal : 0–8,0)
- Vitesse de sédimentation (marqueur inflammatoire) : 40 mm/h (normal : 0–19)
- Lactate déshydrogénase : 278 U/L (normal : 110–210)
- Acide lactique : 2,2 mmol/L (normal : 0,5–2,0)
- Hémoglobine glyquée (A1c) : 6,2 % (normal : 4,3–5,6 %)
Sa fonction rénale montrait une créatinine à 0,93 mg/dL (dans les normes), mais sans valeur de référence, une insuffisance rénale aiguë ne pouvait être exclue.
Imagerie médicale
L’imagerie a révélé des éléments cruciaux expliquant ses symptômes. La radiographie thoracique montrait des opacités en patch aux bases pulmonaires et un petit épanchement pleural gauche. Le scanner thoracique avec contraste a révélé :
- Un défaut de remplissage partiel de l’artère pulmonaire lobaire inférieure droite évoquant une embolie pulmonaire
- Un épaississement des parois bronchiques et des opacités condensatives multifocales en verre dépoli
- De petits épanchements pleuraux gauche et droit
- Des zones d’épaississement septal interlobulaire avec opacités en verre dépoli
Le scanner abdomino-pelvien a montré des résultats encore plus significatifs :
- Une obstruction presque complète (thrombus occlusif) de la veine rénale gauche
- Une obstruction partielle (thrombus non occlusif) de la veine rénale droite
- Un rehaussement rénal hétérogène précoce avec infiltration périrénale
- Aucun signe de cancer thoracique, abdominal ou pelvien
Ces éléments d’imagerie expliquaient ses douleurs lombaires (thromboses veineuses rénales) et ses difficultés respiratoires (embolie pulmonaire et anomalies pulmonaires).
Diagnostic différentiel
L’équipe médicale a envisagé plusieurs diagnostics possibles expliquant cette association d’atteintes rénales et pulmonaires. La première préoccupation était un syndrome pneumo-rénal, associant hémorragie pulmonaire et inflammation rénale, généralement causé par des pathologies auto-immunes comme :
- Les vascularites associées aux ANCA (inflammation auto-immune des petits vaisseaux)
- La maladie anti-membrane basale glomérulaire (syndrome de Goodpasture)
- Le lupus érythémateux disséminé (LED) avec atteinte rénale
- Le syndrome des antiphospholipides (trouble de la coagulation)
- La vascularite cryoglobulinémique (protéines anormales s’agrégeant au froid)
Cependant, l’absence de certains éléments rendait ces diagnostics moins probables. L’équipe s’est alors concentrée sur le syndrome néphrotique, caractérisé par une protéinurie massive (>3,5 g/jour), une hypoalbuminémie et des œdèmes. La présence de thromboses veineuses rénales orientait fortement vers des causes spécifiques de syndrome néphrotique, particulièrement la néphropathie membraneuse, qui présente l’association la plus forte avec les thromboses parmi les néphropathies.
D’autres causes de syndrome néphrotique ont été envisagées mais jugées moins probables :
- La néphropathie à lésions glomérulaires minimes et la glomérulosclérose segmentaire et focale : Présentent habituellement des œdèmes majeurs, moins associées aux thromboses
- La néphropathie diabétique : Son A1c à 6,2 % rendait ce diagnostic improbable
- La néphropathie lupique : Absence d’antécédents de douleurs articulaires, éruptions cutanées ou autres symptômes auto-immuns
- Les causes secondaires infectieuses, cancéreuses ou médicamenteuses : Aucun élément dans l’histoire
Examens diagnostiques
L’équipe a réalisé des tests sanguins spécifiques pour identifier la cause de son syndrome néphrotique. La recherche d’anticorps anti-PLA2R (récepteur de la phospholipase A2), associés à la néphropathie membraneuse primitive, a été effectuée. Deux méthodes différentes ont été utilisées :
- Test d’immunofluorescence indirecte : Cette méthode utilise des marqueurs fluorescents pour détecter les anticorps se liant aux récepteurs PLA2R. Son test était positif.
- ELISA (test immuno-enzymatique) : Ce test quantitatif a mesuré son taux d’anticorps à 400,3 RU/mL (normal : <14 RU/mL).
La combinaison de résultats positifs aux deux tests, avec sa présentation clinique, a confirmé le diagnostic de néphropathie membraneuse associée aux anticorps anti-récepteur de la phospholipase A2. Ce test sérologique présente une spécificité de 99 % pour cette pathologie, signifiant que presque toutes les personnes avec des tests positifs en sont véritablement atteintes.
Prise en charge thérapeutique
La prise en charge de la néphropathie membraneuse dépend de plusieurs facteurs. Pour les patients avec une fonction rénale préservée, les médecins recommandent souvent une période d’observation de 6 mois, car environ 30 % des patients peuvent s’améliorer spontanément sans traitement immunosuppresseur. Cependant, cette patiente nécessitait une intervention immédiate en raison de plusieurs facteurs de haut risque :
- Une hypoalbuminémie sévère (albumine sérique <2,5 g/dL)
- Des événements thromboemboliques multiples (thromboses veineuses rénales et embolie pulmonaire)
- Un taux élevé d’anticorps anti-PLA2R (400,3 RU/mL)
Le traitement implique typiquement une immunosuppression. L’ancienne référence était le protocole de Ponticelli modifié, alternant corticostéroïdes et agents alkylants (comme le cyclophosphamide) sur 6 mois. Les approches plus récentes considèrent l’évolution des taux d’anticorps anti-PLA2R — si les taux diminuent spontanément, l’immunosuppression pourrait être différée, mais une élévation indiquerait la nécessité du traitement.
De plus, elle nécessitait un traitement immédiat de ses complications thromboemboliques par anticoagulants pour prévenir de nouvelles thromboses.
Implications cliniques pour les patients
Ce cas illustre plusieurs points importants pour les patients présentant des symptômes similaires. Premièrement, des douleurs lombaires avec fièvre et difficultés respiratoires ne doivent jamais être ignorées, surtout lorsqu’elles s’accompagnent d’une baisse de la saturation en oxygène. L’association d’une protéinurie significative et de thromboses, particulièrement dans des localisations inhabituelles comme les veines rénales, doit faire suspecter une néphropathie membraneuse.
Les patients doivent savoir que la néphropathie membraneuse est une maladie auto-immune où l’organisme attaque ses propres cellules rénales, ciblant spécifiquement les récepteurs PLA2R des podocytes (cellules rénales spécialisées maintenant la barrière de filtration). Cette attaque provoque des fuites dans le système de filtration rénale, permettant une perte massive de protéines dans les urines.
Le risque thrombotique est particulièrement élevé dans cette pathologie car la perte protéique entraîne une diminution des anticoagulants naturels, tandis que le foie compense en produisant plus de facteurs de coagulation. Le risque est maximal lorsque l’albumine sérique descend en dessous de 2,5 g/dL, comme observé chez cette patiente.
Limites de ce cas
Bien que ce cas fournisse des insights précieux, il présente plusieurs limites. En tant qu’observation unique, il ne peut établir des schémas généraux ou des réponses thérapeutiques pour tous les patients atteints de néphropathie membraneuse. Les antécédents familiaux (sœur atteinte d’insuffisance rénale terminale décédée à 18 ans) suggèrent des facteurs génétiques possibles, mais ceux-ci n’ont pas été pleinement explorés.
Sans biopsie rénale, nous ne pouvons définitivement exclure d’autres néphropathies concomitantes, bien que la haute spécificité du test anti-PLA2R rende cela improbable. Le cas ne fournit pas non plus d’informations de suivi à long terme sur sa réponse au traitement ou son évolution finale.
Recommandations aux patients
Sur la base de ce cas, les patients devraient considérer les recommandations suivantes :
- Consultez immédiatement un médecin en cas de douleur lombaire persistante accompagnée de fièvre, de difficultés respiratoires ou d’une saturation en oxygène diminuée
- Demandez une analyse d’urine complète en présence d’œdèmes inexpliqués, surtout s’ils s’accompagnent de douleurs lombaires ou de symptômes respiratoires
- Envisagez un dosage spécifique des anticorps anti-PLA2R en cas de diagnostic de syndrome néphrotique, car cela peut permettre un diagnostic non invasif
- Abordez la prévention thrombotique avec votre néphrologue si vous présentez un syndrome néphrotique avec un taux d’albumine bas (<2,5 g/dL)
- Maintenez un suivi régulier auprès des services de néphrologie et d’hématologie en cas de néphropathie membraneuse, compte tenu des risques doubles de progression rénale et de complications thrombotiques
Les patients doivent également savoir que de nouveaux traitements émergent constamment pour les maladies rénales auto-immunes, et qu’une consultation avec un néphrologue spécialisé est essentielle pour une prise en charge optimale.
Sources d'information
Titre original de l’article : Case 10-2025: A 32-Year-Old Woman with Flank Pain, Fever, and Hypoxemia
Auteurs : Anushya Jeyabalan, MD; Cynthia L. Czawlytko, MD; Laurence H. Beck, Jr., MD, PhD; Claire Trivin-Avillach, MD; Dennis C. Sgroi, MD; Eric S. Rosenberg, MD
Publication : The New England Journal of Medicine, 10 avril 2025; 392:1428–1437
DOI : 10.1056/NEJMcpc2412517
Cet article vulgarisé est basé sur une recherche évaluée par les pairs provenant des Case Records du Massachusetts General Hospital.