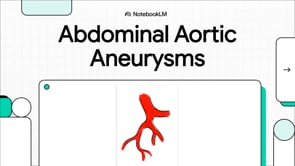Une femme de 30 ans a présenté des sensations de brûlure aux pieds, qui ont évolué vers des dysesthésies généralisées, des céphalées et une confusion, suite à un retour de voyage à l’étranger. Le bilan a mis en évidence une éosinophilie périphérique et une méningite à éosinophiles dans le liquide céphalorachidien, avec 694 leucocytes/μL (dont 8 % d’éosinophiles). Le diagnostic final a confirmé une angiostrongyloïdose, une infection parasitaire contractée par l’ingestion d’aliments crus contaminés lors de séjours en Thaïlande, au Japon et à Hawaï.
Un cas de méningite à éosinophiles lié à un voyage : Comprendre les symptômes neurologiques après un séjour à l’étranger
Table des matières
- Présentation du cas
- Antécédents médicaux et contexte du voyage
- Résultats de l'examen hospitalier
- Résultats des examens diagnostiques
- Diagnostics différentiels envisagés
- Diagnostic final : Angiostrongylose
- Implications cliniques pour les patients
- Limites de l'étude
- Recommandations aux patients
- Informations sur la source
Présentation du cas
Une femme de 30 ans a été admise au Massachusetts General Hospital pour des céphalées et des dysesthésies (sensations de brûlure inhabituelles). Ses symptômes ont débuté huit jours plus tôt par une sensation de brûlure aux pieds, qui s’est étendue aux jambes dans les deux jours suivants. Ces sensations s’aggravaient au toucher léger, un phénomène appelé allodynie.
Un traitement à l’ibuprofène n’a apporté aucun soulagement. La patiente a également présenté une fatigue, qu’elle a d’abord attribuée au décalage horaire après son retour d’un voyage de trois semaines en Thaïlande, au Japon et à Hawaï.
Cinq jours avant son admission, elle s’est rendue aux urgences d’un autre hôpital. Ses signes vitaux étaient stables : température à 37,2 °C, tension artérielle à 120/60 mm Hg, pouls à 106 battements par minute, fréquence respiratoire à 18 cycles par minute et saturation en oxygène à 100 %. Les premiers tests sanguins ont révélé une fonction rénale, des électrolytes, une glycémie et des taux de créatine kinase normaux. On notait toutefois une numération leucocytaire de 8 680/μL (intervalle de référence : 3 900–11 000) avec une éosinophilie à 870/μL (intervalle de référence : 0–450).
Trois jours avant l’admission, ses symptômes sensitifs ont progressé vers le tronc et les bras, et des céphalées sont apparues. Elle a mesuré une fièvre à 38,3 °C à domicile deux jours avant son admission. La veille de son admission, une seconde visite aux urgences a montré une éosinophilie persistante (1 050/μL) et une acidose métabolique légère.
Antécédents médicaux et contexte du voyage
La patiente avait des antécédents de syndrome de l’intestin irritable et prenait du dicyclomine et de la linaclotide. Elle vivait en Nouvelle-Angleterre côtière, travaillait dans un bureau et ne consommait ni tabac, ni alcool, ni drogues.
Son historique de voyage récent était significatif : elle était revenue douze jours plus tôt d’un séjour de trois semaines incluant :
- Bangkok, Thaïlande : visite de la ville et consommation de divers plats de rue (aucun aliment cru)
- Tokyo, Japon : séjour principalement en hôtel et plusieurs repas de sushi
- Hawaï : baignades répétées dans l’océan et consommation régulière de salades et sushis
Résultats de l'examen hospitalier
Lors de son admission au Massachusetts General Hospital, ses signes vitaux étaient les suivants : température à 37,3 °C, tension artérielle à 131/96 mm Hg, pouls à 62 battements par minute, fréquence respiratoire à 24 cycles par minute et saturation en oxygène à 93 %. Elle était vigilante mais désorientée, paraissant agitée et répondant de manière incohérente aux questions.
L’examen clinique a notamment révélé une nuque souple avec une mobilité normale et aucune éruption cutanée. Son indice de masse corporelle était de 26,3. Elle a reçu du lorazépam par voie intramusculaire et des perfusions intraveineuses à son admission.
Résultats des examens diagnostiques
Les premiers bilans biologiques ont montré une évolution progressive :
- La numération leucocytaire est passée de 8 680/μL à 15 500/μL en cinq jours
- L’éosinophilie, initialement élevée à 870/μL (référence : 0–450), est tombée à 10/μL à l’admission
- Les lymphocytes sont passés de 1 880/μL à 1 100/μL
- La numération plaquettaire est passée de 348 000/μL à 471 000/μL
La tomodensitométrie crânienne n’a montré aucune anomalie intracrânienne aiguë. L’examen microscopique des frottis sanguins n’a révélé aucun parasite.
Analyse du liquide céphalorachidien : La ponction lombaire a révélé une pression d’ouverture de 25 cm d’eau (intervalle de référence : 10–25). Le LCR présentait :
- 694 leucocytes/μL (intervalle de référence : 0–5)
- Différentiel : 81 % de lymphocytes, 9 % de monocytes, 8 % d’éosinophiles, 2 % de neutrophiles
- Glucose : 36 mg/dL (2,0 mmol/L ; référence : 40–70 mg/dL)
- Protéines totales : 101 mg/dL (référence : 15–45 mg/dL)
- Coloration de Gram : nombreux leucocytes, aucune bactérie
Ces résultats correspondaient aux critères de méningite à éosinophiles, définis par la présence d’au moins 10 éosinophiles/μL de LCR ou d’éosinophiles représentant plus de 10 % des leucocytes du LCR.
Diagnostics différentiels envisagés
L’équipe médicale a envisagé plusieurs pathologies pouvant expliquer à la fois les symptômes neurologiques et l’éosinophilie :
Syndrome de Guillain-Barré : Cette maladie auto-immune nerveuse implique typiquement des symptômes sensitifs et moteurs avec aréflexie. L’examen initial normal de la patiente rendait cette hypothèse peu probable, bien que des formes purement sensitives aient été rarement rapportées.
Méningite médicamenteuse : L’ibuprofène peut provoquer une méningite aseptique, mais les symptômes apparaissent généralement dans les 24 heures suivant la prise (et non huit jours après). De plus, la méningite médicamenteuse montre habituellement une prédominance neutrophile dans le LCR, et non éosinophile.
Granulomatose éosinophilique avec polyangéite (GEPA) : Cette maladie auto-immune peut causer une éosinophilie et des symptômes sensitifs similaires au Guillain-Barré, mais l’absence de lésions purpuriques ou de sinusite rendait cette hypothèse improbable.
Causes infectieuses : Compte tenu de ses antécédents de voyage, plusieurs infections parasitaires ont été envisagées :
- Gnathostomose : Causée par la consommation de poisson cru, endémique en Asie du Sud-Est et de l’Est, mais provoque typiquement des douleurs radiculaires migratrices et un œdème cutané
- Paragonimose : Due à la consommation de crabe cru, mais cause habituellement des symptômes gastro-intestinaux et de la toux
- Sparganose : Due à la consommation de serpents, grenouilles ou poissons d’eau douce crus, ce qu’elle a nié
- Strongyloïdose : Due à une eau contaminée, mais provoque typiquement des manifestations cutanées
- Schistosomiase : Presque éradiquée en Thaïlande et au Japon, et elle ne présentait pas les symptômes caractéristiques
Diagnostic final : Angiostrongylose
La patiente a été diagnostiquée avec une angiostrongylose, causée par le nématode Angiostrongylus cantonensis. Il s’agit de la cause la plus fréquente de méningite à éosinophiles dans le monde.
Transmission : L’infection survient par :
- La consommation d’escargots ou de limaces infectés crus ou mal cuits
- La consommation de produits contaminés par des escargots/limaces infectés ou leur mucus
- La consommation d’hôtes paraténiques infectés (crabes terrestres, crevettes d’eau douce, grenouilles) ayant ingéré des escargots infectés
Distribution géographique : Décrite initialement à Taïwan, elle est désormais présente dans les régions tropicales et subtropicales, notamment en Asie du Sud-Est, dans les îles du Pacifique (y compris Hawaï), et de plus en plus en Australie, en Europe, dans le sud des États-Unis et dans les Caraïbes.
Période d’incubation et physiopathologie : La période d’incubation moyenne est de une à deux semaines. Les larves migrent vers le système nerveux central via la circulation sanguine et atteignent le cerveau en quelques heures après l’ingestion. En deux semaines, elles parviennent à l’espace sous-arachnoïdien, provoquant une réaction inflammatoire sévère impliquant principalement les éosinophiles.
Hawaï n’a rapporté que cinq cas confirmés en 2024, mais avec neuf à dix millions de touristes par an, de nombreuses infections peuvent se manifester après le retour des voyageurs.
Implications cliniques pour les patients
Ce cas illustre plusieurs considérations cliniques importantes pour les patients présentant des symptômes neurologiques après un voyage :
La méningite à éosinophiles doit être envisagée chez les patients présentant des céphalées, des symptômes sensitifs et une éosinophilie, surtout après un séjour en zone d’endémie. Le diagnostic définitif nécessite une ponction lombaire, qui comporte des risques minimes (5 à 10 % de risque de céphalée, complications graves très rares).
L’historique du voyage est crucial dans l’évaluation diagnostique. Les patients doivent fournir des informations détaillées sur :
- Les pays et régions spécifiques visités
- Les habitudes alimentaires pendant le voyage
- Les activités d’exposition à l’eau
- Le moment d’apparition des symptômes par rapport au voyage
La progression des symptômes sensitifs périphériques vers une atteinte du système nerveux central (céphalées, confusion) est caractéristique des migrations parasitaires dans l’angiostrongylose.
Limites de l'étude
Ce rapport de cas présente plusieurs limites que les patients doivent comprendre :
En tant que rapport de cas unique, les résultats représentent l’expérience d’un seul patient et ne sont pas nécessairement généralisables à tous les cas de méningite à éosinophiles. Le diagnostic reposait sur la présentation clinique et les antécédents de voyage plutôt que sur l’identification définitive du parasite dans le LCR ou les tissus.
La patiente a pris du zolpidem avant de développer une confusion, ce qui aurait pu contribuer à ses altérations de l’état mental indépendamment de l’infection. Certaines valeurs biologiques (notamment la chute de l’éosinophilie à l’admission) étaient inhabituelles pour les infections parasitaires typiques et peuvent refléter une variabilité de la maladie ou le moment des mesures.
Recommandations aux patients
Sur la base de ce cas, les patients devraient considérer les recommandations suivantes :
-
Précautions de voyage : Lors de visites en régions tropicales ou subtropicales, éviter de consommer :
- Des escargots, limaces ou fruits de mer d’eau douce crus ou mal cuits
- Des produits non lavés pouvant être contaminés par du mucus d’escargot ou de limace
- Des crabes, crevettes ou grenouilles d’eau douce crus
-
Vigilance symptomatique : Consulter un médecin en cas de :
- Sensations de brûlure ou de picotement inexpliquées après un voyage
- Céphalées progressives avec fièvre
- Altérations de l’état mental après un séjour international
-
Communication médicale : Lors de la consultation :
- Fournir un historique détaillé du voyage incluant destinations et dates
- Décrire tous les aliments consommés pendant le voyage
- Mentionner toute activité d’exposition à l’eau
- Compréhension diagnostique : Être conscient qu’une ponction lombaire peut être nécessaire au diagnostic et présente des risques minimes lorsqu’elle est réalisée correctement
Informations sur la source
Titre original de l’article : Cas 5-2025 : Une femme de 30 ans avec céphalées et dysesthésies
Auteurs : Joseph Zunt, MD, MPH ; Amy K. Barczak, MD ; Daniel Y. Chang, MD, PhD ; Dennis C. Sgroi, MD ; Eric S. Rosenberg, MD ; David M. Dudzinski, MD ; et collègues
Publication : The New England Journal of Medicine, 13 février 2025 ; 392:699-709
DOI : 10.1056/NEJMcpc2412514
Cet article adapté aux patients est basé sur une recherche évaluée par les pairs provenant des dossiers de cas du Massachusetts General Hospital.