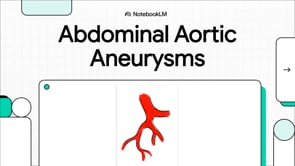Ce cas concerne une nouveau-née ayant présenté un arrêt cardiorespiratoire mettant en jeu le pronostic vital à la naissance, nécessitant seize minutes de réanimation. Son parcours hospitalier complexe a inclus des pneumothorax bilatéraux, une hypertension artérielle pulmonaire persistante, et a finalement mis en évidence une malformation pulmonaire congénitale rare : une séquestration bronchopulmonaire intralobaire. Dans cette anomalie, une partie du poumon est vascularisée par l'aorte plutôt que par l'artère pulmonaire. Le diagnostic a été confirmé par imagerie avancée, révélant une artère aberrante naissant de l'aorte et irriguant une masse située dans le lobe inférieur gauche, ce qui explique l'opacité pulmonaire persistante et la récupération difficile.
Le parcours complexe d’un nouveau-né : de l’arrêt respiratoire à une affection pulmonaire rare
Sommaire
- Présentation du cas : une naissance difficile
- L’évolution hospitalière complexe
- L’énigme diagnostique : envisager toutes les possibilités
- Établissement du diagnostic définitif
- Prise en charge et suivi à long terme
- Implications pour les patients et les familles
- Sources d’information
Présentation du cas : une naissance difficile
Une nouveau-née a été admise directement en unité de soins intensifs néonatals (USIN) au Massachusetts General Hospital après un arrêt cardiorespiratoire survenu pendant l’accouchement. Sa mère, âgée de 19 ans et primipare, avait présenté une grossesse compliquée par une hépatite C, une infection à Chlamydia trachomatis traitée et une hypertension gestationnelle.
Les échographies prénatales, réalisées entre 20 et 39 semaines de gestation, avaient mis en évidence une dilatation des voies urinaires droites, mais le cœur fœtal était normal. À 40 semaines exactement, une rupture spontanée des membranes est survenue, conduisant à l’hospitalisation. Des anomalies du rythme cardiaque fœtal ont motivé une césarienne après 22 heures et 39 minutes de travail.
Lors de l’accouchement, les médecins ont observé un liquide amniotique teinté de méconium. L’enfant est née en présentation du siège six minutes après l’incision utérine. Ses mensurations à la naissance étaient :
- Poids : 3575 grammes (62ᵉ percentile)
- Longueur : 50 cm (42ᵉ percentile)
- Périmètre crânien : 35,5 cm (72ᵉ percentile)
À la naissance, la nouveau-née ne respirait pas et présentait une hypotonie musculaire. Une réanimation immédiate a été entreprise, comprenant intubation, réanimation cardiopulmonaire et administration d’adrénaline et de solutés salés par cathéter veineux ombilical. La circulation spontanée est revenue après 16 minutes. Les scores d’Apgar étaient critiques : 1, 0, 0, 1 et 3 respectivement à 1, 5, 10, 15 et 20 minutes.
L’évolution hospitalière complexe
À son admission en USIN, le bébé présentait une température de 34,9 °C, une fréquence cardiaque de 141 battements par minute et une pression artérielle de 84/59 mm Hg. Une ventilation mécanique avec une saturation en oxygène à 97 % était nécessaire. Une hypothermie thérapeutique a été instaurée pour protéger le cerveau après l’anoxie.
Les premières radiographies thoraciques ont révélé un pneumothorax droit petit à modéré et une possible hyperinflation ou début de pneumothorax gauche. Une thoracentèse à l’aiguille a permis d’évacuer 20 ml d’air du côté droit. Un traitement antibiotique empirique par ampicilline et ceftazidime a été débuté.
Au deuxième jour, l’état respiratoire s’est aggravé. De nouvelles radiographies ont montré la résolution du pneumothorax droit, mais l’apparition d’un large pneumothorax gauche avec collapsus pulmonaire étendu. L’évacuation de 27 ml d’air du côté gauche a amélioré la réexpansion.
L’examen anatomopathologique du placenta a mis en évidence des membranes teintées de méconium et une chorioamniotite aiguë avec atteinte vasculaire fœtale.
Dans les jours suivants, le bébé a développé une hypertension artérielle pulmonaire persistante du nouveau-né (HTAPN), une affection grave où le sang contourne les poumons. La différence entre les saturations pré- et post-ductales variait de 5 à 15 %, indiquant un shunt significatif. Le traitement a nécessité une augmentation de l’oxygène à 100 % et l’ajout de monoxyde d’azote inhalé pour dilater les vaisseaux pulmonaires.
Parmi les autres complications :
- Une hypotension artérielle nécessitant une expansion volémique et plusieurs médicaments (dopamine, milrinone, adrénaline)
- Une échocardiographie montrant une persistance du canal artériel (2,9 mm), une communication interventriculaire (2,0 mm) et un foramen ovale perméable (2,5 mm)
- Une régurgitation tricuspide avec un gradient maximal de 58 mm Hg, évoquant une élévation des pressions cardiaques droites
- Une dilatation sévère des voies urinaires droites
- Une activité critique de 25 minutes, traitée par phénobarbital
Au jour 16, le bébé a présenté une fièvre à 38,8 °C. La radiographie thoracique a montré une nouvelle opacité dans le lobe inférieur gauche avec un petit épanchement pleural. Malgré plusieurs antibiothérapies, l’opacité a persisté jusqu’au jour 21.
L’énigme diagnostique : envisager toutes les possibilités
L’équipe médicale a envisagé diverses pathologies pouvant expliquer la persistance de l’opacité pulmonaire au même endroit qu’une clarté initiale. Plusieurs diagnostics courants ont été écartés :
Syndrome d’aspiration méconiale : Bien que du méconium ait été présent à l’accouchement et qu’environ 5 % des nourrissons exposés développent ce syndrome (dont 9,6 % un pneumothorax), les anomalies radiologiques sont généralement transitoires, non persistantes.
Hernie diaphragmatique congénitale : Celle-ci survient dans environ 2,4 cas pour 10 000 naissances, avec 80 % à gauche. Cependant, les radiographies sériées sur trois semaines n’ont montré aucune anse intestinale intrathoracique ni déviation médiastinale.
L’équipe s’est alors tournée vers les malformations pulmonaires congénitales, considérant que la persistance des anomalies au même endroit suggérait une lésion structurelle préexistante devenue infectée. Plusieurs hypothèses ont été évaluées :
Kystes bronchogéniques multiples : Ils se forment typiquement dans le médiastin ; seulement 5 % surviennent dans le parenchyme pulmonaire, généralement dans les lobes inférieurs. Cependant, ils sont habituellement détectés en prenatal et se présentent comme de grands kystes.
Hyperinflation lobaire congénitale : Elle provoque une hyperexpansion d’un lobe, le plus souvent le lobe supérieur gauche, et non le lobe inférieur comme observé ici. Le degré d’hyperexpansion était également moins marqué que dans cette pathologie.
Malformation adénomatoïde kystique du poumon (MAKP) : Cette prolifération hamartomateuse survient dans 1 cas sur 7500 naissances. L’équipe a considéré les cinq types :
- Type 0 (Dysplasie acinaire) : Létal précoce, écarté
- Type 1 : Le plus fréquent (plus des deux tiers des cas), avec de grands kystes jusqu’à 10 cm, généralement détecté en prenatal
- Type 2 : Deuxième en fréquence (10-15 % des cas), avec multiples espaces kystiques jusqu’à 2,5 cm
- Type 3 : Masse solide adénomatoïde avec petits kystes, habituellement détecté en prenatal
- Type 4 : Kystes de tailles variées pouvant simuler un lobe hyperexpandé, associé au pneumothorax
Séquestration bronchopulmonaire (SBP) : Cette malformation congénitale implique du tissu pulmonaire non connecté à l’arbre trachéobronchique, vascularisé directement par l’aorte. Deux types existent :
- Extralobaire : encapsulée par sa propre plèvre, généralement entre le lobe inférieur et le diaphragme
- Intralobaire : intégrée au parenchyme pulmonaire normal (plus fréquente), habituellement dans le lobe inférieur (98 % des cas), en particulier dans les segments médial et postérieur du lobe inférieur gauche
L’équipe a conclu que la séquestration bronchopulmonaire intralobaire était le diagnostic le plus probable, éventuellement sous forme de lésion hybride avec MAKP. Une échographie thoracique a été recommandée pour rechercher une vascularisation aberrante issue de l’aorte.
Établissement du diagnostic définitif
L’échographie thoracique avec Doppler couleur réalisée au jour 21 a mis en évidence une masse majoritairement échogène dans le lobe inférieur gauche, avec suspicion d’une vascularisation artérielle provenant de l’aorte abdominale. L’angioscanner réalisé au jour 23 a confirmé une zone de condensation hétérogène pseudo-tumorale dans la lingula et le lobe inférieur gauche, vascularisée par une artère naissant de l’aorte abdominale.
Ceci a confirmé le diagnostic de malformation bronchopulmonaire, spécifiquement une séquestration bronchopulmonaire intralobaire. Le tissu pulmonaire anormal était vascularisé directement par l’aorte plutôt que par l’artère pulmonaire, expliquant l’opacité persistante et l’évolution clinique complexe.
Prise en charge et suivi à long terme
La patiente a été évaluée par la chirurgie pédiatrique, mais la prise en chirurgicale définitive a été reportée en ambulatoire. Compte tenu de ses multiples anomalies congénitales, une évaluation génétique a été réalisée, comprenant :
- Une puce à ADN chromosomique : normale
- Un test de mutation DICER1 : négatif (important car cette mutation est associée à 40 % des blastomes pleuropulmonaires et confère un risque cancéreux)
La fièvre a finalement disparu. La patiente a été progressivement sevrée de la ventilation mécanique et de la sédation. Elle a débuté l’alimentation orale et a continué à être suivie par une équipe multidisciplinaire incluant pneumologie, chirurgie, néphrologie et urologie.
L’angioscanner de contrôle au jour 149 a montré que la zone de condensation avait été remplacée par une hyperclarté, évoquant des modifications kystiques et une hyperinflation. La vascularisation aberrante de l’aorte abdominale persistait mais était moins visible. L’imagerie a également confirmé la dilatation rénale droite connue, maintenant status post pyéloplastie.
Implications pour les patients et les familles
Ce cas illustre plusieurs enseignements cliniques importants pour les familles confrontées à des situations néonatales complexes :
Persistance des symptômes : Lorsque des anomalies pulmonaires persistent malgré un traitement adapté, il faut évoquer une malformation congénitale. La répétition d’anomalies au même endroit (clarté puis opacité) est particulièrement suggestive d’un problème structurel sous-jacent.
Évaluation complète : Les nouveau-nés présentant plusieurs anomalies congénitales bénéficient d’une évaluation multidisciplinaire. Cette patiente a nécessité l’intervention de néonatologie, cardiologie, neurologie, néphrologie, chirurgie et génétique.
Considérations génétiques : Bien que la plupart des malformations bronchopulmonaires soient sporadiques, certaines (notamment les MAKP type 4) peuvent être associées à des mutations comme DICER1, qui confèrent un risque cancéreux. Un conseil génétique et des tests appropriés sont importants.
Timing de l’intervention : La prise en charge chirurgicale d’une séquestration bronchopulmonaire est généralement elective plutôt qu’urgente. Le timing dépend de l’état clinique, de la taille de la lésion et de la présence de complications.
Suivi à long terme : Les patients porteurs de malformations pulmonaires congénitales nécessitent une surveillance continue pour dépister d’éventuelles complications : infections récurrentes, saignements et, très rarement, transformation maligne.
Ce cas démontre comment l’imagerie avancée, comme l’angioscanner, permet d’identifier précisément une anatomie vasculaire anormale, facilitant un diagnostic exact et une planification thérapeutique adaptée aux affections congénitales complexes.
Sources d’information
Titre original de l’article : Case 35-2024: A Newborn with Hypoxemia and a Lung Opacity
Auteurs : T. Bernard Kinane, M.D., Evan J. Zucker, M.D., Katherine A. Sparger, M.D., Cassandra M. Kelleher, M.D., et Angela R. Shih, M.D.
Publication : The New England Journal of Medicine, 14 novembre 2024;391:1838-46
DOI : 10.1056/NEJMcpc2402487
Cet article destiné aux patients s’appuie sur des recherches évaluées par des pairs issues des dossiers médicaux du Massachusetts General Hospital.