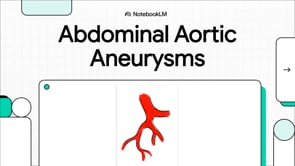Il s’agit d’un homme de 69 ans immunodéprimé, avec des antécédents de lymphome, ayant présenté des symptômes neurologiques d’apparition rapide incluant des céphalées, des troubles de la coordination et une faiblesse musculaire, survenus après un accident de voilier et des expositions à des tiques. Bien que des examens approfondis aient été réalisés pour écarter une récidive néoplasique ou d’autres infections, les bilans ont finalement mis en évidence une encéphalite à virus Powassan. Il s’agit d’une maladie rare transmise par les tiques, touchant particulièrement les patients immunodéprimés dans les régions de la Nouvelle-Angleterre et du Midwest supérieur.
Un cas complexe de symptômes neurologiques chez un patient immunodéprimé : du lymphome à l’encéphalite à tiques
Table des matières
- Introduction : pourquoi ce cas est important
- Antécédents médicaux et contexte
- Symptômes et présentation initiale
- Examens diagnostiques et résultats
- Diagnostic différentiel : envisager toutes les hypothèses
- Diagnostic final et confirmation
- Implications cliniques pour les patients
- Limites et considérations
- Recommandations aux patients
- Informations sur la source
Introduction : pourquoi ce cas est important
Cette étude de cas illustre les défis diagnostiques que peuvent présenter les patients immunodéprimés développant des symptômes neurologiques. Le patient cumulait plusieurs facteurs médicaux complexes : antécédents de traitement pour lymphome, immunosuppression persistante et expositions extérieures significatives, ce qui a rendu le tableau clinique particulièrement difficile à interpréter.
Chez les patients immunodéprimés, même des infections rares peuvent devenir préoccupantes et nécessiter des examens spécialisés pour être identifiées. Ce cas souligne comment les maladies transmises par les tiques peuvent entraîner des complications neurologiques sévères, et l’importance d’une évaluation diagnostique approfondie chez les patients aux antécédents médicaux complexes.
Antécédents médicaux et contexte
Il s’agissait d’un homme de 69 ans aux antécédents médicaux étendus, ayant fortement influencé son état actuel. Il avait été diagnostiqué trois ans plus tôt d’un lymphome diffus à grandes cellules B (LDGCB) systémique, traité par chimiothérapie à base de bendamustine et rituximab.
Un an après le diagnostic initial, le patient avait présenté une rechute de son lymphome avec atteinte du système nerveux central (SNC), positif pour le virus d’Epstein-Barr (EBV). Son traitement avait inclus du méthotrexate à haute dose, suivi d’une thérapie par cellules CAR-T (tisagénlecléucel), puis d’ibrutinib.
Ses autres pathologies comprenaient :
- Hypertension artérielle
- Dyslipidémie
- Cardiomyopathie dilatée non ischémique
- Rétention urinaire
- Thrombose de la veine mésentérique supérieure
- Hypogammaglobulinémie
- Trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité
- Trouble de l’humeur
Le patient prenait de nombreux médicaments, dont : acyclovir en prophylaxie, apixaban, atorvastatine, dextroamphétamine-amphétamine, empagliflozine, fluconazole, métoprolol succinate, sacubitril-valsartan, sulfaméthoxazole-triméthoprime en prophylaxie, tamsulosine et venlafaxine. Il recevait également des perfusions périodiques d’immunoglobulines intraveineuses pour prévenir les infections.
Symptômes et présentation initiale
Le patient était actif et pratiquait des sports nautiques jusqu’à deux semaines avant son admission, lorsqu’il est tombé en naviguant et s’est cogné le dos. Suite à cet incident, il a développé des douleurs au milieu du dos et au niveau des côtes inférieures droites.
Au cours des deux semaines suivantes, ses symptômes se sont aggravés progressivement :
- Faiblesse progressive et difficultés de coordination des mains
- Incapacité à se nourrir seul en raison de problèmes de coordination
- Céphalées similaires à ses migraines habituelles
À l’examen hospitalier, les médecins ont noté :
- Température : 36,3 °C, tension artérielle : 107/65 mm Hg, pouls : 86 battements par minute
- Parole lente et légèrement hypophonique
- Nystagmus en position extrême dans les deux yeux
- Fasciculations dans les jambes
- Hypertonie du bras et de la jambe droits
- Faiblesse à l’abduction des doigts des deux mains
- Ataxie des deux mains au test doigt-nez
- Faiblesse et hyperréflexie du bras droit
Durant son hospitalisation, ses symptômes ont continué à s’aggraver. Au quatrième jour, son hypophonie s’est accentuée, avec apparition de léthargie, aggravation de l’ataxie manuelle et nouvelle ataxie axiale. Au cinquième jour, il a développé une paralysie bilatérale du sixième nerf crânien et des difficultés à avaler les aliments solides.
Examens diagnostiques et résultats
Les analyses sanguines initiales montraient une leucocytose à 4860 par microlitre (intervalle de référence : 4500 à 11 000), avec une lymphocytose à 260 par microlitre (intervalle de référence : 1000 à 4800), indiquant une lymphopénie significative compatible avec son état immunodéprimé.
Les examens d’imagerie ont révélé des éléments importants :
- Le scanner cérébral montrait des modifications post-chirurgicales d’une craniotomie frontale gauche antérieure et une lésion calcifiée de 6 mm dans le centre semi-ovale gauche
- L’angioscanner révélait des fractures aiguës des 11ᵉ et 12ᵉ côtes droites postérieures
- L’IRM cérébrale montrait une discrète hyperintensité de signal dans l’hémisphère cérébelleux gauche
- L’IRM de contrôle au jour 9 d’hospitalisation montrait une hyperintensité de signal dans les deux hémisphères cérébelleux, les folia cérébelleux et le tronc cérébral
La ponction lombaire réalisée au sixième jour d’hospitalisation a montré :
- Pression d’ouverture : 15 cm d’eau (normale)
- 21 cellules nucléées par microlitre (intervalle de référence : 0 à 5)
- Composition cellulaire : 77 % de lymphocytes, 14 % de monocytes, 9 % de cellules non classées
- Glucose du LCR : 51 mg/dL (2,8 mmol/L ; intervalle de référence : 50–75 mg/dL)
- Protéinorachie : 74 mg/dL (intervalle de référence : 5–55 mg/dL)
- Aucune bactérie à la coloration de Gram
- De nombreux lymphocytes avec quelques formes atypiques en cytologie
- Aucune évidence de population monoclonale de cellules B en cytométrie en flux
L’électromyographie et les études de conduction nerveuse montraient des signes d’un processus neurogène subaigu touchant de multiples racines nerveuses aux niveaux crânien et cervical.
Diagnostic différentiel : envisager toutes les hypothèses
L’équipe médicale a envisagé de multiples causes possibles à la détérioration neurologique du patient, en se concentrant sur trois catégories principales : pathologies immuno-médiées, récidive cancéreuse et infections.
Pathologies immuno-médiées : Les troubles auto-immuns représentent environ 6 % des ataxies cérébelleuses sporadiques chez l’adulte. L’équipe a considéré diverses pathologies anticorps-médiées, mais a jugé celles-ci improbables compte tenu de l’altération de l’immunité humorale et cellulaire du patient.
Récidive cancéreuse : Les antécédents de lymphome du SNC du patient faisaient de la récidive une hypothèse forte. Cependant, l’IRM ne montrait pas de lésions rehaussées typiques et la cytométrie en flux ne révélait pas de cellules B monoclonales. L’atteinte cérébelleuse symétrique était également inhabituelle pour un lymphome.
Causes infectieuses : De multiples infections ont été envisagées :
- Infections fongiques (improbables sous traitement par fluconazole)
- Infections bactériennes incluant la maladie de Lyme (tests négatifs) et Listeria (improbable sans abcès à l’IRM)
- Infections virales incluant le virus JC, le virus du Nil occidental et les virus herpétiques
- Infections transmises par les tiques incluant le virus Powassan
La combinaison des expositions aux tiques, de la détérioration neurologique rapide, des symptômes cérébelleux et des résultats du LCR faisait de l’encéphalite à virus Powassan le diagnostic le plus probable.
Diagnostic final et confirmation
L’équipe diagnostique a conclu que l’encéphalite à virus Powassan était l’hypothèse la plus vraisemblable, sur la base de plusieurs éléments clés :
Le virus Powassan est un flavivirus transmis par les arthropodes, étroitement apparenté au virus de l’encéphalite à tiques. Il est transmis par Ixodes scapularis (tique du chevreuil) et est de plus en plus signalé dans le Midwest supérieur et les régions de la Nouvelle-Angleterre.
Les caractéristiques cliniques supportant ce diagnostic incluaient :
- Piqûres de tiques récentes rapportées par le patient
- Détérioration neurologique progressive rapide sur plusieurs semaines
- Atteinte cérébelleuse avec ataxie et problèmes de coordination
- Paralysies des nerfs crâniens (atteinte du sixième nerf)
- LCR montrant une pléiocytose lymphocytaire (21 cellules/μL avec 77 % de lymphocytes)
- IRM montrant des anomalies symétriques cérébelleuses et du tronc cérébral sans effet de masse
- Absence de réponse à de multiples traitements antimicrobiens
Le diagnostic a été confirmé par amplification en chaîne par polymérase (PCR) du LCR pour le virus Powassan, examen de choix chez les patients immunodéprimés suspectés d’infection.
Implications cliniques pour les patients
Ce cas présente plusieurs implications importantes, en particulier pour les patients immunodéprimés :
Les patients dont le système immunitaire est affaibli présentent un risque accru d’infections qui pourraient passer inaperçues chez des individus sains. Le virus Powassan, bien que rare, peut provoquer une maladie sévère chez les patients immunodéprimés.
Le diagnostic a nécessité des tests spécialisés généralement absents des panels standards de maladies infectieuses. Ceci souligne l’importance de signaler toute exposition aux tiques aux professionnels de santé et d’envisager les maladies rares transmises par les tiques dans les contextes cliniques appropriés.
Pour les patients ayant des antécédents de lymphome et présentant des symptômes neurologiques, le processus diagnostique doit équilibrer soigneusement les risques de récidive cancéreuse et l’évaluation des causes infectieuses, surtout en cas d’immunosuppression.
Limites et considérations
Plusieurs limites doivent être prises en compte lors de l’interprétation de ce cas :
Le diagnostic reposait sur des tests spécialisés qui pourraient ne pas être disponibles dans tous les centres médicaux, ce qui pourrait retarder le diagnostic et le traitement dans les régions où le virus Powassan émerge.
Chez les hôtes immunocompétents, l’ARN du virus Powassan est souvent transitoire et pourrait être indétectable au moment de la consultation, rendant le diagnostic plus difficile.
Les antécédents médicaux complexes du patient et ses multiples traitements créaient des facteurs confusionnels ayant compliqué le processus diagnostique.
Les tests pour les maladies transmises par les tiques peuvent être moins fiables chez les patients profondément immunodéprimés, qui pourraient ne pas développer de réponse anticorps typique.
Recommandations aux patients
Sur la base de ce cas, les patients immunodéprimés devraient considérer les recommandations suivantes :
- Prévention des tiques : Utiliser un répulsif adapté, porter des vêtements protecteurs et effectuer des vérifications minutieuses après les activités en extérieur dans les zones endémiques
- Signalement des expositions : Signaler toute piqûre de tique ou exposition extérieure aux professionnels de santé, surtout en cas de symptômes neurologiques
- Évaluation précoce : Consulter rapidement en présence de symptômes neurologiques tels que céphalées, problèmes de coordination ou faiblesse
- Antécédents complets : Fournir des antécédents médicaux détaillés incluant tous les médicaments, traitements et statut immunitaire
- Tests spécialisés : Comprendre que certaines infections nécessitent des tests spécialisés absents des panels standards
Pour les patients ayant des antécédents similaires, ce cas souligne l’importance de maintenir une communication continue avec les spécialistes en oncologie et maladies infectieuses concernant tout nouveau symptôme ou exposition.
Informations sur la source
Titre original de l’article : Cas 19-2025 : Un homme de 69 ans avec céphalées et ataxie
Auteurs : Arun Venkatesan, M.D., Ph.D., Javier M. Romero, M.D., G. Kyle Harrold, M.D., et Erik H. Klontz, M.D., Ph.D.
Publication : The New England Journal of Medicine, 2025;393:176-84
DOI : 10.1056/NEJMcpc2412528
Cet article vulgarisé s’appuie sur une recherche évaluée par les pairs issue des Comptes Rendus de Cas du Massachusetts General Hospital.